La présence des juifs en Sicile est attestée au Moyen Âge dans les villes de Palerme, Messina, Taormina ou encore Syracuse. La communauté, prospère, se consacrait majoritairement au commerce jusqu’à son expulsion de l’île, en 1492 par Ferdinand II. Il faudra cependant attendre 1989 pour mettre au jour l’un des joyaux du patrimoine juif européen : le mikveh de Syracuse, à ce jour le plus ancien bain rituel connu d’Europe.

Le mikveh, de 9 mètres de long, se trouve sous les fondations de l’hôtel Alla Giudecca, au cœur de ce qui fut le quartier juif de Syracuse. Le mikveh fut probablement recouvert de gravats et caché aux yeux du monde par les juifs eux-mêmes, lors de leur fuite en 1492, peut-être dans l’espoir de le retrouver à leur hypothétique retour. Le bain rituel date du VIe siècle, adapté d’une citerne byzantine datant du Ve siècle et fut actif jusqu’à l’Expulsion.
La visite du mikveh débute dans l’hôtel même, en empruntant un escalier de pierre de 48 marches qui mène à une pièce carrée dont le plafond voûté est supporté par quatre colonnes. Sont encore visibles trois bains rituels entourés de bancs de pierre. Deux petites pièces contiennent des bains, certainement utilisés par des fidèles plus prospères.
La communauté juive d’Erfurt est mentionnée pour la première fois à la fin du XIe siècle. C’est également la période du début de la construction de la synagogue. Pendant des siècles, juifs et les chrétiens vécurent ensemble dans le centre-ville. Les preuves de la coexistence se font plus précises au XIIIe siècle. On apprend des listes d’actes et de taxes que les juifs d’Erfurt travaillaient principalement dans la banque et entretenaient des contacts, non seulement avec les aristocrates de la région, mais avaient également des relations commerciales avec tout l’Empire romain.

Leur quartier résidentiel se trouvait dans le centre-ville, entre la mairie, Krämerbrücke et Michaeliskirche. On y trouvait une synagogue et un mikveh. Le cimetière se trouvait hors du quartier résidentiel.
La vague de persécutions anti-juives qui s’étend avec la progression de la peste atteint Erfurt en 1349. Le 21 mars 1349, toute la communauté – soit environ 900 personnes – est assassinée lors d’un pogrom. Un marchand s’empara de la synagogue et la transforma en hangar.

Réinstallation des juifs à Erfurt
Une communauté se réinstalle à Erfurt dès 1354 dans les mêmes quartiers. Une synagogue est construite entre 1355 et 1357 derrière l’hôtel de ville. Cette deuxième communauté était plus mixte socialement : on comptait des familles très aisées, mais également des prêteurs sur gages, ou encore des fabricants de shofars. Au cours du XVe siècle, l’antisémitisme augmente à Erfurt. En 1453, la municipalité révoque le statut des juifs qui leur assure protection, et ils sont interdits de résidence dans la ville l’année suivante. Les biens juifs sont vendus, la synagogue transformée en armurerie et le cimetière rasé.
Il n’y a pas de traces de la présence organisée d’une communauté juive à Erfurt entre l’expulsion de 1453 et les guerres napoléoniennes. Quand Erfurt devient territoire impérial, David Salomon Unger sera le premier juif à devenir citoyen officiel d’Erfurt de la période moderne. Au XIXe siècle, la communauté croît rapidement.

Persécution et Shoah
Pendant la Nuit de cristal, la synagogue d’Erfurt est pillée puis mise à feu par les SA. Le gymnase de l’école sur Meyfartstraße sert de point de rassemblement pour environ 200 hommes envoyés vers le camp de concentration de Buchenwald. Le 6 avril 1939, la ville d’Erfurt s’approprie les biens juifs.
En 1932, on comptait 1290 juifs à Erfurt, en juin 1933 831, en mai 1939 263. Après la guerre, un petit groupe revint de Theresienstadt pour se ré-établir dans sa ville d’origine.
En 1945, après la Shoah, 20 membres de la communauté en faisaient déjà partie avant-guerre. Malgré l’émigration vers Israël, la communauté juive se renforce avec l’arrivée de membres venus d’Europe de l’Est. La communauté de Thuringe compte aujourd’hui environ 800 personnes.
La vieille synagogue
La vieille synagogue dont certains pans sont intacts depuis le XIe siècle, est la plus ancienne synagogue préservée d’Europe centrale. En 2009, un musée y a été inauguré, qui expose les vestiges de la communauté juive médiévale.
L’exposition retrace l’histoire de la communauté d’Erfurt. Au rez-de-chaussée, une salle est dédiée à l’histoire du bâtiment en lui-même. Le trésor se trouve dans la cave, et les manuscrits au premier étage. Dans la cour, vous pourrez admirer des pierres tombales du cimetière juif détruit.
La grande synagogue
La grande synagogue, dessinée par l’architecte francfortois Siegfried Kusnitzky fut inaugurée le 4 septembre 1884. Elle pouvait accueillir 500 fidèles, était richement décorée et possédait un orgue. Ce fut le centre de la communauté jusqu’à sa destruction en 1938. La nouvelle synagogue fut construite sur son site en 1951/52.
La petite synagogue
La petite synagogue fut inaugurée le 10 juillet 1840 et fut en activité 44 ans. En effet, la communauté se développant rapidement, elle vendit la petite synagogue à un marchand et entreprit la construction de la grande synagogue. En 1918, la municipalité y fit construire des appartements. Dans les années 1980, la municipalité fait restaurer le bâtiment. C’est là qu’on y trouva le mikveh, la niche de la Torah et le balcon des femmes. La salle de prière a été reconstruite à l’identique et sert aujourd’hui de centre culturel. On y trouve également une exposition sur la communauté juive d’Erfurt aux XIXe et XXe siècles.
Le cimetière juif médiéval
Le cimetière juif médiéval se trouvait à Moritztor, aujourd’hui Große Ackerhofsgasse. On pense qu’il fut inauguré par la première communauté d’Erfurt. Les tombes les plus anciennes retrouvées à ce jour datent du XIIIe siècle. Après qu’il fut rasé en 1553, le marbre des tombes fut utilisé pour construire la ville, on en retrouve encore aujourd’hui lors de restaurations de bâtiments ou de routes.
Une pierre fut érigée sur le site du cimetière en 1996. La restauration du cimetière a commencé en 2007.
Le nouveau cimetière juif
Depuis son inauguration en 1878, les membres de la communauté y sont enterrés. C’est le seul cimetière juif en activité de Thuringe.
Mikveh
Des documents attestent que le mikveh d’Erfurt remonte au milieu du XIIIe siècle.

Les manuscrits d’Erfurt
Les manuscrits d’Erfurt sont la preuve de l’importance de la communauté juive médiévale. 15 manuscrits datant d’entre les XIIe et XIVe siècles ont été préservés. On a retrouvé des rouleaux de torah, 4 Bibles en hébreu et un machzor.
On pense que les manuscrits ont été saisis par le Conseil d’Erfurt après le pogrom. Ils auraient vendu certains livres, et d’autres sont restés propriété de la ville jusqu’au XVIIe siècle. Ils sont conservés à la Bibliothèque nationale à Berlin depuis 1800.
Le Trésor d’Erfurt
Le Trésor d’Erfurt est exposé dans la cave de la vieille synagogue. Cette découverte unique date de 1998. On pense que les objets ont été cachés dans le mur d’une cave par une famille juive au moment du pogrom de 1349. Le trésor a un poids total de 28 kg. On compte 3141 pièces d’argent, 14 lingots d’argent et plus de 700 objets. Vous pourrez admirer de la vaisselle, des broches ornées de pierres précieuses, des bagues en or et en argent, etc… Le plus bel objet de ce trésor est la fameuse bague en or de la moitié du XIVe siècle. Le trésor a fait l’objet d’expositions à New York, Londres ou Paris avant d’être intégré à la collection permanente de la vieille synagogue en 2009.
La communauté juive aujourd’hui
Vous trouverez le centre communautaire à côté de la synagogue. Il accueille la radio communautaire de Thuringe, fondée en 2000, l’association Via Shalom, ainsi qu’un café.
En septembre 2023, un ensemble de bâtiments témoignant du passé judéo-médiéval d’Erfurt a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, devenant le 52e lieu d’Allemagne à en bénéficier.
Source: Jewish Past and Present in Erfurt
Les juifs vivaient sous occupation arabe à Malaga depuis 743. Ils occupent les quartiers à la périphérie en compagnie des très actifs commerçants de Gênes. À la chute du califat de Cordoue, la ville accueille de nombreux réfugiés juifs parmi lesquels Samuel Ibn Negrella, qui commence alors son ascension fulgurante et deviendra plus tard le conseiller du royaume arabe de Grenade. Au XIe siècle, on compte 200 juifs à Malaga. En 1487, après la conquête par les Rois catholiques, la population de 450 juifs est déportée à Carmona. Les communautés juives de Castille vont payer une rançon pour les libérer. C’est Abraham Senior et Meir Melamed qui se chargent de réunir l’argent. Une fois libérés, ils reviendront à Malaga, mais seront cinq ans plus tard expulsés vers l’Afrique du Nord.

La judería se trouve au pied de la forteresse Alcazaba . Un petit ensemble de rues : Granada , Zegri , Santiago , nous donne une idée de la vie juive. Dans la rue Postigo de San Agustin se trouvait la synagogue. Dans les années 1970 sur cet emplacement a été érigé un monument au poète Salomon ibn Gavirol, né à Malaga vers 1021.

La communauté juive s’est reconstituée au XXe siècle avec l’arrivée de nombreux juifs du Maroc du Nord, originaires de Ceuta et Melilla. En 1950, on compte 250 juifs, en 2000, ils sont 1500 environ. Il existe une synagogue moderne et tous les services: école primaire, boucherie casher, cimetière.
La communauté juive a existé depuis l’époque wisigothique et elle se développa considérablement sous l’occupation musulmane. À l’arrivée des premières troupes chrétiennes en 1266 sous le commandement d’Alphonse X de Castille on comptait de nombreuses synagogues, mais la plupart des juifs préférèrent quitter la ville pour se réfugier à Grenade, encore aux mains des musulmans.

Quelques années plus tard, Alphonse X le Sage cherche à repeupler la ville, il invite les juifs de Castille à venir s’y installer. 90 familles arrivent avec les noms caractéristiques de la Vieille Castille, castellano, carrion, castro. En plus des maisons abandonnées par les Arabes, ils reçoivent du roi un magasin-dépôt de farine, deux synagogues, un hôpital-auberge, pour accueillir et soigner les réfugiés juifs et surtout la protection royale.
Le cœur de la Judería était l’actuelle rue de la Judería , ancienne rue de la synagogue. La première synagogue était dans la rue du même nom, la deuxième sur l’actuelle Plaza Santo Angel mais elle a été détruite en 1479.

Ce quartier juif était situé entre la Porte de Séville et la Porte Royale dans les rues actuelles de Torneria, Juderia, Eguilaz, San Cristobal, Alvar Lopez, Cuatro Juanes, Plaza del banco et Plaza del Progreso. Si les juifs devaient habiter ce quartier, ils travaillaient et commerçaient dans toute la ville et, bien entendu, autour du marché. Ils avaient cependant l’obligation de revenir dormir dans la judería qui fermait ses portes le soir.
En 1391, après la flambée de violence, les prédications des dominicains du couvent de Santo Domingo de la ville portent leurs fruits et la plupart de la population juive (entre 3 000 et 9 000 personnes) se convertit. L’inquisition tente l’expulsion en 1483, mais sans succès. En 1492, les juifs quittent la ville pour se réfugier vers le Portugal.

On note la présence d’une communauté juive dans la ville dès 612 grâce à un édit du roi défendant aux juifs de la ville d’employer des esclaves chrétiens. Cependant, si elle a connu son apogée au VIIe siècle, la présence des juifs à Jaen remonte très certainement à l’époque romaine. Le géographe Abd al-Nūr Al-Himyari fait état au IXe siècle de la présence d’un mikveh à Jaen, connu sous le nom de « bain d’Isaac ». En 2002, des excavations ont permis de retrouver les murs porteurs de ce mikveh, dont on pense qu’il appartenait à Isaac Ben Saprut, le père du fameux médecin et diplomate Hasday Ben Saprut. En 1391, à la suite des violences provoquées par les prédications de Vicente Ferrer, de nombreuses conversions ont lieu et le quartier juif devient un quartier de conversos portant le nom de Sainte Croix comme à Séville. C’est à Jaen que s’installe en 1483 le Tribunal de l’Inquisition.

Au XIe siècle, après le délitement du califat de Cordoue, Jaen est rattaché au royaume de Grenade. En 1066, le gouverneur de Grenade, Musakhan, autorise Maksan, le fils du roi de Grenade, à s’emparer des richesses des juifs de Jaen après que ceux-ci se sont révoltés. La communauté était dirigée à cette époque par rabbi Isaac qui voit la tolérance musulmane à l’égard des juifs s’achever brutalement avec l’invasion du royaume par les Almoravides. Les Almoravides, originaires d’Afrique du Nord, prêchaient un islam orthodoxe sans comparaison aucune avec l’harmonie inter-séculaire jusqu’ici en vigueur. Sous le commandement de Yusuf ibn Tasufin, les Almoravides envahissent un par un les royaumes d’Espagne et mettent à sac les villes se trouvant sur leur chemin.
La conquête almoravide oblige les juifs andalous à se réfugier vers les royaumes d’Espagne du Nord. Le quartier juif de Jaen ne sera réhabilité qu’en 1246, après la conquête de la ville par le roi chrétien Fernando III. L’emplacement du quartier juif de Jaen pendant le Moyen Âge chrétien est aujourd’hui encore débattu, il semblerait cependant que les juifs se soient réinstallés dans les mêmes rues que pendant l’ère musulmane, à savoir entre l’actuelle rue Santa Cruz et la rue San Andres . La synagogue était selon toute vraisemblance située dans la rue Santa Clara .

On sait par les relevés d’impôts qui ont été conservés que la communauté juive de Jaen était quasiment aussi importante que celle de Séville au XIIIe siècle, soit environ 1500 habitants. Jusqu’au milieu du XIIIe siècle, sous le règne de Fernando X, la communauté connaît un épanouissement qui dure jusqu’à l’expulsion en 1492.
Situés à l’intérieur du palais Villardompardo , les bains datant du XIe ont été occupés aussi bien par les juifs, les arabes et les chrétiens. Leur découverte date de 1913. Pour vous y rendre, passez par la Calle del Gato , une rue qui laisse imaginer l’apparence de la judería médiévale.
Un peu plus loin, la porte de Baeza était très certainement la porte empruntée par les juifs pour entrer et sortir de la judería.

Sur la façade de la Cathédrale de Jaen (1566), ainsi que dans le retable, on observe des fresques représentant des juifs, prouvant la présence importante de la communauté dans la ville.
Dans la rue Maestra on trouve le crucifix appelé Christ du secours. Il serait apparu dans le mur quand un groupe de juifs essaya de profaner une procession qui se dirigeait vers la cathédrale. Tradition populaire mise à part, cette rue encore très commerçante de nos jours était celle des négociants juifs. Les rues avoisinantes, dont celles de l’arco del Consuelo donnent une idée de l’ambiance médiévale juive.
S’il n’existe pas de preuve formelle, de nombreux éléments architecturaux laissent à penser que la chapelle San Andrés fut autrefois une synagogue.
Au numéro 6 de la place Magdalena, une étoile de David vous indiquera l’emplacement de ce qui fut la demeure de Hasday Ben Saprut .
La communauté juive de Baza remonte au XIe siècle. Les habitants de la judería étaient peu nombreux mais prospères grâce au commerce de la soie. Un mikveh y a été découvert et constitue un excellent exemple d’architecture arabe du XIe siècle. Il ne reste rien de l’ancien quartier juif qui se déployait à autour du mikveh, place de Santiago.

Ville importante de l’est de la Pologne, Lublin a conservé un quartier ancien très pittoresque, qui permet de s’imaginer ce que fut la vie du XVIIe siècle, avec l’hôtel de ville au milieu du rynek, l’église des Dominicains, les fortifications, les différentes portes de la ville et le château entouré d’un parc, auquel on accède par la rue Zamkowa, qui donne l’impression de se trouver dans un conte des Mille et Une Nuits.

Les juifs furent nombreux à s’établir à Lublin dès le XIVe siècle, tout d’abord dans le quartier de Kazimierz Zydowski, puis à proximité du château. La porte Grodzka était appelée brama Zydowska (« porte Juive »). Les XVIe et XVIIe siècles furent l’apogée de la communauté juive à Lublin : une imprimerie hébraïque fut fondée en 1547, puis une seconde en 1578, ainsi qu’une école talmudique de grande renommée, avec rang d’académie, dont de nombreuses personnalités furent recteurs – Salomon Luria, Mordechaï Jaffe, Meir ben Gedaliah-, et où Moses Isserles fit ses études. Au XIXe siècle, Lublin devint un grand centre du hassidisme, autour du tsaddik Yaakov Yitshak, dit le voyant de Lublin, disciple du grand Maggid et d’Elimelech de Lyzhansk.
Au moment de la déclaration de la guerre de 1939, 45 000 juifs vivaient à Lublin. Il y avait sept synagogues, deux mikvaot, un hôpital, une bibliothèque, des écoles, etc. Le ghetto fut créé en mars 1941, et, en mars 1942, 30 000 juifs furent déportés et exterminés au camp de Belzec, les autres furent exécutés sur place ou conduits au camp de Maïdanek.
La ville juive
Auparavant, appréciez l’atmosphère et prenez le pouls de ce quartier avec son rynek, ses portes, la rue Grodzka, la place Po Farzu, l’ancienne porte juive. Sur la droite, en descendant, dans la rue Grodzka se trouvait l’asile de vieillards (dom starców) de la communauté, mentionné par une plaque commémorative.

Les petites rues qui partent de la rue Grodzka sont les anciennes ruelles juives, souvent encore à l’abandon, qui mènent à la rue Lubartowska et à la place Ofiar Getta (« des Victimes du Ghetto »), avec un monument en mémoire des juifs de Lublin assassinés. Au numéro 10 de la rue Lubartowska se trouvait la synagogue, transformée aujourd’hui en « Izba à la mémoire des juifs de Lublin » : c’est un petit musée présentant photographies et documents historiques. Au numéro 83 de la même rue, se tenaient l’école rabbinique (aujourd’hui l’Académie de médecine) et, juste à côté, l’hôpital juif. En 2004, ces bâtiments ont été rendus à la communauté juive et depuis transformés en synagogue , mikveh et centre de la communauté juive.
Le No Name Theatre , créé en 1990 par des personnes souhaitant partager le patrimoine historique de Lublin, possède les archives des maisons du ghetto juif démolies, présentant également des photos d’époque et transmettant l’histoire de la Shoah par des activités culturelles. Le Lubliner Festival of Jewish Culture est organisé chaque année, sur deux jours, à la fin du mois d’août.
Les deux cimetières juifs méritent d’être visités, surtout celui de la rue Kalinowszczyna , établi au XVIe siècle. Y sont enterrées de nombreuses personnalités : le rabbin Shalom Shakhna, fondateur de l’école talmudique, mort en 1558, le professeur de Talmud Yehuda Leybush ben Meir Aszkenazi, mort en 1597, le rabbin Itzhak Aizyk Segal, mort en 1735, et surtout le tsaddik Yaakov Yitshak, mort en 1815, dont la tombe est recouverte de cailloux. L’autre cimetière, celui de la rue Walecznych , date du XIXe siècle. Il est très grand et possède aussi de belles tombes.
Le camp de Maïdanek
On ne peut quitter Lublin sans s’arrêter au camp de Maïdanek , qui se trouve aujourd’hui dans un faubourg de la ville. Il est bien visible de la route quand on prend la direction de Chelm. De la ville, tout pouvait être remarqué ou deviné sans aucune difficulté. Une visite attentive de Maïdanek, où les barbelés, les baraquements, les chambres à gaz et le four crématoire ont été conservés, est particulièrement émouvante et forte, comparable à celle d’Auschwitz (avec toutefois moins de visiteurs).

La ville de Jozefów possède une belle synagogue de la fin du XVIIe siècle. On la voit presque tout de suite en arrivant dans le village, sur la droite, un peu en retrait par rapport au centre-ville à l’angle des rues Górnicza et Krótka. Elle a été reconstruite dans les années 1990 et transformée en bibliothèque publique avec une particularité ; à l’étage, quand on se rend à l’ancienne galerie pour les femmes, on trouve aussi un cabinet médical et un hôtel.
Le 13 juillet 2022 a été dévoilée une plaque commémorative en souvenir des 80 ans de l’Opération Reinhardt. Ce monument, conçu par Jerzy Kalina est le projet commun entre le musée du Ghetto de Varsovie, le maire de Józefów, Roman Dziura et Paweł Byra, président de l’Association des anciens élèves du lycée de Józefów. Lors de la cérémonie, en présence d’autorités politiques (polonaises et allemandes), associatives et religieuses (juives et catholiques), il fut fait mention de l’importance de lier le passé au futur et de travailler à un meilleur vivre-ensemble dans un esprit de tikoun olam. L’évèque Mieczyslaw Cisło rappela les mots de Jean-Paul II condamnant l’antisémitisme.
Une exposition consacrée à l’imprimerie juive dans la région de Lublin a été présentée en novembre 2024, dans le cadre d’un partenariat entre la communauté juive de Varsovie, la Fondation juive de Lublin, le Centre Grodzka Gate – NN Theatre et la Bibliothèque publique municipale de Józefów. L’exposition intitulée « Énigmes de la collection de livres de la Yeshiva de Chachmei Lublin » a été inaugurée à la Bibliothèque.
Des centaines de livres avec des tampons de la yeshiva de Lublin sont présents dans les bibliothèques de par le monde. L’exposition raconte l’histoire de l’imprimerie juive dans les régions de Lublin et de Józefów et le sort de la collection de livres de la yeshiva de Lublin.
Szczebrzeszyn est aujourd’hui une petite ville très calme, avec au centre l’église catholique et l’hôtel de ville. Une communauté juive existait à Szczebrzeszyn dès le XVIe siècle.

La synagogue fut édifiée au XVIIe siècle. Au XIXe siècle, la communauté connut une croissance importante, passant de 1083 (31 % de la population) en 1827 à 2 450 (44 %) en 1897, et devint un centre de rayonnement du hassidisme autour du tsaddik Elimelech Hurwitz. Avant la guerre, 3 200 juifs vivaient à Szczebrzeszyn ; ils furent déportés au mois de mai 1942, à Belzec.
Tout près de la place centrale (rue Sadowa), remarquez un bâtiment très particulier, très élevé, à plan carré avec le toit en pente : c’est la synagogue, devenue aujourd’hui « maison de la culture ». Une plaque indique qu’il s’agit de l’une des plus anciennes synagogues de Pologne. Elle est sous la protection des monuments historiques. Elle fut incendiée en 1940 et reconstruite en 1957.
Un chemin derrière la synagogue conduit au cimetière, totalement intégré à la forêt. Il faut se frayer le passage à travers les fougères et les arbustes pour visiter les tombes souvent anciennes. Au milieu, un monument commémore l’exécution, en ce lieu, des juifs de Szczebrzeszyn.

Zamosc est un magnifique exemple de la Renaissance polonaise. Édifiée aux XVIe et XVIIe siècles par des architectes venus d’Italie, au service des rois Sigismond et Casimir, la ville présente une unité architecturale particulière, avec son hôtel de ville au large perron, sa place centrale, bordée de très belles maisons patriciennes, Renaissance et baroque, et un quadrillage de rues anciennes et étroites qui s’ordonnent autour de l’enceinte et des portes de la ville.
La communauté juive s’est installée à partir de 1588, quand le vovoïde Jan Zamojski fit venir dans sa ville des juifs séfarades d’Italie, d’Espagne, de Turquie, et leur accorda des privilèges. Au XVIIe siècle, ils s’établirent en plus grand nombre encore. Au XVIIIe et XIXe siècles, se développa à Zamosc la Haskalah, le mouvement des Lumières et de l’émancipation venu de Berlin et de Vilna (Vilnius).

Pendant le partage de la Pologne, Zamosc appartint à l’Empire russe. La ville vit naître, en 1851, l’écrivain yiddish Itzhak Leybush Peretz qui y vécut trente-six ans avant de se rendre à Varsovie, mais aussi, en 1870, Rosa Luxemburg, révolutionnaire assassinée à Berlin en 1919. En 1856, 2 490 juifs y vivaient ; en 1921, ils étaient 9 383 (soit 60 % de la population), et juste avant la guerre, 12 000 ; ils furent tous déportés à Belzec en avril et mai 1942.
Autour des rues Zamenhofa et Pereca se trouve l’ancien quartier juif. La synagogue de la rue Zamenhofa, au numéro 9, a été édifiée en 1610-1620 dans le style de la Renaissance tardive polonaise, comme d’autres bâtiments importants de Zamosc. Détruite pendant la guerre, restaurée dans les années 1950-1960, puis 1980, elle a conservé son portail Renaissance. Jusqu’en 2011, c’était une bibliothèque publique, elle a depuis été entièrement restaurée et rendue comme lieu de culte à la communauté juive. À côté de la synagogue se trouvaient la maison communautaire (dom Kahakny) et un mikveh de 1877.
Itzhak Leybush Peretz
Itzhak Leybush Peretz (Icchok Leib Perec en polonais) est considéré, avec Scholem Aleïkhem en Mendel Moïkher Sforim, comme l’un des auteurs classiques de la littérature yiddish. Né en 1851 à Zamosc, il commence à écrire en polonais puis en hébreu, et opte en 1888 pour le yiddish qui était alors considéré comme un jargon, le mameloshn. Il exerce pendant dix ans sa profession d’avocat, puis « monte » à Varsovie où il développe la culture yiddish et fonde un quotidien, Der Veg. Son convoi funèbre, en 1915, est suivi par 100 000 personnes. Ses Contes hassidiques ont été traduits en français en 1980 aux éditions Stock. L’écrivain Georges Perec, dont les parents étaient originaires de Lubartów, près de Lublin, affirmait être un arrière-petit-neveu de Peretz (cf. W ou le Souvenir d’enfance, Paris, Gallimard, 1993).

Si une halte s’impose sur la route de Lublin à Varsovie, c’est dans la ville de Kazimierz Dolny, sur la Vistule, tout d’abord parce que c’est une belle ville touristique, aux maisons anciennes avec un magnifique rynek bordé de façades Renaissance ou baroques, une grande église, un château, mais aussi parce qu’elle a été marquée par une présence importante de la communauté juive dont il reste quelques traces remarquables, notamment la synagogue du XVIIIe siècle, juste derrière la grande place, au numéro 4 de la rue Lubelska. Reconstruite après la guerre, elle est aujourd’hui transformée en cinéma. Sur l’un des murs, une plaque rappelle la mémoire des 3 000 juifs de Kazimierz Dolny assassinés par les Allemands.
À la sortie de la ville, si vous prenez la route en direction d’Opole Lubelskie, vous apercevrez ce qui reste de l’ancien cimetière juif, rue Czerniawy. À flanc de colline, envahi par la forêt, il y reste encore quelques belles tombes encore debout, ainsi qu’un monument, très expressif, au bord de la route, fait de dizaines ou de centaines de morceaux de tombes détruites.

Dernière ville polonaise avant la frontière ukrainienne, ancienne forteresse autrichienne qui ne parvint pas à tenir tête aux Russes pendant la Première Guerre mondiale, Przemysl fut aussi une ville à forte communauté juive mentionnée dès le XIIe siècle.
Avant la Seconde Guerre mondiale, 20 000 juifs y vivaient, soit 40 % de la population. En septembre 1939, après quelques jours d’occupation allemande, Przemysl fut donnée à la zone d’occupation soviétique. Les Russes déportèrent ou évacuèrent 7 000 juifs vers l’intérieur de l’Union soviétique. En juin 1941, les Allemands occupèrent la ville, créèrent un ghetto et déportèrent ses habitants tout d’abord à Belzec, puis à Auschwitz.
Le quartier juif s’étendait sur les pentes de la « montagne du château », entre le San (la rivière), la place du marché et la rue Jagiellonska. La plus vieille synagogue de Przemysl, construite en 1579 par un architecte italien, se trouvait à l’angle des rues Zydowska et Jagiellonska. Une autre s’élevait sur les bords du San ; une autre encore, la nouvelle synagogue Scheinbach, rue Slowackiego, est aujourd’hui une bibliothèque.
La synagogue de la place de l’Union de Brest a été une première fois érigée au XVIIIe siècle et reconstruite en 1963. Près de la forteresse, un monument commémore le lieu où furent exécutés des juifs du « petit ghetto » de Przemysl.
Dans le cimetière, rue Slowackiego, a été posée une plaque commémorant les exécutions de masse des années 1941-1945.
Lancut est une petite ville agréable connue pour son château Renaissance ayant appartenu aux Lubomirski.

Elle possède aussi une synagogue baroque, l’une des plus belles de Pologne. Construite en 1761, détruite pendant la guerre, reconstruite dans les années 1960, elle a longtemps servi de musée régional. Puis, dans les années 1980-1990, elle a été totalement restaurée, y compris la magnifique décoration intérieure, la bimah et l’aron ha-kodesh où sont conservées les Tables de la Loi. Elle abrite aujourd’hui un musée du judaïsme.
Rue Traugutta, sur le lieu de l’ancien cimetière, une plaque commémore l’exécution de centaines de juifs pendant l’occupation allemande.
Les juifs s’installèrent à Rymanów à une époque tellement lointaine qu’il n’y a pas de document mentionnant leur arrivée. Aux XVe et XVIe siècles, les habitants de la ville vivaient principalement de la culture des vignes et du commerce du vin, activité dans laquelle la communauté juive tenait une place prépondérante. En 1765, 1000 juifs vivaient à Rymanów, soit 43 % de la population.

Au XVIIIe siècle, Rymanów devient un centre du hassidisme en Galicie occidentale, sous l’influence du tsaddik Menahem Mendel (dit Mendel de Rymanów), qui fut élève d’Elimelech de Lyzhansk et de Shmelke Horowitz de Nikolsburg (Mikulov).
Au XIXe siècle, les juifs de Rymanów travaillaient principalement dans le commerce et le prêt. La découverte de sources chaudes fait de la ville un haut lieu du tourisme thermal. La communauté juive profite de cet essor.
Les Allemands pénètrent dans la ville en septembre 1939. À partir de 1940, des juifs des villes alentours (dont Cracovie) sont déportés à Rymanów, la population juive atteint conséquemment 3000 âmes. Le ghetto de Rymanów fut officiellement établi en 1941. En 1942, la population juive fut soit déportée dans les camps de la mort de Plaznow ou de Belzec, soit fusillée sur place. Environ 300 juifs de Rymanów survécurent à la guerre, 20 d’entre eux rescapés des camps, le reste ayant fui en Union soviétique, ou cachés par des habitants de la région.
La synagogue , fut construite avant 1712, sans que sa date exacte d’érection soit connue. Située tout près du rynek, dans la rue Piekna, à l’angle de la rue Kilinskiego, elle témoigne, par son importance architecturale, de la place qu’avait la communauté juive dans la ville. Construite en pierre et en brique, elle s’intégrait dans le système de défense de la ville. Le bâtiment fut reconstruit au XIXe siècle. On y ajouta une galerie des femmes, détruite dans les années 1950. La synagogue a été restaurée en 2005.
Le cimetière juif de Rymanów est en excellent état grâce au travail d’entretien et de conservation pratiqué par des habitants locaux. Situé rue Slowackiego, il est conseillé d’appeler avant de le visiter. En 2007, on y a retrouvé une tombe datant de 1615, la plus ancienne découverte à ce jour. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il fut le lieu où les juifs étaient exécutés par balles.
L’héritage du rabbi Elimelech
« Sur son lit de mort, rabbi Elimelekh posa ses mains sur le front de ses quatre disciples préférés et partagea entre eux son héritage. À rabbi Yaakov Yitshak, il donna le pouvoir de ses yeux ; à rabbi Abraham Yehoshoua, la force de justice de ses lèvres ; à Israël de Kosnitz, ce fut la vertu orante de son cœur. Quant à rabbi Mendel, il lui donna le pouvoir de discuter de son esprit.
Martin Buber, Les Récits hassidiques (Vol.2), Paris , Seuil, 1996.

La petite ville de Lesko possède l’une des plus belles synagogues fortifiées de la région, construite aux XVIe et XVIIe siècles, avec une tourelle qui lui donne l’allure d’un petit château. Détruite pendant la guerre, elle a été reconstruite en 1980 ; la décoration intérieure de style maniériste a été refaite, ainsi que la porte de fer du XVIIIe siècle et l’aron ha-kodesh. Elle abrite aujourd’hui un bureau touristique et une galerie d’art.
Le cimetière de Lesko est presque en face de la synagogue. Il date du XVIIe siècle, est très grand et contient un grand nombre de tombes anciennes avec de très beaux motifs décoratifs.
Les juifs s’y établirent dès le XVe siècle et édifièrent deux synagogues au XVIIe siècle, qui subsistent toutes les deux, presque côte à côte. Elles sont assez facile à trouver, car elles sont situées en plein centre-ville.

La synagogue Stara (« Vieille ») du tout début du XVIIe siècle, abrite aujourd’hui les archives de la ville. Elle n’est pas très grande, bien restaurée extérieurement et une étoile de David a été laissée sur l’un des murs.
La synagogue Duza (« Grande ») date de 1686. Elle est plus imposante, avec de gros murs porteurs renforcés par des sortes de piliers lui donnant une allure de forteresse. reconstruite dans les années 1960, elle abrite aujourd’hui un bureau d’expositions artistiques, présentées dans la grande salle, et un café, à l’étage, dans la galerie pour les femmes. Il n’est donc pas difficile d’entrer et de visiter le lieu, de s’imaginer ce que fut l’intérieur avant la guerre, quand 14 000 juifs habitaient Rzeszow. Ils furent tous déportés à Belzec ou à Auschwitz.
Au fil du temps et souffrant des conflits territoriaux entre les grandes puissances de la région, les juifs réussirent toutefois à participer à la vie active de Rzeszow, principalement dans le commerce, leurs droits de propriété étant limité aux habitations. De nombreux commerces ouvrirent au centre-ville. A tel point qu’à la fin du 18e siècle Rzeszow fut surnommée « la Jérusalem de Galicie » par l’universitaire Bredetzki.

Les juifs furent enregistrés dans un registre d’Etat particulier avec des noms de famille indiquant souvent leur origine comme Krakowski, ou des noms liés à des métiers comme Tabachnik.
Grâce à un mouvement d’émancipation et d’égalitarisme en 1848, les juifs obtinrent enfin les mêmes droits et participèrent aussi à la vie politique de la ville. La confirmation de cette évolution ne se fit qu’une cinquantaine d’années plus tard, certains dirigeants revenant de temps à autres sur les avancées.
En 1860, les Juifs purent ainsi acheté un terrain pour leur nouveau cimetière, des champs et autres terrains. Ils avaient avant cela développé les industries de la confection et de la bijouterie. Ils rencontrèrent dans ce domaine là un certain succès régional, leur bijoux se vendant même dans des lieux aussi éloignés que Livourne ou Alexandrie.
La démocratisation de l’accès aux métiers permit à de nombreux juifs de se lancer dans l’agriculture et l’urbanisme, exportant des œufs ou modernisant les systèmes de canalisation de la ville. La population juive passa de 3 375 en 1800 à plus de 8 000 en 1910 (ce qui représentait plus d’un tiers de la population totale).
Le mouvement de la Haskalah connut un beau succès à Rzeszow. Parmi les célèbres éclairés on peut citer Abba Apfelbaum, journaliste et auteur de biographies sur le judaïsme italien, ainsi que Moshe David Geschwind, journaliste, traducteur d’hébreu et de yiddish et secrétaire de la communauté pendant trente ans. Autre journaliste, Leon Weisenfeld, publiant dans les journaux polonais, qui créa le journal « Yiddishe Volkszeitung » et fut l’auteur de trois romans.
Également connu sur la scène nationale, le Docteur Wilhelm Turteltaub, un expert de la littérature allemande. Tout en poursuivant ses études de médecine, il écrivit de célèbres pièces de théâtre qui furent jouées en Allemagne.
L’hassidisme prit également de l’ampleur, grâce aux élèves du rabbin Elimelech de Lizhensk, d’où la construction d’une seconde synagogue au 19e siècle. Son livre « Noam Elimelech » influença le développement du mouvement dans toute la région de la Galicie. Un hôpital, une maison de retraite et des institutions culturelles virent le jour à cette époque.

Dès 1934, des soutiens du régime nazi, qui n’envahira la Pologne que cinq ans plus tard, commencèrent à vocaliser un certain antisémitisme. Au début de la Seconde Guerre mondiale, ce chiffre fut proche de 15 000, une augmentation causée par la réinstallation de juifs par l’armée allemande. Les occupants y construisent un ghetto de plus de 20 000 personnes.
Lors de l’invasion, les troupes allemandes n’eurent pas de suite une attitude hostile. Ils attendirent les célébrations de Rosh Hashanah et Kippour 1939 pour identifier les juifs sortant des synagogues et les forcèrent à plonger dans les eaux profondes de la rivière Wislok. De nombreuses mesures très dures furent mises en place à l’égard des juifs. Travail forcé, synagogues détruites, famine, exécutions sommaires…
La grande majorité des juifs de Rzeszow furent déportés ou tués dans les bois. Seuls quelques centaines survécurent à la Shoah. La petite communauté reconstituée après la guerre de 300 personnes érigea un monument à la mémoire des victimes.
L’ampleur des massacres à Rzeszow motiva de nombreux juifs ayant pu fuir avant la Shoah et leurs descendants à effectuer des recherches généalogiques afin de retrouver des proches, ou plus généralement des noms de victimes. La génération de survivant préférant parfois ne pas se retourner et évoquer les atrocités afin de pouvoir se reconstruire, leurs descendants sont très impliqués dans ces recherches.
En décembre 2023, Rzeszow a rendu hommage au grand réalisateur Fred Zinnemann. Celui qui a notamment tourné les films High Noon, From Here to Eternity et The Day of the Jackal, est né en 1907 dans cette ville. Une plaque commémorative a été posée au Marquet square 3, l’immeuble où il vécut avec sa famille, en présence de son fils Tim Zinnemann et du maire de la ville, Konrad Fijołek. Lequel rendit hommage lors d’un discours à l’apport des juifs à la vie Culturelle et économique de Rzeszów.
Nous avons rencontré l’expert en généalogie Philip Trauring, dont les ancêtres sont issus de cette ville. Il a créé plusieurs sites de référence et participe à de nombreux projets de conservation du patrimoine juif.
Jguideeurope : Qu’est-ce qui vous a motivé à créer le site de référence B&F: Jewish Genealogy and More ?
Philip Trauring : B&F: Jewish Genealogy and More a commencé comme un simple blog où je pouvais partager des connaissances sur la généalogie juive. J’avais fait des recherches sur ma propre famille pendant un certain nombre d’années et j’avais commencé à faire du bénévolat dans une société de généalogie locale, mais je sentais qu’un site Web m’offrait le moyen le plus simple d’aider un maximum de gens. En 2016, après avoir réalisé que je cherchais les mêmes choses encore et encore en aidant les gens, j’ai décidé de créer un index des ressources en ligne. J’ai ajouté le Compendium B&F de généalogie juive avec des ressources de généalogie juive pour plus de 200 pays et territoires, ainsi que 1 400 villes en Pologne. C’était une entreprise majeure, et cela demande beaucoup de travail pour rester à jour. Maintenant, lorsque les gens me demandent de l’aide pour rechercher d’où vient leur famille, je peux simplement leur envoyer les liens pertinents. Surtout, le site permet également aux utilisateurs de laisser des commentaires sur les ressources pour aider les autres qui pourraient les utiliser à l’avenir.

Concernant la Pologne, vous offrez plus de 20 000 ressources. Comment expliquez-vous une telle disponibilité ? Est-ce un phénomène récent ?
Une partie de la raison pour laquelle j’ai choisi la Pologne pour étendre les ressources au niveau des villes était que je sentais que je pouvais trouver suffisamment de ressources pour couvrir de nombreuses villes en Pologne. Cela ne fonctionnerait pas si j’ajoutais plus d’un millier de villes, mais la plupart n’avaient qu’une ou deux ressources. Mon objectif était de faire une moyenne de dix ressources par ville. J’ai cherché des sites qui avaient des ressources étendues sur les villes, et je me suis assuré que j’avais un certain nombre de sites qui avaient tous des ressources pour des centaines de villes. J’ai ensuite construit ma liste de villes, qui totalisent maintenant plus de 1 400, où les Juifs avaient vécu en Pologne.
Construire uniquement la liste des villes a été difficile, car ce n’est pas parce qu’une ville a été mentionnée dans un document que je peux confirmer son emplacement. De nombreuses villes de Pologne portent le même nom, de nombreux noms ont changé au fil du temps et de nombreux villages sont devenus des quartiers de grandes villes. Cependant, passer du temps à confirmer les villes m’a permis d’avoir une liste très précise des villes qui constituent la base des ressources polonaises.
Quelle découverte à Rzeszow vous a le plus surpris ?
La majeure partie de la famille élargie de mon père vivait à un moment donné à Rzeszów. Ses deux parents y vivaient quand ils étaient enfants, et les deux avaient des membres de la famille qui y retournaient plusieurs générations. Rzeszów, ou Reisha comme l’appelait la communauté juive, occupait une place importante parmi les Juifs de Galice. J’ai fait quelques recherches sur la centralité de Rzeszów en examinant les actes de mariage dans les archives de Rzeszów et en voyant d’où venaient les conjoints des autres villes. Les actes de mariage comprenaient les actes des villes d’où venaient les conjoints, y compris fréquemment leurs actes de naissance. Chaque communauté avait un timbre officiel, et les rabbins de ces communautés avaient également un timbre officiel, et j’ai rassemblé bon nombre de ces timbres dans un article qui montre les villes connectées à Rzeszów à travers ces enregistrements.

Quels sont les projets en cours pour restaurer le patrimoine de Rzeszow?
Il y a un mémorial annuel à Rzeszów, qui dure depuis 12 ans. Vous pouvez voir une vidéo du plus récent mémorial sur YouTube Elle a lieu dans l’un des cimetières juifs qui se trouve aujourd’hui juste à côté de l’université. Il y a un groupe Facebook appelé In Memory of Jewish Rzeszów qui a des gens qui travaillent sur un projet pour restaurer ce cimetière et en faire un lieu de souvenir au lieu d’un terrain clos pour la plupart vide.
Votre travail concernant la ville de Kańczuga est également très partagé. Y a-t-il un lien personnel à cette ville également ?
Mon arrière-arrière-grand-père vivait à Rzeszów, mais était en fait né à Kańczuga, une petite ville non loin de là. Au fil des ans, j’ai essayé diverses façons de rester en contact avec d’autres descendants de Kańczuga, y compris une liste de diffusion, une page Facebook, et au centre de celle-ci le site Web Kanczuga.org où je poste régulièrement des mises à jour sur la recherche. Alors que Rzeszów était la plus grande ville de la région, Kańczuga a servi de centre parmi les petits villages de sa région (j’en énumère environ 20 sur ma page concernant les villages environnants). J’essaie d’inclure ces villages dans mes recherches car ils se chevauchent avec Kańczuga. Grâce à ce groupe de descendants, nous avons financé la recherche dans les archives locales et aidé à restaurer le cimetière juif. Récemment, un natif non juif de Kańczuga, Patryk Czerwony, qui a déménagé aux États-Unis quand il était enfant, a aidé à organiser des projets pour commémorer la communauté juive et nous avons travaillé avec lui pour réaliser certains de ces projets.
À Tarnów, la moitié de la population était juive : entre 20 000 et 25 000 personnes occupées principalement dans les métiers de la confection et de la chapellerie (une soixantaine d’entreprises), l’artisanat et le commerce. Certains étaient de riches marchands, des avocats, des médecins, et se faisaient construire de belles maisons qui dominent encore la rue Walowa. D’autres, plus pauvres, se concentraient surtout dans les quartiers populaires autour de la rue Zydowska, des rues Warynskiego, Lwowska, Szpitalna. Des intellectuels de renom sont nés à Tarnów ou y ont vécu, comme l’écrivain Adolf Rudnicki (1912-1990), bien connu en France, chantre du ghetto de Varsovie (Les Fenêtres d’or, Paris Gallimard, 1966).
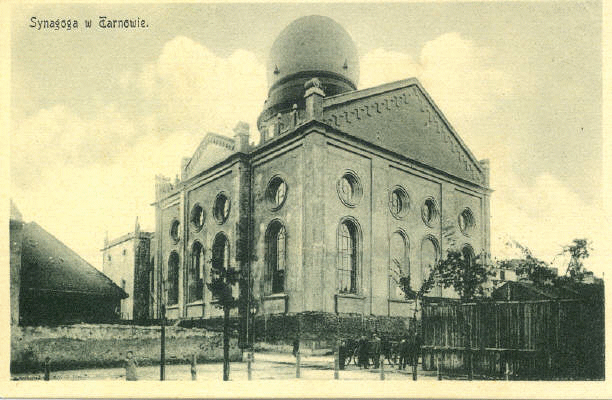
Le vestige le plus important, mais aussi le plus « dérisoire » de cette ancienne vie juive est la bimah de la vieille synagogue de la rue Zydowska : la synagogue elle-même a été rasée et il n’en subsiste qu’un espace vert, au milieu duquel se trouve cette ancienne bimah de pierre, qui fait penser à une fontaine.
Derrière la bimah, prenez la rue Rybna et remarquez les anciennes maisons juives aux cours parcourues de galeries à l’étage. Au-delà de la rue Walowa, se tenait, dans la rue Goldhammer, la maison de prière de la communauté juive, où les offices n’ont plus lieu depuis 1980, faute de minyan. Un peu plus loin, dans ce qui fut le ghetto, se trouve la place Wiezniow Oswiecima (« des Prisonniers d’Auschwitz ») et la place Bohaterow Getta (« des Héros du Ghetto ») où s’élève un monument aux victimes de l’Holocauste, non loin de l’ancien mikveh devenu établissement de balnéothérapie.

En empruntant la rue Nowodabrowska, vous parvenez au cimetière juif , dans la rue Sloneczna. Il date de 1583 et est l’un des plus anciens de la région. Il est encore ouvert, bien que dévasté : les tombes les plus riches ont été détruites ou volées. À l’entrée, s’élève une colonne provenant de la Nowa (« Nouvelle Synagogue ») et commémorant le massacre de 25 000 juifs de Tarnów, à l’emplacement où eurent lieu les premières exécutions de masse, le 11 juin 1942.

En 1335, le roi Casimir le Grand fonda à proximité de Cracovie une ville indépendante : Kazimierz, dans laquelle il autorisa les juifs à s’établir autour de la rue Sukiernikow (« rue des Drapiers », aujourd’hui rue Jozefa), à côté du quartier chrétien.
Ils y édifièrent la synagogue Stara, un mikveh, un hôtel et une maison de mariage, dans la rue principale appelée Szeroka (« Large »). Au XVIe siècle, un grand nombre de juifs arrivèrent de Bohême. À partir de 1553, les juifs achetèrent le terrain situé entre la rue Waska (« Étroite ») et l’enceinte de la ville, pour y construire des maisons d’habitation, ainsi que celui de la rue Jakuba pour y établir le cimetière et la synagogue Rema. Il y avait alors trois portes qui donnaient dans le quartier juif : une près de l’enceinte de la ville et la synagogue Stara, l’autre près du cimetière, et la troisième dans la rue Jozefa, entre ville chrétienne et ville juive. C’est à l’emplacement de cette porte qu’on éleva bientôt la synagogue Wysoka (« Haute »).

En 1564, les juifs obtinrent du roi Sigismond Auguste le privilège de non tolerandis christianis : les chrétiens ne pouvaient acheter de terrains dans ces rues, et, inversement, les propriétaires chrétiens ne pouvaient vendre de parcelles à d’autres que des juifs. En 1635, toutes les parcelles du quartier Kazimierz situées dans ces quelques rues étaient juives.
Au XVIIe siècle, l’accroissement de la communauté juive imposa d’édifier de nouvelles synagogues : la synagogue Popper, fondée en 1620 par le riche marchand Wolf Bocian, dans la rue Szeroka, la synagogue Ajzyk en 1644, du nom de son fondateur Isaac Jakubowicz, et la synagogue Kupa. À cette époque, Kazimierz était l’une des grandes villes juives d’Europe, avec 4500 habitants contre 5000 dans la partie chrétienne de la ville. Comme à Cracovie, les juifs aisés de Kazimierz firent venir des architectes pour édifier de nouvelles maisons de pierre, ou pour reconstruire la synagogue Stara, détruite par le feu en 1557.
Après le partage de la Pologne, Cracovie et la Galicie furent annexées à l’Autriche. En 1800, l’administration autrichienne réunit Kazimierz à Cracovie. À partir de 1867, la constitution austro-hongroise mit fin aux discriminations contre les juifs et leur permit même de choisir librement leur lieu d’habitation. Les juifs les plus pauvres et les plus religieux demeurèrent à Kazimierz, dans les frontières de l’ancien ghetto. Les plus émancipés construisirent leur synagogue réformée, le Temple, dans la rue Miodowa, à l’extérieur de ces limites.
Pendant l’Occupation, le ghetto de Cracovie subit le même sort que les autres ghettos polonais. Il fut « liquidé » en 1943, ses habitants exterminés à Belzec ou dans le camp de Plaszow.
Le quartier juif de Cracovie, Kazimierz, est le mieux conservé de toute la Pologne. Son intérêt culturel et touristique est considérable. Longtemps à l’abandon, refoulé de la conscience des Polonais après la disparition de ses habitants, il a resurgi en tant qu’entité à forte valeur patrimoniale à la faveur du tournage du film de Steven Spielberg, La Liste de Schindler (1994). Et depuis 1991, la ville organise chaque année un festival de la culture juive. Pour préparer votre visite, vous pouvez vous rendre au centre de la communauté juive de Cracovie.
Les chants de Mordechaï Gebirtig
Mordechaï Gebirtig, né en 1877 à Kazimierz, a été le plus talentueux des chanteurs-auteurs-compositeurs yiddish du XXe siècle. Il était menuisier dans le ghetto de Cracovie, où il fut assassiné en 1942. Ses chants nostalgiques, tel Kinderyorn (« Années d’enfance ») résonnent encore à nos oreilles. En 1938, il composa une chanson prémonitoire, Unzer Shtetl brent (« Notre shtetl brûle »), qui allait devenir un hymne pour les combattants : « Il brûle, petit frère, il brûle ! Oh, notre pauvre shtetl brûle. »
Kazimierz
La visite commence par la rue Miodowa (« du Miel »), d’où l’on entre dans la rue Szeroka, rue centrale du ghetto. À l’angle des deux rues, se trouve le beau bâtiment de l’ancien mikveh, datant de 1567.

La rue Szeroka est, en fait, une très grande place rectangulaire, autour de laquelle s’agencent la plupart des édifices de la communauté, le cimetière et la synagogue Rema sur la droite, la synagogue Stara tout au bout, la synagogue Popper sur la gauche, les maisons et restaurants juifs. Au centre de la place, le petit parc est entouré d’une grille faite de chandeliers à sept branches. Le reste de la place est devenu un parking.
La Vieille synagogue fut édifiée au XVe siècle en style gothique, inspirée par celles de Worms, Prague et Ratisbonne, elle fut reconstruite dans un style Renaissance par le Florentin Matteo Gucci, après l’incendie de 1557. Elle abrite aujourd’hui le musée d’Histoire et de la Culture des Juifs de Cracovie. L’intérieur est magnifique et restitue parfaitement l’atmosphère d’une vieille synagogue, avec en particulier, au centre, une bimah circulaire, réalisée en fer forgé, sorte de temple dans le temple. Sur les côtés et dans les pièces adjacentes à la salle de prière, sont exposés des oeuvres d’art et objets de culte, ainsi que des photographies figurant l’ancien Kazimierz. Non loin se situe le Musée de Galicie , qui met en avant le patrimoine culturel juif de la région. Il a été créé à l’initiative d’un photographe anglais et a été inauguré en 2004. Des expos consacrées à la Galicie juive y sont montrées. On y trouve également un charmant salon de thé.

Fondée en 1620, l’ancienne synagogue Popper est située au fond de la cour. Elle a été détruite pendant la guerre, puis reconstruite et finalement transformée en un centre d’art pour enfants et adolescents. À l’entrée de la cour de la synagogue, se trouve le café galerie Ariel et un café restaurant juif.
La maison de Landau date du XIVe siècle, c’est l’une des plus vieilles et des plus grandes maisons de pierre du quartier juif. Son architecture est particulière et attire immédiatement l’attention. À l’intérieur, il y a un café et la librairie juive Jarden qui propose des guides sur Kazimierz et organise des visites guidées sur les lieux de tournage de La Liste de Schindler.

La synagogue Rema est la seule en activité actuellement. Elle fut fondée en 1553 par Israël ben Josef Isserles, venu de Ratisbonne, et porte le nom de son fils, le philosophe et célèbre rabbin Moses Isserles (1525-1572), dit Reb Moses ou Rema. Sa porte d’entrée monumentale est aussi celle du cimetière ! Cette synagogue forme en effet avec celui-ci un important ensemble de l’architecture juive du XVe siècle, comparable à l’Altneuschul et au cimetière de Prague. À l’intérieur, elle est relativement petite. Elle possède, elle aussi, une bimah en fer forgé. Le cimetière date de 1533. Avec celui de Lublin, c’est le plus vieux cimetière juif de Pologne. Il mérite une visite attentive. On y trouve de nombreuses tombes de personnalités célèbres en leur temps, notamment de Moses Isserles et de sa famille, mais aussi d’Eliezer Achkenazi, rabbin au Caire puis à Poznan, de Nathan Spira, rabbin et cabaliste, de Yomtov Heller, rabbin à Vienne, Prague, Nemirov et Cracovie, directeur de la yeshiva, etc. La tombe de Moses Isserles, juste derrière la synagogue, est l’une des plus remarquables : elle est couverte de cailloux que les visiteurs laissent en signe d’hommage. Un peu plus loin, le cimetière s’élève, formant une colline qui est en réalité une accumulation de tombes. Le mur du cimetière, près de l’entrée, est constitué de pierres tombales cimentées. Les récentes rénovations permettent de mieux apprécier les fresques.
En reprenant la rue Szeroka jusqu’au bout, vous arrivez à la rue Jozefa, où vous découvrez, au numéro 38, face à une petite place, à l’intersection avec la rue Waska, la synagogue Wysoka (« Haute ») qui doit son nom au fait que la salle de prière se trouvait au premier étage. Construite entre 1556 et 1563, elle a été détruite par les Allemands, reconstruite après la guerre et donnée au Monuments historiques. Belle à l’extérieur, il ne reste plus grand chose à l’intérieur.

Depuis la rue Jakuba, vous apercevez l’arrière de la très impressionnante synagogue Ajzyk , à l’angle de la rue Izaaka, qui fait face au mur du cimetière. Elle date de 1638 et a été fondée par un riche marchand, Isaac Jacubowicz (dit reb Ajzyk ben Jekeles). Sa façade à l’escalier monumental donne sur la rue Kupa. Détruite par les Allemands, reconstruite aujourd’hui, elle est un lieu de mémoire qui abrite une exposition sur les juifs de Pologne et où sont programmés de nombreux films sur Kazimierz.
La synagogue Kupa se trouve au bout de la rue Kupa, dans la rue Warszauer. Construite au début du XVIIe siècle à l’emplacement de l’enceinte extérieure du ghetto, elle a été magnifiquement restaurée et abrite des concerts de musique. Elle contient de belles peintures représentant des villes de Palestine. Vous parvenez ensuite sur la place Nowy (« Nouvelle »), très pittoresque, appelée aussi « Place juive », où s’élève un marché couvert de forme circulaire, ou okraglak, dans lequel avait lieu l’abattage rituel. Au numéro 6 de la rue Estery, se trouvait l’école Talmud Torah.
En continuant dans la rue Meiselsa, vous découvrez au numéro 15 une magnifique cour intérieure de maison juive, avec des galeries parcourant le premier étage, et un porche donnant sur la rue Jozefa, avec, en arrière-plan, le clocher de l’église du Très-Saint-Corps-du-Christ. Dans cette cour (entrée par le 12 rue Jozefa), fut tournée l’une des scènes de La Liste de Schindler. Par la rue Bozego Ciala, revenez à la rue Miodowa avec, à l’angle de la rue Podbzezie, la synagogue réformée Templ , remarquable par ses beaux vitraux.

À l’autre bout de la rue Miodowa, derrière la voie ferrée, se trouve le nouveau cimetière juif . Il fut créé en 1800, après la fermeture du cimetière Rema. Immense, il donne par son ampleur une idée de celle de la communauté juive avant guerre. À l’entrée, un monument fait de nombreuses tombes et de plaques commémoratives est élevé en mémoire des victimes de la Shoah.
De l’autre côté de la Vistule, en prenant la rue Starowisla, vous parvenez à ce qui fut le ghetto sous l’occupation allemande, autour de la place Bohaterow Getta (« des Héros du Ghetto ») et des rues Lwowska, Josefinska et Limanowskiego. Vous pouvez visiter le musée situé dans la pharmacie Pod Orlem , dont le propriétaire, Tadeusz Pankiewicz, a beaucoup aidé les juifs du ghetto. Remarquez, dans la rue Lwowska, un fragment du mur du ghetto , semblable à une allée de tombes. Plus loin encore, à Plaszow (rue Kamienskiego), s’élève un monument en l’honneur des victimes du camp de concentration établi en cet endroit, déportées du ghetto de Cracovie.
Le JCC a été inauguré en 2008, lors d’une cérémonie officielle, par le Prince de Galles. Le centre fournit des services sociaux et éducatifs à la communauté juive de Cracovie. Mais il a aussi des objectifs différents. Tout d’abord, participer à la résurgence de la vie juive à Cracovie et favoriser les relations polono-juives. À ces fins, il était également important de prévoir un lieu symbolique, au cœur du quartier juif historique de la ville, Kazimierz. Le Centre communautaire juif a toujours été très impliqué, mais avec la guerre menée par la Russie en Ukraine, son rôle a évolué bien au-delà du culturel et social, aidant notamment les réfugiés ukrainiens suite à la guerre menée par la Russie dans leur pays.
Le JCC et ses partenaires ont aidé plus de 80 000 Ukrainiens au cours des quatre premiers mois de l’attaque russe, et continuent de le faire. Il s’agit aussi bien de réfugiés qui ont fui vers la Pologne que d’Ukrainiens de l’autre côté de la frontière, sans faire de différence entre les appartenances culturelles et cultuelles. Le JCC sert de point de distribution de nourriture, de médicaments, de jouets, de vêtements…
Le 26 janvier 2025, une cérémonie marqua les 80 ans de la libération d’Auschwitz, en présence de 17 survivants. L’importance de la transmission de la mémoire fut soulignée, ainsi que les craintes de la montée exponentielle des actes antisémites dans le monde depuis le pogrom du 7 octobre 2023 en Israël.

De Bialystok, un détour à Tykocin s’impose : elle a en effet conservé la structure et l’architecture d’un ancien shtetl. Cette ville, toute petite aujourd’hui, était jadis plus importante que Bialystok, avec une communauté juive plus grande et plus ancienne : elle remonte à 1522 et fut, aux XVIIe et XVIIIe siècles, l’une des plus éminentes de Pologne. Comme Bialystok, Tykocin fit partie en 1939 de la zone d’occupation soviétique rattachée à la Biélorussie. En août 1941, les Allemands y exécutèrent 1 400 juifs et envoyèrent les autres au ghetto de Bialystok, dans lequel étaient enfermés 50 000 de leurs frères. En novembre 1942, Mordechaï Tenenbaum, venu de Varsovie, a commencé à organiser la résistance. Le ghetto fut « liquidé » à partir de février 1943 et le soulèvement armé fut écrasé. Tous les habitants du ghetto furent exterminés à Treblinka et Maïdanek.

Sa magnifique synagogue, édifiée en 1642 dans le style Renaissance et baroque, est toujours là, très remarquable, très haute, avec son corps de Renaissance tardive et son toit baroque. Elle a été restaurée et transformée en musée du Judaïsme. L’intérieur est splendide, avec une grande bimah et des fresques représentant des animaux exotiques, des inscriptions en belles lettres hébraïques et des stucs.
En face du musée, au numéro 4 de la rue Kozia, le restaurant Tejsza propose de la cuisine juive. Derrière le musée, ne manquez pas les anciennes maisons juives des rues Kozia, Kaczowska et Pilsudskiego.
De Treblinka, au lieu de rentrer le soir à Varsovie, vous pouvez vous rendre à Bialystok, près de la Biélorussie, ville à très forte tradition juive, au point qu’en 1913, les juifs étaient au nombre de 61 500 et représentaient 70% de la population.
Des 100 synagogues et maisons de prière -dont les trois principales étaient la Groyse Shul, dans la rue Szkolna, la Chorszul (Synagogue chorale ») dans la rue Zydowska et la synagogue Pulkowa-, il ne reste pratiquement plus rien à voir, sauf la synagogue au numéro 3 de la rue Piekna, du XIXe siècle, aujourd’hui maison des jeunes et de la culture.
Chelmno, située au bord de la Ner, un affluent de la Warta, dans la région que les Allemands avaient appelée Watherland, est la ville où furent expérimentés, dès 1941, les « camions à gaz », première forme de ce qui allait devenir plus tard des chambres à gaz. Les juifs étaient rassemblés dans l’église catholique, et de là on les mettait dans des camions bien fermés dont le pot d’échappement était tourné vers l’intérieur. Le nombre de kilomètres entre le bourg et la forêt, et la vitesse du camion étaient calculés de telle sorte qu’à l’arrivée, les juifs fussent déjà morts étouffés, il n’y avait plus qu’à les enterrer dans des fosses déjà creusées. La plus grande partie du ghetto de Lodz a ainsi été exterminée à Chelmno.
C’est à Chelmno que commence le film de Claude Lanzmann, Shoah. On y voit un homme, Simon Srebnik, l’un des rares survivants, retrouver les lieux où, adolescent, il chantait pour les Allemands pendant que ceux-ci faisaient leur triste besogne. Son talent de chanteur lui permit d’être épargné et tous les paysans polonais se souviennent de lui.
L’église de Chelmno existe toujours, elle surplombe des prés où paissent des animaux le long de la Ner. On attend de voir, comme dans le film de Lanzmann, la barque où navigue le rescapé qui chantait si bien. À l’entrée de l’église, une plaque a été apposée, rappelant le sort des juifs de la région.

À quelques kilomètres de là, dans la forêt, se trouve le camp, c’est-à-dire le lieu d’extermination où l’on creusait de larges fosses communes, de forme rectangulaire, pour y enterrer le chargement des camions à gaz. Un monument a été érigé. Un chemin conduit aux différents emplacements des fosses, bordé de stèles évoquant ce qui s’est passé et rappelant le nom des shtetlekh qui disparurent ici.
Le musée de l’ancien camp d’extermination allemand de Kulmhof, à Chelmno-sur-Ner, est un lieu de mémoire dédié au premier camp d’extermination massive et immédiate de Juifs construit par les Allemands sur les terres polonaises occupées durant la Seconde Guerre mondiale. Ouvert bien avant la conférence de Wannsee, il s’agit de l’unique camp où les victimes furent assassinées dans des camions transformés en chambres à gaz mobiles. Le camp fut temporairement clos avant d’être réouvert. C’est à Kulmhof que bon nombre de fonctionnaires nazis ont acquis l’expérience utilisée ensuite dans les autres camps de concentration et d’extermination bâtis sur le territoire de la Pologne occupée.
Le premier jour de fonctionnement du camp de Kulmhof, on y mit à mort les juifs de la ville voisine de Kolo. Au cours des semaines suivantes, on y exécuta les populations juives des environs du village. À partir de janvier 1942, on commença à faire venir au camp les Roms de Lodz, puis les juifs du ghetto de Lodz, ainsi que des juifs d’Allemagne, de République tchèque et d’Autriche qui, durant cette même période de l’automne 1941, avaient été déplacés à Lodz. Les convois ferroviaires en provenance de « Litzmannstadt » y emmenaient de 700 à 1 200 personnes à la fois. Lors de la seconde période du fonctionnement du camp, les massacres furent perpétrés directement dans la forêt de Rzuchów, toujours dans deux camions-chambres à gaz.
Selon les estimations des chercheurs, 200 000 personnes environ furent assassinées dans le camp de la mort de Kulmhof, parmi lesquelles, outre les populations juives, 4 300 Roms et Sintés originaires de la frontière austro-hongroise, des enfants polonais de la région de Lublin et de Zamosć, un petit nombre de prisonniers de guerre russes et, très probablement, un groupe d’enfants tchèques des villages de Lidice et de Lezaky.
La mission du musée de l’ancien camp d’extermination allemand de Kulmhof est de maintenir la mémoire des victimes du premier camp de la mort nazi et d’exprimer, à travers ce souvenir, le respect de l’histoire et de la culture locale disparue. La sauvegarde de la mémoire est assurée par les activités scientifiques, éducatives et d’exposition conduites par le musée en collaboration avec des institutions polonaises et internationales, mais aussi avec des particuliers.
Se rendre en train à Treblinka rappelle l’horreur du dernier voyage des habitants du ghetto de Varsovie, de l’Umschlagplatz aux chambres à gaz. De Malkinia, pour rejoindre Treblinka, la ligne de chemin de fer forme un aiguillage en épingle à cheveux : le train devait donc s’arrêter et retourner dans l’autre direction, la locomotive poussant les wagons vers le camp, comme l’explique, dans Shoah, le cheminot Henryk Galkowski, conducteur de la locomotive, qui fit le trajet trois fois par semaine pendant un an et demi.

La voie ferrée traverse le Boug, puis une forêt assez épaisse de pins et de conifères. Dans la gare de Treblinka, un train de marchandises, désaffecté, est à quai, rouillé, comme demeuré là depuis le dernier convoi. De la gare, on arrive à l’emplacement du camp, par un chemin qui pénètre dans la forêt et donne sur une rampe de béton imitant des traverses de chemin de fer. Du camp, il ne reste plus rien, tout ayant été détruit par les Allemands pour ne pas laisser de traces ; -il n’y a que des panneaux explicatifs en plusieurs langues.
On arrive enfin sur un grand espace circulaire couvert de pierres tombales symbolisant chacune un shtetl, une petite ville de Pologne avec tous ses juifs engloutis. On y lit des centaines de noms de lieux de la région de Varsovie, de Bialystok, de Vilna, de Minsk Mazowiecki, etc. Une autre pierre est dédiée à « Janucz Korczak et ses enfants ». Au centre, s’élève un édifice de pierre portant l’empreinte d’un chandelier à sept branches. Le lieu est calme et propice au recueillement.

Lodz est une grande ville industrielle polonaise, où se concentraient au XIXe siècle un fort prolétariat juif, ainsi que des marchands et de riches industriels. On a une bonne adaptation de la réalité de la ville de Lodz au XIXe siècle dans le film d’Andrzej Wajda, La Terre de la grande promesse (Ziema obiecana).
Sous l’Occupation, le ghetto de Lodz (plus de 150 000 personnes) était, à l’instar de celui de Varsovie, un camp de concentration au milieu de la ville, où les Allemands déportaient les juifs d’autres villes de Pologne et d’Allemagne. Les Allemands avaient débaptisés la ville en Litzmannstadt. Le Judenrat était dirigé par Chaïm Rumkowski, homme autoritaire et figure contestée de la communauté juive. Les premières déportations vers le camp de Chelmno ont commencé en 1942. La politique de Rumkowski lui a permis de survivre un an de plus que dans les autres villes : en août 1944, en effet, à quelques semaines ou quelques mois de la Libération, tous les juifs qui restaient encore à Lodz, soit 76 700 personnes, ont été déportés et exterminés à Auschwitz. Il ne restait que 800 juifs à la fin de la guerre, et environ 300 aujourd’hui. En arrivant à Lodz, ou pour préparer votre voyage, il est conseillé de s’adresser à la dynamique Communauté juive de Lodz.

La rue principale de Lodz, Piotrkowska, forme le lien entre le centre-ville et le quartier juif, situé dans la partie nord autour de la rue de la Révolution de 1905. Dans cette rue, dans la cour du numéro 28, demeure encore la synagogue , qui est censée fonctionner lorsque le minyan est réuni. Dela rue, on voit encore une belle façade avec enseigne de boutique en russe et en polonais et, dans la cour, un bâtiment plus petit avec un vitrail et une étoile de David.
Dans la rue Piotrkowska, à la hauteur de la rue Zamenhofa, se dressait un bâtiment de la Communauté datant de 1899, qui servit de lieu à l’abattage rituel, puis du synagogue. Après la guerre, il fit office de magasin, puis d’imprimerie.
L’immense cimetière juif est très impressionnant. Créé en 1892, d’une surface de 40 hectares, avec un portail fait d’une belle grille, il contient environ 180 000 tombes, dont celles des parents du poète Julian Tuwin et du pianiste Arthur Rubinstein.
Le Musée des traditions de l’Indépendance de Lodz est le plus ancien musée historique de la ville. Il se compose de trois sections et de la forge des Roms (lieu de mémoire de l’extermination de la population rom durant la Seconde Guerre mondiale).
Le siège principal du musée se situe dans les locaux de la prison construite dans les années 1883-85, sur l’ordre du tsar de Russie, qui était majoritairement destinée aux prisonniers politiques. Durant l’occupation allemande et après la fin de la Seconde Guerre mondiale, c’était un lieu d’isolation des femmes, incarcérées pour crimes politiques.

La section de martyrologie de Radogoszcz se situe dans l’ancienne fabrique de Samuel Abbe qui, durant la Seconde Guerre mondiale servit de prison de la police pour les habitants qui violaient la loi de l’occupant allemand. Radogoszcz était une prison masculine de transit. Selon les données de 1944, les prisonniers passaient là des périodes n’excédant pas deux mois dans l’attente de leur procès ou de leur transfert vers d’autres prisons ou des camps. C’est de là que partaient les convois pour les exécutions de masse dans la région de Lodz. C’est également de là que sont partis les prisonniers mis à mort au cours de la plus grande exécution publique, accomplie dans la ville de Zgierz le 20 mars 1942. On estime que, durant l’occupation allemande, près de 40 000 prisonniers sont passés par l’établissement.
Dans la nuit du 17 au 18 janvier 1945, juste avant l’arrivée de l’Armée rouge, les nazis ont mis le feu à la prison tout en plaçant un fusil mitrailleur devant l’unique sortie de l’immeuble. Dans le massacre qui a suivi, plus de 1 500 personnes ont trouvé la mort. Ce lieu est donc consacré à la mémoire des victimes de la Seconde Guerre mondiale et au martyre des habitants de Lodz et de la région de la Warta.

Durant l’occupation hitlérienne, la section de la gare Radegast portait le nom de la gare de transbordement du ghetto de Radogoszcz (Verladebahnhof Getto-Radegast). C’était le point de transbordement de la nourriture, des combustibles, des matières premières pour la population du ghetto et ses ateliers, ainsi que le point de chargement des produits qui y étaient fabriqués. La gare est devenue également un « Umschlagplatz » pour les personnes déportées dans les camps de la mort. Aujourd’hui, c’est un lieu de mémoire du martyre des juifs de Lodz et ses environs, mais également des juifs de Vienne, de Prague, de Berlin, de Berlin et du Luxembourg. C’est l’un des lieux les plus émouvants de Lodz. La scénographie, sobre et majesteuse, fait évoluer le visiteur dans un couloir sombre, rythmé par la documentation visuelle du quotidien des juifs du ghetto de Lodz. Si vous n’avez qu’une journée prévue à Lodz, ce mémorial doit figurer sur votre liste.

Le Centre de Dialogue Marek Edelman est un centre culturel et éducatif qui se veut le miroir de l’histoire multiculturelle et multi-ethnique de Lodz. Les expositions et conférences sont principalement axées autour de l’histoire des Juifs de la ville et des relations entre la communauté juive et polonaise. En sortant du Centre, prenez une demi heure pour faire le tour de l’impressionnant parc des survivants, surplombé par une statue de Jan Karski.
Pour finir votre visite de Lodz, rendez-vous pour dîner à la Manufaktura, quasi ville dans la ville et ancien emplacement des usines d’Izrael Poznanski. Ce site, qui ne lasse pas d’étonner, montre l’influence de l’industriel juif sur la ville.
Izrael Kalmanowicz Poznanski (Aleksandrów Lódski 1833 – Lódz 1900) était un homme d’affaire et un industriel juif polonais établi à Lódz.
Son père, de condition modeste, s’installa dans la vieille ville de Lódz en 1834. Il y tenant un stand d’articles de cuir et de textiles. Après avoir terminé ses études secondaires, Izrael Poznanski débute son ascension fulgurante comme vendeur ambulant. Peu à peu, il se hisse parmi les entrepreneurs les plus éminents de Pologne, se constituant un empire industriel qui employa des milliers de salariés dans ses usines de coton.
Il acquit également une réputation de patron philanthrope : au début peu soucieux du bien-être et de la sécurité de son personnel, il entreprit à la fin de sa vie de s’engager dans des actions caricatives et fit construire des orphelinats, des écoles et des hôpitaux.
Avec Ludwig Geyer et Karol Scheibler, les deux autres « rois du coton », Poznański était devenu le fabricant le plus important de Łódź, une ville à l’époque fortement industrialisée et multi-culturelle, surtout peuplée de Polonais (catholiques et juifs) et d’Allemands (protestants) et dont les milieux bourgeois furent fort bien dépeints dans le roman de Władysław Reymont intitulé La Terre promise (Ziemia Obiecana), adapté plus tard pour le cinéma par Andrzej Wajda.
Poznański a laissé à Łódź un important patrimoine industriel qui constitue un ensemble architectural unique, ayant survécu aux deux guerres mondiales. Les sites reliés à sa mémoire sont d’ailleurs parmi les plus remarquables de la ville : on peut citer les énormes bâtiments industriels de la rue Ogrodowa, aujourd’hui totalement rénovés et devenus le centre commercial, de services et divertissements appelé « Manufaktura », le Palais Poznański tout proche, aujourd’hui transformé en musée (et abritant une importante exposition sur Arthur Rubinstein) et son tombeau de marbre, dans le cimetière juif — le plus grand cimetière israélite d’Europe — dont le style et l’envergure tranchent fortement avec la tradition juive qui interdit toute forme d’ostentation pour les funérailles et les tombeaux et qui est le plus grand monument funéraire individuel juif au monde.
Une cérémonie de la Marche des Vivants se déroula à Lodz le 29 août 2024 afin de commémorer les 80 ans de la liquidation du ghetto de Lodz. 500 personnes, parmi lesquelles des survivants de la Shoah, des représentants politiques polonais et 12 ambassadeurs y participèrent, à la gare de Radegast d’où parti le dernier convoi de déportés le 29 août 1944. Lors de la cérémonie fut rappelée l’importance d’éduquer la jeunesse sur la Shoah et de travailler pour un meilleur avenir.
Eric Slabiak est, avec son frère Olivier, le fondateur du célèbre groupe Les Yeux Noirs (1992), mêlant musique tzigane et yiddish. Après 8 albums et 1800 concerts à travers le monde, il crée en 2019 le groupe Josef Josef. Sur l’album des Yeux Noirs, Balamouk on retrouve le morceau « Lodz », inspiré par son lien familial à la ville. Rencontre.

Jguideeurope : Quel est votre lien familial à Lodz ?
Eric Slabiak : C’est la ville de naissance de mon grand-père maternel. A chaque fois que j’entends le nom de cette ville, j’ai l’impression que s’y déroulait toute l’histoire juive de Pologne. Lorsque je parle à des gens dont les ancêtres étaient également de Lodz, je vois leurs regards s’illuminer. Un regard immédiatement chargé de mélancolie.
C’est une ville que je percevais dans mon imaginaire comme un shtetl, un village. Un sentiment renforcé par le fait que ma famille était de condition modeste. Plus tard, j’ai appris qu’il s’agit en fait d’une grande ville industrielle.
Ma famille est originaire de nombreuses villes polonaises : Varsovie, Lublin, Czestochowa, Lodz et d’autres. Lodz représente pour moi la ville mystérieuse, elle attise ma curiosité. Nourri par un double sentiment affectif et de rejet. Mes ancêtres en ont été chassés. Néanmoins, il demeure un lien qui dépasse les générations. Je n’arrive pas totalement à me l’expliquer mais il est bien présent.

Qu’est-ce qui a inspiré le morceau « Lodz » ?
Aujourd’hui, j’éprouve l’envie de découvrir Lodz et les autres villes polonaises. J’aimerai y ressentir, même s’il s’agit de liens fantasmés, ce que ma famille a vécu. Retrouver les quartiers dans lesquels ils vivaient, les traces de leur présence ancienne de plusieurs générations. Une nostalgie pour un passé que je n’ai pas connu dans un lieu que je n’ai pas connu. Pour mes grand-parents, il était inconcevable d’y retourner après en avoir été chassés par crainte de l’accueil des Polonais. J’ai donc, à travers ce morceau, tenté de traduire mes impressions, mes souvenirs imaginaires de Lodz.
Vous avez également tutoyé les racines familiales dans d’autres parties de votre œuvre ?
Je suis issu d’une famille de musiciens, alors le grand éventail des émotions était très présent autour des chants, musiques et danses. Ma passion est absolument liée à ma famille. Celle que je n’ai pas connu et celle que j’ai connu. Cela s’est donc retrouvé de différentes manières sur les albums des Yeux Noirs et sur celui de Josef Josef. Je choisi souvent les chansons yiddish en pensant que mes grands-parents les ont entendu ou chanté eux-mêmes. Sur l’album de Josef Josef, on retrouve cinq chansons yiddish. Sur scène, j’en ajoute souvent d’autres…
À Góra Kalwaria (la « montagne calvaire »), les juifs ne s’installèrent qu’en 1795, mais un siècle plus tard, ils formaient déjà plus de 50% de la population de la ville, où s’était établi depuis 1859 le tsaddik Isaac Meir Rothenberg Alter, beau-frère de Menahem Mendl de Kotzk. Les juifs appelaient Góra Kalwaria « Gur » ou encore « la nouvelle Jérusalem », tant le tsaddik Alter et sa dysnastie étaient connus. Pendant l’Occupation, tous les juifs de Góra Kalwaria furent transférés au ghetto de Varsovie, puis de là, à Treblinka.
Aujourd’hui, subsistent les bâtiments des deux synagogues , aux numéros 5 et 10-12 de la rue Pijarska, transformés en magasins, et le cimetière datant de 1826, où viennent se recueillir des visiteurs, venus souvent des États-Unis.
Le témoignage d’Albert Londres
Albert Londres se rendit à Góra Kalwaria, en 1929 : « Deux mille habitants, mais l’un des nombrils de la juiverie orientale. Là, le fameux zadick [sic] Alter, successeur de Baal Chem Tov, celui qui s’en alla porter le Zohar en voiture à travers les Carpates, cherche le contact avec Dieu, comme nos amateurs de TSF, chaque soir, cherchent les ondes. »
Albert Londres, Le Juif errant est arrivé, Paris, Le Serpent à Plumes, 2000.
Le nom seul de cette capitale évoque le martyre du ghetto qui suivit l’écrasement de l’insurrection d’avril 1943. Ce nom est de ce fait ancré dans la conscience de l’humanité.

Les juifs s’installèrent à Varsovie à partir de l’an 1414, première mention de leur présence. En 1792, à la veille de passer sous domination russe, ils étaient 6 750, soit 9,7% de la population. Leur nombre s’accrut considérablement au cours du XIXe siècle et au début du XXe siècle, et de nouvelles synagogues, des écoles juives, une école rabbinique furent ouvertes. En 1864, ils étaient déjà 72800, soit 32,7 % de la population, et en 1917, 363 400, soit 41 %. Des quotidiens paraissaient en yiddish, comme le yiddishes Tageblat. En 1878, la Grande Synagogue de la rue Tlomacka fut construite. en 1939, il y avait à Varsovie 400 000 juifs, un chiffre qui atteignit 500 000 en automne 1941, lorsque fut créé le ghetto, véritable camp de concentration au milieu de la ville.
Les Allemands nommèrent, comme dans chaque ghetto, un Judenrat, à la tête duquel se trouvait Adam Czerniakow. Le ghetto était séparé du reste de la ville, la « ville aryenne », par de hauts murs, et il était interdit à quiconque d’y pénétrer ou d’en sortir sans laissez-passer. Les « juifs aptes au travail » (Arbeitsjuden) travaillaient pour des entreprises allemandes (les shops), les rations alimentaires étaient extrêmement faibles, et les Allemands réquisitionnaient les fourrures, les vêtements, l’or, tout ce qu’ils pouvaient prendre pour alimenter l’effort de guerre de la Wehrmacht. En un an, de l’été 1941 à l’été 1942, 100 000 juifs moururent de faim, de froid et du typhus. La mort était un spectacle quotidien dans les rues du ghetto. Des charrettes passaient régulièrement pour ramasser les cadavres. À partir du 22 juillet 1942, les exigences allemandes devinrent inouïes : ils demandèrent à Czerniakow de leur livrer chaque jour 6 000 ou 7 000 juifs pour un soi-disant « déplacement de population vers l’Est » (Umsiedlung).
22 juillet 1942
« On nous a déclaré que, à l’exception de quelques cas, tous les juifs, sans exception d’âge ni de sexe, seraient évacués vers l’Est. Aujourd’hui, nous devons livrer un contingent de 6 000 personnes avant 16h. Et il en sera de même, sinon plus chaque jour. » (22 juillet 1942)
Adam Czerniakow, Carnets du Ghetto de Varsovie, 6 Septembre 1939 – 23 juillet 1942, Paris, La Découverte, 1996.
Czerniakow comprit très bien de quoi il s’agissait et se suicida. Durant tout l’été 1942, au cours de rafles sans précédent, les Allemands « nettoyèrent » le ghetto, rue par rue, dirigeant les juifs vers un centre de triage appelé Umschlagplatz, d’où des trains partaient chaque jour pour Treblinka et revenaient le soir, vides, à Varsovie. Au cours de ces « actions », près de 300 000 juifs furent ainsi déportés et immédiatement gazés. Les déportations se calmèrent puis reprirent au printemps 1943, après l’échec de la Wehrmacht à Stalingrad. Le 19 avril 1943, le jour de la Pâque juive, éclata l’insurrection du ghetto sous la direction de Mordechaï Anielewicz, qui tint tête aux allemands pendant quatre semaines. Elle fut écrasée dans le sang et dans le feu des lances incendiaires du général Stroop. Après quoi celui-ci put écrire, victorieux, à Berlin : « Il n’y a plus de quartier juif à Varsovie ».
L’ancien quartier juif
Pour essayer de comprendre où se trouvait le quartier, il faut y passer plusieurs jours, deux plans à la main : un de l’époque du ghetto et un actuel.
L’ancien quartier juif de Varsovie, qui correspondait principalement au quartier de Muranów mais s’étendait jusqu’à la rue Swietokrzyska (« Sainte-Croix »), est aujourd’hui méconnaissable puisque rasé à 99% ; aucune maison n’est restée debout et la reconstruction d’après-guerre a transformé jusqu’au tracé des rues et au plan d’occupation des sols.

La Grande Synagogue de la rue Tlomacka n’existe plus. Seul subsiste le bâtiment mitoyen, ancien Institut des Sciences judaïques fondé en 1920, aujourd’hui Institut historique juif , aux numéros 3-5 de la rue Tlomacka. On y trouve un petit musée, une bibliothèque, des documents d’archives.
La seule synagogue en activité est la Nozykow de la rue Twarda . Elle a été élevée à la fin du XIXe siècle sur des terrains offert à la communauté par Zelman Nozyk. Au cours des années 1980, elle a été restaurée et redonnée au culte. Les offices ont lieu régulièrement, rassemblant quelques personnes âgées ainsi que des juifs étrangers ou travaillant à Varsovie. À côté de la synagogue, une école pour enfants juifs à été créée, ainsi qu’un « lieu d’information pour visiteurs juifs » (Fondation Ronald S. Lauder). La rédaction de la revue Midrasz y est également installée.

À proximité se trouve, place Grzybowski, le Panstwowy Teatr Zydowski (« Théâtre juif d’État ») portant le nom de Rachel Kaminska, sa fondatrice en 1950. On y donne régulièrement des spectacles en langue yiddish, couvrant tout le répertoire classique et moderne de cette littérature, depuis Scholem Aleïkhem, Schalom Asch, An-Ski, jusqu’à Isaac Bashevis Singer, en passant par des adaptions du Chant du peuple juif assassiné d’Itzhak Katzenelson ou des soirées de chants yiddish interprétées par Golda Tencer. L’Association culturelle des juifs polonais a son siège dans le même bâtiment, c’est là qu’est édité le bimensuel Dos Yiddish vorte (ou Slowo Zydowshe), petit journal moitié en yiddish, moitié en polonais. De l’autre côté de la place triangulaire, vous trouverez en restaurant plus ou moins casher, Menorah . Remarquez aussi quelques maisons qui semblent dater du ghetto.
La renaissance du quartier juif
Depuis quelques années, la vie culturelle juive de Varsovie renaît de ces cendres. Le signe le plus évident de ce changement a été l’ouverture de POLIN, le Musée de l’Histoire des juifs polonais en 2013. Ce majestueux bâtiment en verre abrite un centre culturel et éducatif, et un musée qui propose une collection permanente et des expositions temporaires. L’exposition permanente, qui présente mille ans d’histoire juive en Pologne s’étend sur plus de 4 000 mètres carrés et a été conçue par 120 universitaires et chercheurs.

La visite de POLIN prend au minimum 6 ou 7 heures, il est recommandé de le visiter en deux jours, tant le contenu de son exposition permanente est riche et passionnant. Vous pouvez également faire appel à un guide, la visite durera dans le cas entre 3 et 5 heures. Autre réussite de ce musée, son restaurant, Besamim (niveau 0 du musée) qui propose un audacieux mélange de cuisine israélienne, juive ashkénaze et polonaise. La cuisine est casher.
Le ghetto
Le ghetto lui-même est situé plus loin. Prenez la rue Jean-Paul II, promenez-vous autour du Hala Mirowska (« marché couvert »), qui donne une toute petite idée de l’ambiance ancienne de ce quartier populaire. Visitez les cours des maisons datant des années 1950 et 1960 : vous y trouverez, ici et là, des monticules qui signalent que le champ de ruines qu’était le ghetto en 1943-1944 n’a jamais pu être totalement déblayé. Empruntez les rues Nowolipie, Karmelicka, Nowolipki, Dzielna, Pawia et essayez de vous représenter ce qu’était le ghetto, même si rien ne transparaît aujourd’hui. Passez aussi par la rue Krochmalna où se passe le roman d’Isaac Bashevis Singer, Le Petit Monde de la rue Krochmalna.
Isaac Bashevis Singer
Né à Radzymin en 1904 et mort à New York en 1991, le prix Nobel de littérature en 1978 est l’un des plus importants écrivains yiddish du XXe siècle, continuateur de Scholem Aleïkhem et d’Itzhak Leybush Peretz. Fils de rabbin, il vécut à Varsovie jusqu’en 1933, puis émigra aux États-Unis où il continua d’écrire en yiddish des histoires qui ont pour cadre la vie des shtetlekh polonais, ainsi que les milieux de l’émigration. Presque toute son oeuvre est traduite en français.
À l’angle des rues Jean-Paul II et Dzielna se trouvait le Pawiak, sinistre prison où de nombreux résistants furent torturés. Plus loin, l’on parvient rue Mordechaï Anielewicz, (ex-rue Gesia). Prenez à droite, et vous tomberez devant une grande place non bâtie, avec tout au bout le monument aux Héros du Ghetto, élevé dès 1948, comprenant un groupe sculptural dû à Natan Rappaport avec l’inscription « La nation juive à ses combattants et à ses martyrs ». À l’arrière du monument, le simple bas-relief est plus émouvant que la sculpture grandiloquente et quelque peu marquée par le style stalinien.
En 1972, le chancelier Willy Brandt s’est agenouillé devant ce monument, geste qui n’était pas prévu par le protocole. Derrière le monument, suivez la rue Zamenhofa (du nom de Ludwik Lazar Zamenhof, linguiste juif né à Bialystok, fondateur de l’espéranto), dans laquelle ont été placées depuis 1988, tous les 100 mètres environ, des pierres représentant un « chemin de mémoire et du martyre », menant à l’Umschlagplatz et évoquant les noms les plus illustres de l’insurrection : Josef Lewartowski, Michal Klepfisz, Arie Wilner « Jurek », Mordechai Anielewicz, Meir Majerowicz « Marek », Frumka Plotnicka, Itzhak Nyssenbaum.

À l’angle des rues Zamenhofa et Mila, à l’ancien numéro 18 de la rue Mila, se trouvait le bunker d’où Anielewicz et ses compagnons dirigeaient l’insurrection, où ils s’enfermèrent et trouvèrent la mort le 8 mai 1943. Une pierre tombale y est élevée sur un monticule. Le long de la rue Stawki, le chemin continue jusqu’à la rue Dzika, avec des blocs de granit évoquant Janusz Korczak -l’écrivain, pédagogue et médecin de l’orphelinat juif de Varsovie, qui monta dans le train de la mort avec ses enfants lorsque ceux-ci furent déportés -et Itzhak Katzenelson, le poète yiddish, qui put quitter par miracle le ghetto et s’enfuir en France où il écrivit Le Chant du peuple juif assassiné, avant d’être livré aux Allemands et déporté à Auschwitz.
La rue Mila
« Il est une rue à Varsovie, c’est la rue Mila.
Ô arrachez vos coeurs de la poitrine et placez-y des pierres au lieu de coeurs.
Arrachez de vos têtes vos yeux mouillés et placez-y des éclats de verre, comme si vous n’aviez rien vu,
si vous ne saviez rien, bouchez-vous les oreilles et n’écoutez pas -soyez sourds !
Je vous parle de la rue Mila. »
Itzhak Katzenelson, « Le Chant du peuple juif assassiné », in C. Dobzynski, Le Miroir d’un peuple, anthologie de la poésie yiddish, Paris, Gallimard, 1987.
Au numéros 5-7 de la rue Stawki, une plaque indique que c’est de ce bâtiment que le commandement des SS surveillait les opérations de triage de l’Umschlagplatz, et au 6-8 se trouvait l’hôpital israélite où les juifs étaient rassemblés juste avant leur « embraquement ». Juste en face, un monument élevé en 1988, sorte de porte de marbre, symbolise l’Umschlagplatz avec, gravés sur un mur haut de 3 mètres, 400 prénoms juifs représentatifs des 300 000 pour lesquels ce fut la dernière gare. Juste derrière se trouvaient les rampes, les quais où les wagons attendaient chaque matin leur tribut à emmener à Treblinka. Non loin de là, se trouve le restaurant Warsaw-Jérusalem , ouvert par un chef israélien.
Pour avoir une idée de ce à quoi ressemblait Varsovie et le ghetto, vous pouvez vous rendre au Musée de l’Insurrection de Varsovie (celle de la ville en 1944, à ne pas confondre avec celle de l’insurrection du ghetto en 1943). Le musée ne présente pas beaucoup d’intérêt en soi, sauf pour un film, enregistré par les avions américains en 1945, qui offre le spectacle épouvantable de la ville, presque entièrement détruite, et du ghetto, rasé à 99 %.
Le cimetière juif
Le cimetière juif , dans la rue Okopowa, est très beau et très impressionnant. Par miracle, il n’a pas été détruit par les Allemands. Créé en 1799, d’une surface de 33 hectares, il rassemble environ 200 000 tombes. Se promener dans ces allées, au milieu des tombes et de la végétation, permet de s’imaginer l’importance qu’avait la communauté avant la guerre. Certaines tombes se distinguent, comme celles de Ludwik Lazar Zamenhof, de l’actrice Rachel Kaminska, ou encore du président du Judenrat Adam Czerniakow, ainsi qu’une sculpture représentant Janusz Korczak, mort à Treblinka, et un carré consacré aux insurgés du ghetto. Si vous cherchez une tombe spécifique, vous pouvez vous adressez au petit bureau de l’entrée. Cependant, armez-vous de courage et de patience, il est très difficile de se repérer correctement dans le cimetière -ce qui ajoute néanmoins à sa poésie. Si vous voulez vous recueillir, veillez bien de prendre en compte le temps que vous passerez à chercher la sépulture, avant la fermeture du lieu à 17h.

De la même manière que le Musée de l’Insurrection, le Musée de Katyn n’est pas un lieu de recueillement ou de recherche spécifique sur les juifs de Pologne, puisqu’il honore la mémoire des 22 000 prisonniers de guerre polonais assassinés par le NKVD soviétique en 1940 dans la forêt de Katyn. Cependant, il présente un intérêt particulier pour qui veut comprendre la relation complexe qu’entretiennent les recherches sur l’histoire intérieure de la Pologne et l’histoire des juifs de Pologne pendant la guerre. En effet, quelques pièces du musées sont dédiées exclusivement aux soldats juifs assassinés à Katyn – alors qu’ils étaient en fait une petite minorité. À l’extérieur du Musée, le mémorial du Musée est orné d’une étoile de David, côte à côte avec la Croix catholique.

Les juifs se sont installés à Wlodawa dès le XVIIe siècle. À la fin du XIXe siècle, ils étaient au nombre de 3 670 (66 % de la population), puis 4 200 (67%) en 1921, 5 650 (75%) en 1939. Les Allemands créèrent un ghetto dans lequel ils déportèrent 800 juifs de Cracovie et 1 000 de Vienne, avant de tous les exterminer dans le camp tout proche de Sobibór, à quelques kilomètres de là, dans la forêt, au bord du Bug.
Wlodawa possède l’une des synagogues baroques les plus imposantes de Pologne, édifiée en 1762, de forme carrée, avec un étage très élevé et un toit en pente. Détruite pendant l’Occupation, elle a été restaurée après la guerre. Une scène du film Shoah de Claude Lanzmann s’y déroule : on y voit le bâtiment de la synagogue en gros plan et l’auteur discute avec un témoin de l’époque, Pan Filipowicz.
Shoah (extrait)
« Il y avait une synagogue à Wlodawa ?
Oui, il y avait une synagogue et très, très belle. Quand la Pologne était encore sous la domination des tsars, cette synagogue existait déjà. Elle est même plus ancienne que l’église catholique. Ça ne fonctionne plus. Il n’y a plus de croyants. »
Claude Lanzmann, Shoah, Paris, Gallimard-Folio, 1997.
Dans le cadre de ce guide culturel et touristique, nous ne nous attarderons pas trop sur les camps d’extermination, qui sont des « documents de barbarie » (Walter Benjamin) et non de culture, mais il est nécessaire d’évoquer au moins quelques-uns d’entre eux, afin d’essayer d’imaginer l’incompréhensible, de saisir par des images ce qui est insaisissable par l’entendement.
À Sobibór , il y a pour ainsi dire deux villages différents. Sobibór proprement dit est un village endormi, paisible, le long du Bug, avec une petite église catholique. Pour voir ce qui reste du camp, il faut se rendre à Sobibór-stacja kolejowa (« Sobibór, gare ferroviaire »), à quelques kilomètres de là, où l’on accède par la forêt. La forêt est immense et, disons-le, magnifique. Claude Lanzmann écrit que tous les paysages de Pologne respirent la Shoah, cela est particulièrement vrai de cette région.
Au bout de la forêt, la route est barrée par un passage à niveau. Une pancarte indique « Sobibór » ; dans la gare, on peut lire un panneau « salle d’attente ». En dehors de la présence du chef de gare et d’une entreprise de travail du bois, personne n’habite ici. C’est là qu’en l’espace d’un an et demi, de mars 1942 à octobre 1943, des convois arrivèrent de Pologne et de toute l’Europe, chargés de 250 000 juifs qui furent immédiatement exterminés par le gaz. On peut voir aujourd’hui la rampe, un monument, un petit musée, et marcher à pied jusqu’à l’emplacement du camp lui-même, dont il ne reste qu’une sorte de tumulus de forme circulaire.
Le lieu est très bien filmé dans Sobibór, 14 octobre 1943, 16 heures de Claude Lanzmann.

La Bucarest juive a quasiment disparu. Sur une population estimée à 168 000 âmes en 1948, il ne reste que 2 000 personnes dispersées aux quatre coins de la capitale, et sans doute trop âgées ou dans une situation trop précaire pour envisager l’émigration.
L’ancien quartier juif
L’ancien quartier juif se situait près de la place Unirei (« de l’Union ») au-delà de la rue Sfanta Vineri. Au sud-est, les rues Dudesti et Vàcàresti retentissaient d’une vie juive joyeuse et colorée. Elles n’existent plus. À leur place s’étend un terrain vague recouvert de gravats que les résidents des immeubles voisins appellent « Hiroshima ». Ceausescu réduisit tout à fait à néant afin d’y bâtir une improbable et délirante Cité du Futur. Une seule et unique maison témoigne de la présence juive en ces lieux : le Théâtre juif d’État . C’est ici que des comédiens -au demeurant non juifs- continuent d’apprendre le yiddish et d’interpréter, dans cette langue, des œuvres de grands dramaturges juifs.
Les synagogues
Il reste très peu de synagogues en service à Bucarest. Au début du XXe siècle, on en dénombrait pourtant au moins soixante-dix, aussi bien séfarades qu’ashkénazes.

Le Temple choral demeure aujourd’hui le lieu de culte le plus important de la ville. Édifié en 1866 par les architectes Endele et Freiwald, sur le modèle viennois (le même que celui de la synagogue de la rue Dohány, à Budapest), il fut reconstruit en 1933 puis en 1945, suite aux dégradations infligées par les Gardes de Fer lors du pogrom de janvier 1941.
Située dans une rue animée donnant sur Bulevardul Maghero, la synagogue Yeshoah Tova est le lieu de culte le plus ancien de Bucarest, elle date de 1822. Elle tient ses services à l’entrée du shabbat et le samedi matin à 9 h.
La Grande Synagogue , ashkénaze, fut bâtie en 1846 par une congrégation de juifs polonais. Elle est située rue Adamake, l’une des plus vieilles rues de la capitale avec ses maisons basses miraculeusement préservées. En 1992, cette synagogue fut transformée en musée. On y trouvera des objets de culte, des documents et des incunables précieux, retraçant l’histoire des anciennes communautés juives de Roumanie. Au centre, une statue honore le souvenir des dizaines de milliers de juifs de Transnistrie, victimes des pogroms et des déportations. Pendant la guerre, 200 000 Juifs de Transylvanie furent envoyés à Auschwitz par les autorités hongroises. Ils n’en revinrent pas. La synagogue Mamulari abrite également un Musée juif.

La synagogue a été construite en 1836 et abrite le musée depuis 1978. Une impressionnante collection de judaica y a été rassemblée par Moses Rosen, le grand rabbin de Roumanie entre 1964 et 1994, et fondateur du musée qui porte aujourd’hui son nom.
Les cimetières
On trouve trois cimetières juifs à Bucarest. L’austère cimetière juif Calea Serban Vodà, de rite séfarade, témoigne également des anciens pogroms et exterminations massives que subirent les juifs roumains en Moldavie, Bucovine, Bessarabie et Transnistrie. Un autre cimetière séfarade est situé dans le quartier de Giurgiului. Enfin, le cimetière Filantropia abrite un petit oratoire.

Érigé en 2009, la Roumanie a tardivement reconnu son rôle dans l’extermination des juifs d’Europe. En effet, selon une enquête de la Fondation Élie Wiesel, en dehors de l’Allemagne, la Roumanie est le pays qui a la plus grande responsabilité dans la Shoah.
La vie juive aujourd’hui
Le centre communautaire de la ville propose des activités hebdomadaires et anime également la seule radio juive digitale du pays : Radio Shalom Romania. La dynamique Fédération des Communautés juives de Roumanie publie -en Roumain, anglais et hébreu- un excellent bimensuel, Realitatea evreeascà (« Réalité juive »). Le catalogue de ce qui reste peut-être la seule maison d’édition juive d’Europe orientale et centrale Hassefer , comporte aussi bien les œuvres de Scholem Aleïkhem, Martin Buber, Bernard Malamud et Simon Dubnov que celles des auteurs originaires de Roumanie, Elie Wiesel, Carol Iancu ou Mikhail Sebastian.
La ville de Jassy, capitale de la Moldavie depuis le XVIe siècle, est entourée de bourgades aux maisons basses aux teintes pastel et de chaumières passées à la chaux.

Voilà longtemps que Bivolari, Hârlàu, Podul Iloaiei et Târgul Frumos ont été abandonnées par leurs habitants juifs. Dans les années 1920, Jassy abritait la plus grande communauté juive de cette région orientale. Peuplée d’artisans, de kabbalistes, de marchands et de talmudistes, la ville comptait alors 43 000 juifs, soit la moitié de sa population, et pas moins de 112 synagogues.
C’est ici qu’en 1876, Abraham Goldfaden présenta ses premières mises en scène, à l’origine du théâtre juif en Europe. Le poète de langue française, Benjamin Fondane, y naquit en 1898.
C’est aussi dans cette ville que se développèrent les plus virulents mouvements antisémites. Ainsi, le 8 novembre 1940, Jassy fut proclamée capitale de la Garde de Fer, organisation fasciste et farouchement antisémite déclarée hors-la-loi après son soulèvement de janvier 1941 contre le général Ion Antonescu. Ce même dictateur, après avoir mis fin au pogrom de Bucarest, cautionna, en juin de la même année, le massacre de quelque 12 500 juifs à Jassy et Dorohoi (tragédie décrite par Curzio Malaparte dans son livre remarquable Kaputt).
Que reste-t-il aujourd’hui de cette communauté rivalisant autrefois avec celles de Pologne, d’Ukraine, de Russie ? À la fin des années 1960, un peu moins de 2 000 familles vivaient à Jassy et onze synagogues s’y trouvaient encore. Aujourd’hui, seules quelques dizaines de personnes appartiennent à la communauté de Jassy qui gère le restaurant casher et le musée d’Histoire et d’Art.

La grande synagogue est la plus ancienne de la région. Bâtie en 1671 à l’initiative du rabbin Nathan Hanover, elle fut restaurée une première fois un siècle plus tard et modernisée en 1864. Mélangeant avec bonheur des éléments architecturaux ashkénazes, byzantins et séfarades, elle témoigne ainsi de sa parenté avec celles de Bohème, de Pologne, d’Ukraine et de Russie, mais aussi de Grèce et de Bulgarie.
Signalons que les pierres tombales de l’ancien cimetière juif de Clurchi ont été transférées dans le cimetière de Pàcurari , où un monument commémore les victimes du pogrom de juin 1941.
Trois identités : un destin
Benjamin Weschler, Fundoianu ou Fondane ?
Trois identités -juive, roumaine et française- se disputent la priorité dans l’oeuvre de ce poète prophétique. C’est la première qui décidera de sa mort, à Birkenau, fin mai 1944.
Né en 1898, poète, essayiste, philosophe et cinéaste, Benjamin Fondane quitta sa ville natale, Jassy, pour gagner Paris en 1923.
« Enfermé dans le souvenir comme en une obscure strophe, dans le vide où percent des drapeaux et des rêves, j’attends ta venue trompette de la Peur Catastrophe », écrivait-il en 1922. Interné en 1944 à Drancy, il refusa d’avoir la vie sauve, obtenue après l’intervention de son épouse et d’amis (Emil Cioran, Stéphane Lepanscu et Jean Paulhan), pour accompagner sa soeur dans son dernier voyage.
Depuis le XVIIe siècle, la ville de Galati est un important carrefour commercial. Elle fut le théâtre d’actes de vandalisme en 1868, après que fut lancée, à l’encontre des juifs, une accusation de meurtre rituel.

L’imposante synagogue , dite « des artisans », est la seule, parmi les vingt-neuf que comptait la ville dans les années 1930, à être restée debout. Construite en 1875, elle fut inaugurée à nouveau en 2014.
Bien que l’émigration des juifs a provoqué une quasi-disparition des juifs de la ville, il reste aujourd’hui, en dehors de cette synagogue, un restaurant cacher et un cimetière juif .