
Dans ce petit centre de la province de Cuneo, on peut visiter sur rendez-vous une très intéressante synagogue de propriété privée, guère plus grande qu’un salon, mais ornée de magnifiques boiseries et dorures. Dans l’entrée, une plaque rappelle la date de sa fondation en 1797. Au centre, la tévah baroque est en bois coloré. L’aron a des battants dorés finement ouvragés.

L’ancien petit quartier juif a conservé son aspect de l’époque du ghetto, autour de la via Deportati Ebrei. Dans l’une des cours de cette rue s’élève, au deuxième étage d’un bâtiment, la synagogue construite au XVIIIe siècle et remaniée en 1832. La salle de prière était destinée à accueillir plus de 300 personnes. Admirez la belle porte, ainsi que l’aron et la tévah, en bois doré du XVIIIe siècle.
Dans cette petite ville toute proche de Turin, se trouve la plus élégante des synagogues baroques piémontaises. Les juifs carmagnolais furent forcés d’habiter le ghetto à partir de 1724.

Le temple est installé au premier étage d’une maison du XVIIIe siècle, face à l’ancienne entrée du ghetto. Après un vestibule décoré de fresques, entrez dans la salle de prière de forme presque carrée (de 9 m sur 10) avec un plafond à travées de bois et de belles fenêtres ornementées.
Au centre, se dresse une magnifique bimah baroque, en bois sculpté polychrome or, noir, rouge et vert, avec de fines colonnes soutenant une grande couronne. L’aron, richement décoré, est entouré de deux colonnes et de stucs. Les murs sont couverts à mi-hauteur de panneaux de bois sombre, somptueusement sculptés. Ces ornements, apparemment plus anciens que la synagogue, sont surdimensionnés par rapport à la salle. Le travail d’ébénisterie, datant des XVIe et XVIIe siècles, est d’une très grande qualité et n’est pas sans rappeler celui des meubles des collections de la maison royale de Savoie. « Si ce ne sont pas les mêmes artisans, ils appartiennent à la même école », remarque l’historien d’art David Cassuto dans ses études sur les synagogues baroques piémontaises.

Turin est un des plus beaux exemples de carrefour des cultures juives : Ashkénazes du Nord, Provençaux suite à l’expulsion, Sépharades suite à l’Inquisition, Italiens depuis 2 millénaires…
Turin fut d’abord la capitale du Duché de Savoie, puis du Royaume de Sardaigne. La présence juive a été enregistrée par l’Evêque Maximus de Turin au IVe siècle. La seule trace de présence juive suivante date d’un millénaire. En 1424, les juifs français Elias Alamanni et Amedeo Foa s’y installèrent avec leurs familles.
La Grande Synagogue mérite une brève visite. Inauguré en grandes pompes le 16 février 1884, ce bâtiment majestueux de style néo-mauresque, avec ses quatre tours surmontées de coupoles en oignon, témoigne de la frénésie de reconnaissance des juifs italiens de l’émancipation. Il avait d’ailleurs été conçu dans cet esprit, célébrant l’intégration des juifs de Turin, un appel d’offres étant réalisé afin de choisir le projet le plus enthousiasmant. L’architecte, Enrico Petiti, n’avait pas lésiné sur les décorations, à l’extérieur comme à l’intérieur de la synagogue, mêlant les influences.

Néanmoins, la plupart ont disparu quand le Grand Temple fut incendié en 1942 par une bombe alliée. La majeure partie des archives des communautés juives piémontaises fut alors détruite. La synagogue fut restaurée entre 1945 et 1949. Plus tard, une synagogue annexe a été construite à l’intérieur afin d’accueillir les prières et événements du quotidien. Elle est surnommée Tempio Piccolo (le petit temple).
À une petite dizaine de minutes à pied d’où se situent la Grande synagogue et le centre communautaire, on peut encore voir derrière la très animée via Roma, quelques traces de l’ancien ghetto où vécurent les juifs.

En 1430, le Duc Amedeo VIII mit en place un statut concernant les juifs en leur imposant de nombreuses restrictions et des impôts élevés. Le ghetto fut créé en 1679, à la demande de la Régente, la Duchesse Marie Jeanne Baptiste de Savoie. Les juifs y furent confinés dans l’année, en ce lieu qui accueillait également des œuvres de charité. Il abritait deux synagogues. Après 1724, à cause de la surpopulation, le ghetto fut agrandi.
L’émancipation fut une des conséquences de la Révolution française. Suite à l’annexion du territoire à la France en 1798, les juifs jouirent d’une plus grande liberté et ne furent plus obligés de vivre dans le ghetto. La victoire de l’alliance austro-russe en 1799 sur la France provoqua le rétablissement de l’ancien statut des juifs. Suite à la reconquête du territoire par la France en 1800, les juifs récupérèrent leur liberté.
Suite à la défaite de Napoléon en 1814, Victor Emmanuel réinstaura les régulations concernant les juifs. Mais petit à petit, ces lois disparurent et l’émancipation fut complétée en 1848, les juifs quittant graduellement le ghetto. A cette époque, 3200 juifs habitèrent à Turin.

Encouragés par le poète David Levi et le rabbin de Turin Lelio Cantoni, les juifs participèrent à la première guerre d’Indépendance de l’Italie. Sous Victor Emmanuel II, les juifs obtinrent une émancipation complète, intégrant l’administration, l’armée et le corps diplomatique. De nombreux écrivains et artistes juifs participèrent au développement culturel de la ville
Dans cet élan d’émancipation, il fut décidé de construire une synagogue, avant donc celle que l’on connait aujourd’hui. Un lopin de terre fut donc acheté dans ce but. L’architecte Alessandro Antonelli débuta la construction de la synagogue en 1863.
L’immeuble devait accueillir non seulement une synagogue avec 1500 places mais également un espace administratif, une école et d’autres fonctions. L’ampleur du projet dépassa les moyens de la communauté qui revendit le bâtiment en 1878 à la ville de Turin et devint le Mole Antonelliana . Celle-ci le transforma en musée commémorant le Roi Victor Emmanuel II. Le bâtiment fut achevé en 1889 et mesure finalement 167 mètres. Il est un des immeubles les plus connus de la ville.

En 1931, 4040 juifs vécurent à Turin. Les Lois raciales imposées en 1938 bouleversèrent la vie des juifs qui étaient pourtant très assimilés. En 1942, une bombe détruit l’intérieur de la synagogue de Turin. L’année suivante, les Allemands commencèrent à déporter les juifs. Sur les 246 qui furent déportés à Auschwitz, seuls 21 retournèrent à Turin. Parmi eux, Primo Levi. Les juifs prirent une grande part aux mouvements locaux de Résistance et trouvèrent de nombreux soutiens dans la population pour se cacher.
Le cimetière juif varia de lieu pendant plusieurs siècles à partir des années 1400. En 1867, la communauté obtint une section du Cimetière Monumental , où une partie des anciennes tombes furent réinstallées.
Entretien avec Baruch Lampronti, représentant de la Cultural Heritage Commission of the Jewish Community of Torino et programmateur du site visitjewishitaly.it

Jguideeurope : D’où vient l’inspiration qui influença le style si particulier de la synagogue de Turin ?
Baruch Lampronti : Le style mauresque fut exigé dans l’appel d’offre de ce projet architectural. Cette requête était en adéquation avec la tendance de l’architecture contemporaine des synagogues européennes. Cette tendance était elle-même influencée par un certain goût pour l’exotisme qui se développa lors de la seconde partie du XIXe siècle et que l’on peut reconnaitre dans de nombreux immeubles non juifs appartenant au courant éclectique. En ce qui concerne la conception des synagogues, le choix d’inclure des références orientales s’imposa également grâce à d’autres arguments significatifs. J’avais d’ailleurs consacré un article à cette démarche dans un journal italien dont voici un extrait :
« Tandis que l’ampleur des volumes des synagogues de l’Emancipation et l’autonomie face aux immeubles environnants sont le fruit d’un désir d’égalité et d’assimilation au modèle des églises, le langage stylistique exprime, au contraire, une quête d’individualité face aux lieux de cultes des autres dénominations. Ainsi, un débat se développa concernant la manière la plus appropriée d’exprimer l’identité juive d’un lieu. « A ma connaissance, un style typiquement juif n’existe pas », déclara dans un rapport l’architecte juif Marco Treves de Vercelli. Lequel était engagé dans la rénovation de la synagogue de Pise (1865) et la conception des nouveaux temples de Vercelli (1878) et de Florence (1882). Il fit observer que même le Temple de Jérusalem, selon des preuves archéologiques, n’exprimait probablement pas un style purement représentatif du peuple juif mais qu’il s’inspira des principales influences artistiques de la région.
Subséquemment, la variété des conditions de vie, souvent oppressantes, vécues par les juifs de Diaspora a empêché la définition de traits stylistiques nationaux ou d’une architecture synagogale spécifique. Dans la conception des temples israélites, en Italie comme en Europe, les architectes s’orientent souvent vers des répertoires de style oriental, qu’ils considèrent comme représentatifs de l’origine géographique du peuple juif. Des références aux styles Assyrien-Babylonien, Egyptien et Byzantin émergent ; parmi les références les plus répandues, qui furent théorisées par Treves également, nous trouvons également les références au style mauresque, qui rappellent particulièrement l’architecture de l’Espagne médiévale. En ces temps, les juifs y jouirent d’une grande liberté et d’une ferveur culturelle et érigèrent leurs synagogues conformément aux goûts de cette époque (parmi les exemples les plus connus on peut citer Santa Maria la Blanca à Tolède, construite en 1180 et transformée en église à la fin du XIVe siècle). Dans de nombreux temples du XIXe siècle, on retrouve des arches en forme de fer à cheval, des dômes en forme d’oignon ainsi que des remparts et des tourelles d’inspiration islamique et, parmi les ornements intérieurs, des stucs très garnis avec des peintures géométriques et des motifs arabesques. La synagogue de Turin fait également partie de cette tendance. Conçue par Enrico Petiti après l’expérience infructueuse qui a conduit à la réalisation de la Mole Antonelliana, la synagogue a été touchée par les bombardements de novembre 1942 et perdit toute trace de sa décoration intérieure originelle. » Vous pouvez retrouver l’article original sur ce lien

Peut-on trouver encore aujourd’hui des traces de l’ancien ghetto ?
Le ghetto de Turin n’était composé que d’un pâté et demi de maisons, lesquels existent encore aujourd’hui. Le pâté entier, qui est le plus ancien (utilisé à partir de 1679-1680) a conservé sa structure d’origine, mais l’intérieur et les façades ont été profondément transformées quelques années après l’émancipation (1848). L’autre moitié de pâté de maisons, ajouté quelques temps après 1724, a eu son intérieur rénové, mais les façades révèlent très clairement l’identité antérieure de l’immeuble. Ce pâté dépasse d’un étage les immeubles environnants. Afin d’élargir la capacité résidentielle pour y accueillir un plus grand nombre de familles juives, l’étage disposant de la plus grande hauteur sous plafond a été divisé en deux, par conséquent ses fenêtres sont plus nombreuses et plus rapprochées les unes des autres. L’immeuble a été rafraîchit et repeint mais il n’y a pas eu de changements structurels majeurs ni d’ajouts ornementaux depuis l’époque.

Quels autres lieux de Turin liés à la culture juive suscitent l’intérêt des visiteurs ?
En dehors des synagogues et de l’ancien ghetto, les lieux les plus représentatifs de l’histoire juive de Turin sont la Mole Antonelliana et les carrés juifs du Cimetière Monumental.
Le Piémont a également été parsemé d’un ensemble de petites communautés juives qui partagèrent sous bien des aspects une histoire commune. Ces communautés ont aujourd’hui presque toutes disparues mais une multitude de synagogues, d’anciens ghettos et de cimetières demeurent encore. La plupart appartiennent à la communauté juive de Turin, qui les a pris en charge et qui est le point de contact pour leur visite. Pour être plus précis, notre juridiction inclut les synagogues et les cimetières d’Alessandria, d’Asti, de Carmagnola, de Cherasco, de Cuneo, de Mondovi, de Saluzzo, d’Ivrea (partiellement) et les cimetières de Acqui Terme, de Chieri, de Fossano et de Nizza Monferrato (dans ces villes, les synagogues ont été démantelées par le passé).

Parmi les autres monuments du patrimoine culturel juif intéressants à visiter dans la région, on peut citer :
– les synagogues et cimetières de Vercelli et Biella, ainsi que le cimetière de Trino Vercellese, qui sont gérés par la communauté juive de Vercelli & Biella
– la synagogue et les cimetières de Casale Monferrato, ainsi que le cimetière de Moncalvo, gérés par la communauté juive de Casale Monferrato.

Vous pouvez trouver des renseignements et des contacts pour les visites sur les deux sites suivants. Tout d’abord celui de la communauté juive de Turin https://torinoebraica.it/turismo/?lang=en
L’autre site est http://www.visitjewishitaly.it/en/ a été développé par la Fondation pour le Patrimoine Culturel Juif d’Italie. Il fournit des descriptions et des photos de nombreux monuments du patrimoine juif d’Italie, parmi lesquels ceux mentionnés ci-dessus. Nous opérons actuellement des mises à jour, il se peut donc qu’il y ait quelques dysfonctionnements ou des informations manquantes.
Modène a le grand mérite d’être connue pour des monuments bien différents. Monuments architecturaux et religieux comme dans un bon nombre de villes italiennes et chefs-d’œuvre gastronomiques avec notamment son célèbre vinaigre. Mais aussi des monuments contemporains qu’on prend le temps d’admirer lorsqu’ils ne passent pas à toute vitesse devant vous, les Ferrari et autres Lamborghini et Maserati, construites dans la région…

Histoire des juifs de Modène
La présence juive à Modène date probablement du 15e siècle, lorsqu’ils se trouvèrent sous la protection des Ducs d’Est. En 1443, ils sont obligés de porter un signe distinctif. Une bulle pontificale les autorise huit ans plus tard à s’installer librement sur les terres d’Este.
Suite à l’Inquisition espagnole en 1492, des juifs séfarades viennent migrent en Italie, notamment à Modène. Un ghetto fut institués à Modène en 1638. De nombreuses synagogues et oratoires furent construits à cette époque. La ville représenta un important centre d’études juives, grâce à l’influence de nombreux érudits.
Un ancien document prouve l’existence d’un cimetière juif . Il se trouvait près de l’actuelle Via della Fosse. Il fut utilisé jusqu’au 17e siècle. Un carré juif fut installé dans le cimetière de San Cataldo.
À l’image des autres territoires italiens conquis par Napoléon, le ghetto de Modène fut aboli en 1796, mais réinstauré en 1815. Ce n’est qu’avec l’annexion des territoires au royaume d’Italie que les juifs devinrent, en 1860, des citoyens italiens bénéficiant des mêmes droits que leurs compatriotes.

Symbole de cette intégration, une magnifique synagogue est construite à partir de 1869. Pendant ce temps, une partie du ghetto est rasée dans une démarche de renouvellement urbain. Si la communauté comptait près d’un millier de personnes au milieu du 19e siècle, ce chiffre diminua graduellement, notamment à cause de nombreux départs pour Milan.
Un peu moins de 500 juifs habitaient à Modène à la veille de la Seconde Guerre mondiale. 70 d’entre eux furent déportés pendant la Shoah. De nombreux juifs participèrent à la Résistance. Combattant pendant la Première Guerre mondiale puis diplomate, Angelo Donati organisa la fuite de milliers de juifs, tandis que le président de la communauté, Gino Friedman, géra la protection de nombreux jeunes. Bien que relativement petite, la communauté juive demeure très active culturellement.
Visite de Modène
En descendant à la gare de Modène, vous prenez la Sgarzeria où se trouve l’ancienne usine de tabac. Vous continuez sur la Via Francesco Rismondo avec tous ses bâtiments de couleur jaune, orange terre battue, rose et rouge.

Puis, Via Emilia Centro et vous prenez à droite sur Corso Duomo, une jolie place avec de nombreux câbles téléphériques tels des nuages métalliques inamovibles, peuplée de terrasses, voutes, kiosques et passants virevoltant autour. Et avec une étonnante petite sculpture d’un joueur de foot en hommage à Pannini, le célèbre inventeur des albums à autocollants.

Un peu plus loin, après la place avec son manège, vous arrivez enfin au Palazzo dei Musei qui abrite les archives d’État, une bibliothèque et des musées de la ville, un ensemble un peu à l’image du bâtiment ancien accueillant ce type de lieux à Parme.

En prenant les petites ruelles vers la cathédrale, on tombe sur la Sala Truffaut, un ciné-club nommé en hommage au réalisateur français Via degli Adelardi. Une jolie place vous attend ensuite au coin de Via dei Servi et Francesco Selmi.
Cent mètres plus haut, sur la Via Luigi Albinelli, vous trouverez le marché historique de la ville couvert avec ses étales et tables longues. Attention aux horaires limités hors saison.

Remontez encore 100 mètres en saluant la jolie Piazza XX Settembre pour arriver sur la Piazza Grande. Centre-ville accueillant la cathédrale qui fait face au Palazzo Comunale. Une juxtaposition des pouvoirs temporel et spirituel fréquente dans cette région d’Émilie-Romagne. La cathédrale de Modène est très différente de sa voisine de Parme, assez sobre, avec ses briques rouges et quelques peintures murales au fond.

Un peu plus haut, on tombe sur la place Mazzini, nommée en hommage à Giuseppe Mazzini, révolutionnaire et patriote italien. Une statue lui rend hommage.
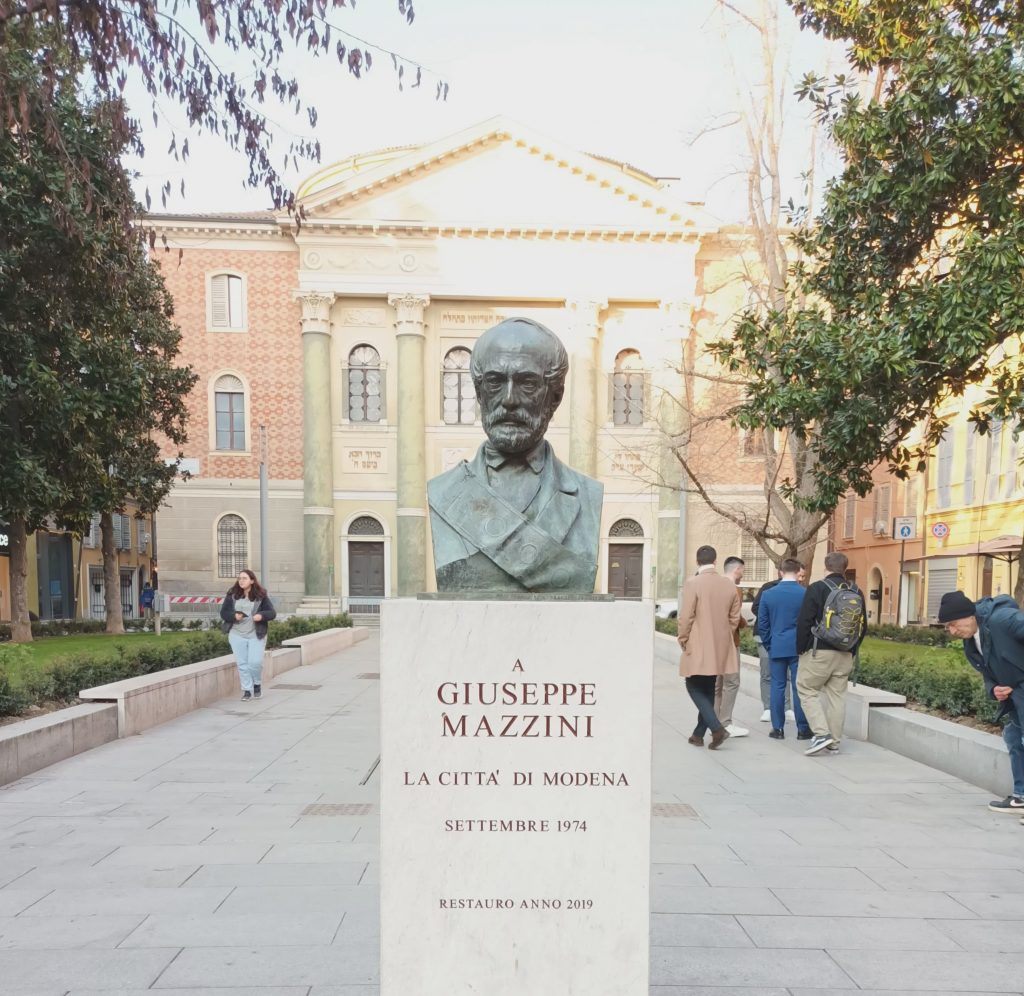
Également présente à l’entrée de la place, une carte des lieux bombardés de Modène pendant la Seconde Guerre mondiale.

Au bout de cette place se situe une très belle synagogue orientalisante, construite entre 1869 et 1873, sur un projet de Ludovico Maglietta. Elle a une double façade, l’une donnant sur la piazza Mazzini, l’autre sur la Via Coltellini et, à l’intérieur, la salle de prière de forme circulaire est entourée par une colonnade corinthienne qui soutient la galerie des femmes.
Sur la façade de la synagogue est inscrit en hébreu « Baroukh haba beshem Hasehm » et « Ptekhou li Shaaré tsedek », signifiant respectivement, « Soyez les bienvenus au nom de Dieu » et « Que les portes de la Justice me soient ouvertes ». Un message d’ouverture et de quête de tikoun olam, la réparation du monde.
La rue sur la droite de la synagogue est la via Biasa, sur et aux alentours de laquelle se trouvait le ghetto.

On arrive ensuite devant l’impressionnant bâtiment du Palazzo Ducale, lieu de formation des officiers de l’armée italienne, qui donne sur la Piazza Roma.

En prenant à gauche on aperçoit sur la Piazza San Domenico la statue d’une femme sur le Monument de la Liberté.

A droite de la place, on trouve une statue du célèbre chanteur d’opéra Luciano Pavarotti sur la rue Carlo Goldoni qui vous tend les bras, invitation à entrer dans le théâtre communal qui porte son nom et se situe derrière lui. A côté duquel se situe le musée Pannini, moins généreux et surprenant en présentation que les autocollants qu’on trouvait enfant dans ses paquets.

Dans le même ensemble du Palazzo Santa Margherita, il y a une bibliothèque fréquentée par les étudiants qui s’attablent dans la cour, où depuis 2023 est présentée une exposition qui présente de nombreuses photos de rues de Modène en 1973 et les mêmes lieux photographiés en 2023. Avec comme changements perceptibles, les vélos remplacés par les voitures, les portails de sécurité ajoutés et surtout les nombreux bâtiments rénovés. Ce qui, dans la ville qui accueille le musée Ferrari, n’est finalement qu’un hommage.

Un peu plus haut, l’école hippique des officiers italiens assure la transition avant d’arriver au joli petit Parco Ducalo Estenze qui vous mène à la gare. Et si vous avez le temps, que vous avez effectué votre visite à 300 km/h, vous mériterez de visiter le musée Enzo Ferrari, situé derrière le parc, à droite de la gare.
Sublime ville au centre médiéval inscrit au patrimoine mondial, Ferrare n’apparait pas comme un vaste enclos muséal encerclé par une ville. Au contraire, son centre historique est relayé délicatement par de belles et longues rues menant aux monuments et à une douceur de vivre loin d’être passagère et à laquelle ses habitants s’accrochent, comme ce fut le cas, malgré tout, pour les personnages du film Le Jardin des Finzi Contini (1970) de Vittorio de Sica…

Histoire des juifs de Ferrare
La présence juive à Ferrare date au moins du 13e siècle, lorsque la ville accueillit des juifs originaires d’autres villes d’Italie et d’Europe. Cette présence est officialisée en 1287 par une ordonnance. Tant qu’elle resta la capitale des ducs d’Este jusqu’en 1598, Ferrare fut l’un des grands centres du judaïsme italien et européen avec plus de 2 000 juifs pour 30 000 habitants à l’âge d’or, entre le 15e et le 16e siècle. Une période de l’histoire où de nombreux artistes et écrivains y trouvent également refuge.

Une synagogue est construite en 1481. Un synode regroupant les rabbins d’Italie se déroule à Ferrare en 1534. Ashkénazes venus d’Allemagne et séfarades accueillis après leur expulsion d’Espagne y vivaient côte à côte sous la protection des autorités locales, sans devoir porter un signe distinctif, sans obligation de résidence dans tel ou tel quartier de la ville.

La grande rue qui relie la Ferrare médiévale à la Ferrare Renaissance, le corso della Giovecca, témoigne de ce passé heureux. De prestigieux rabbins et médecins vivaient dans la ville qui fut, comme Bologne, un haut lieu de l’imprimerie juive. Abraham Usque y publia, en 1555, la célèbre Bible de Ferrare.
La situation se précipita en 1597 lorsque le duc Alfonse d’Este mourut sans héritier mâle. La papauté prit le contrôle de la ville abandonnée par la cour d’Este qui partit pour Modène, comme de nombreux juifs. Puis, le ghetto fut instauré en 1627.
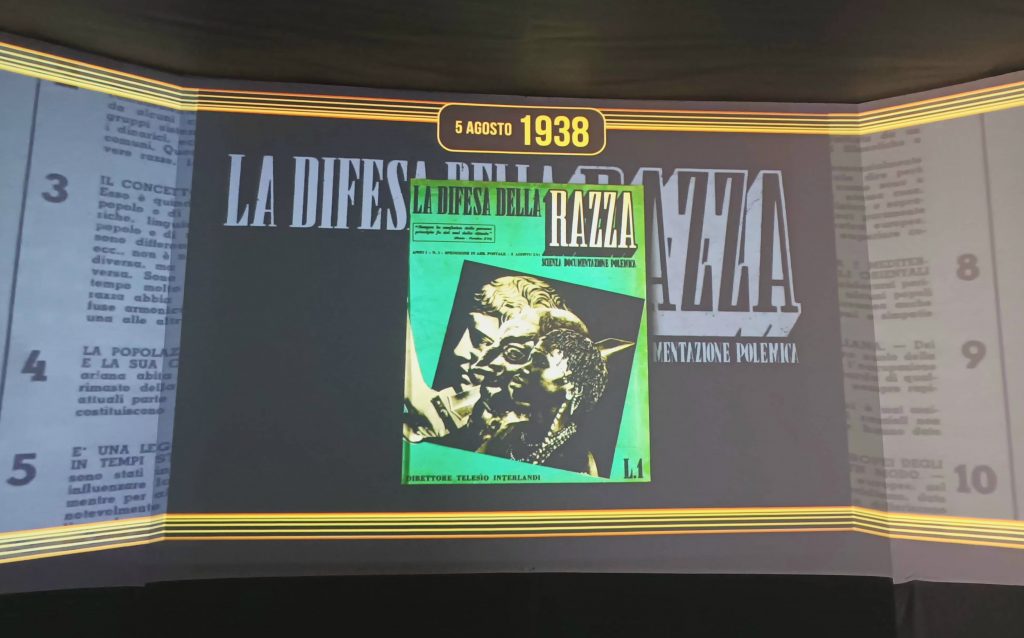
Malgré les difficultés et même après l’émancipation (1859), les juifs restèrent assez nombreux dans la ville, jusqu’aux lois raciales imposées par Mussolini en 1938. Cette tragédie a été admirablement racontée par l’écrivain Giorgio Bassani qui a consacré la plupart de ses livres à la Ferrare juive. Près de 200 juifs sont arrêtés et déportés dans les camps à partir de 1943. Les fascistes détruisent une synagogue et d’autres biens immobiliers de la communauté. Suite à la Libération, une petite communauté juive renait et accueille depuis 2017, le Musée national du judaïsme italien et de la Shoah (MEIS) .
Visite de Ferrare
Le MEIS, est accessible depuis la gare en prenant la Via Pavia. Sur le chemin, on remarque à gauche le stade de foot de la ville et à droite l’Aqueduc où l’on observe une statue d’un homme qui déverse de l’eau sur des enfants. D’ailleurs, ce lieu accueille le centre d’assistance familiale.

L’exposition permanente se situe dans le bâtiment intérieur du MEIS, séparé par un parc et l’exposition temporaire dans celui situé à l’avant du complexe. L’exposition permanente est consacrée au judaïsme italien, de la période de l’Antiquité à la Renaissance.

Objets anciens, panneaux, reproductions et vidéos de spécialistes accompagnent de manière très harmonieuse cet itinéraire. Un ensemble très apprécié par les jeunes notamment, puisqu’en revisitant le musée en 2024, nous avons pu voir une classe de collégiens de Ferrare suivre avec enthousiasme ce parcours ludique.
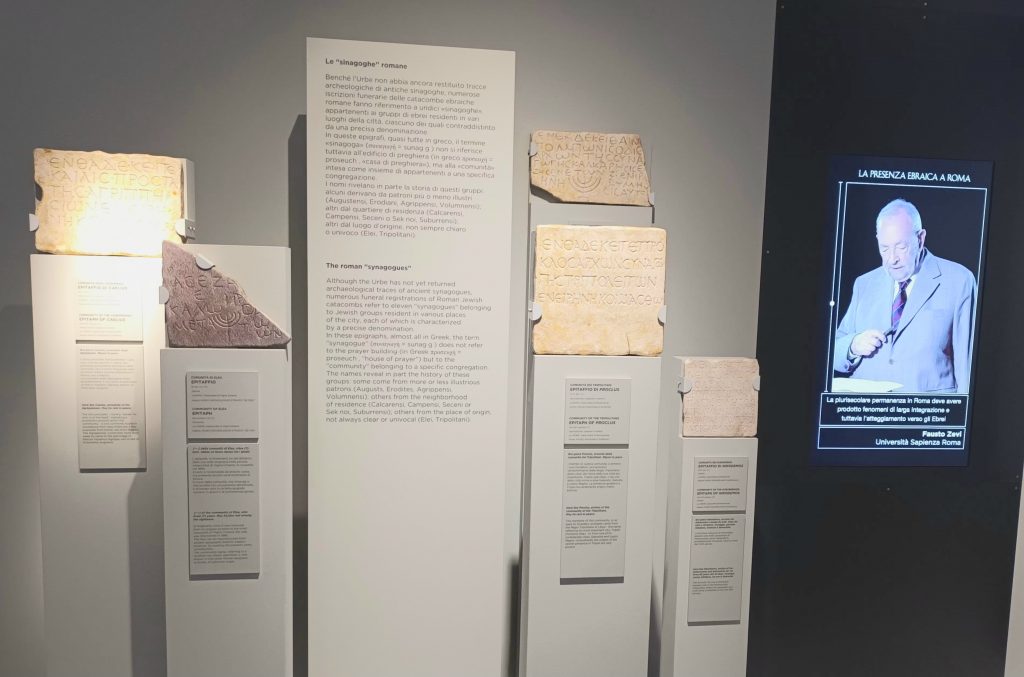
A l’image du musée juif de Bologne, la visite commence par une présentation générale du judaïsme. On découvre d’abord les plus anciennes traces, puis on arrive sur la Révolte de 70 en Israël contre les Romains, avec la reproduction de la célèbre gravure de l’Arc de Titus. On découvre aussi la synagogue très ancienne d’Ostie.

Les panneaux indiquent que les juifs sont citoyens romains depuis 212, grâce à l’Edit de Caracalla, comme toutes les autres minorités. Un accueil un peu mitigé par Sénèque et d’autres intellectuels, ne comprenant pas « l’utilité » des coutumes juives, notamment le jour de repos, considéré par eux comme oisif.
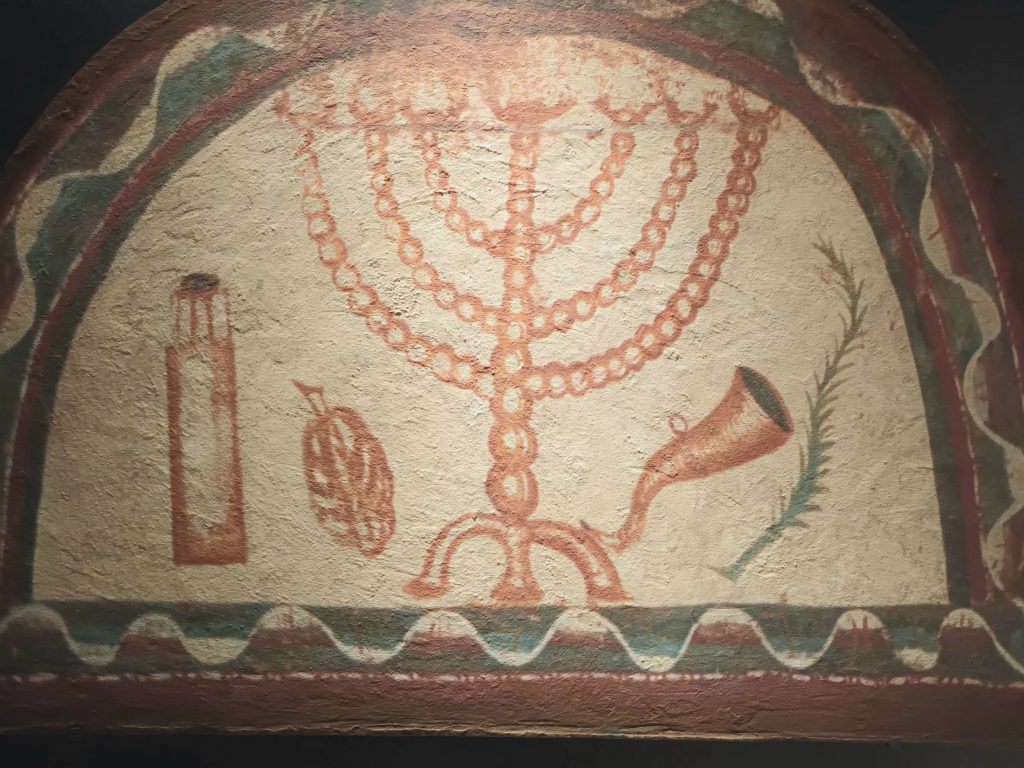
On aperçoit ensuite les anciennes catacombes avec un dessin de menorah datant du 2e ou 3e siècle et trouvées par accident en 1859 à via Antiqua. Puis, une mosaïque du sud de l’Italie. A partir de 313, la situation s’empire pour les juifs, notamment lors de la promulgation de lois très dures par Constantin, interdisant les couples juif-non juif. Néanmoins, la pratique du judaïsme demeure libre.
Un film est ensuite projeté sur les murs d’une pièce, racontant le célèbre voyage de Benjamin de Tudèle au 12e siècle à la découverte de la variété du judaïsme européen. Avec des images sur trois murs en simultanée.
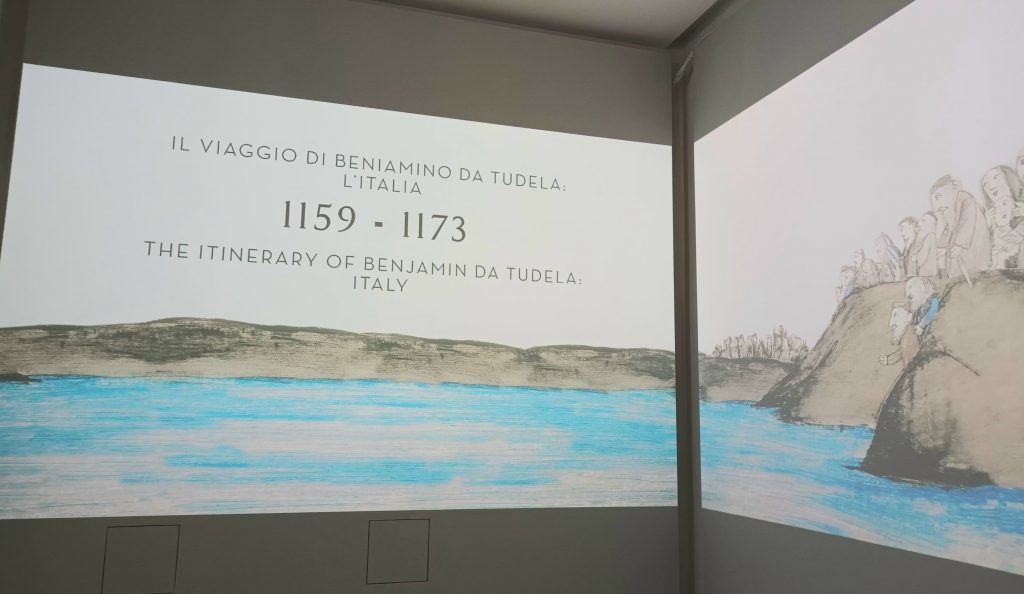
Suite au déclin de Rome et à l’Inquisition, on découvre ensuite les migrations des juifs italiens vers d’autres régions, notamment au nord. Du 14e au 16e siècle l’attitude des dirigeants politiques et religieux varie. A cette époque sont instaurés les ghettos, en commençant par celui de Venise en 1516. Le musée souligne les exceptions de Pise et Livourne, villes qui ne bâtirent jamais de ghetto pour y enfermer les juifs. Le Duc Ferdinand de Medicis invita les juifs à s’y installer et y travailler librement. Ils purent y jouir de la liberté de culte, protégés de l’Inquisition.
L’exposition permanente s’arrête donc à cette période. Les responsables du musée nous ont affirmé que le musée préparait la suite de l’exposition permanente allant de la Renaissance à l’époque contemporaine.
En sortant du musée, vous prenez à droite sur la Via Piangipane, puis Via Boccacanale di Santo Stefano à gauche et la deuxième à droite sur la très belle Via delle Volte avec, comme son nom l’indique, une multitude de passages surélevés voutés.

A la sortie de Via delle Volte, vous prenez à gauche sur Via delle Scienze où se trouve la Biblioteca Ariostea . Laquelle possède dans ses réserves de nombreux manuscrits, ouvrages et gravures sur la Ferrare juive.

En poursuivant dans cette rue vers le nord, vous prenez la première à gauche et tombez sur la Via Giuseppe Mazzini. Au numéro 95 de celle-ci, vous verrez la vieille synagogue de Ferrare. La magnifique scola tedesca ne sert actuellement que pour les grandes cérémonies. La salle de prière est éclairée par cinq grandes fenêtres donnant sur la cour. Le mur opposé est décoré de très beaux médaillons et stucs montrant des scènes allégoriques du Lévitique.
En haut d’un autre escalier et d’une longue galerie, se trouve aussi l’élégante salle de la scola italiana, qui n’est plus consacrée au culte. Sur le mur du fond, sont exposés trois précieux aronot de bois laqué et ouvragé. Celui du centre, tout d’or et d’ivoire, appartenait à la scola italiana, les deux autres, bleu vert, avec chacun deux magnifiques colonnes torsadées, viennent de l’ancienne scola spagnola, via Vittoria. Dans le vestibule ont été placés des meubles provenant de l’académie rabbinique.
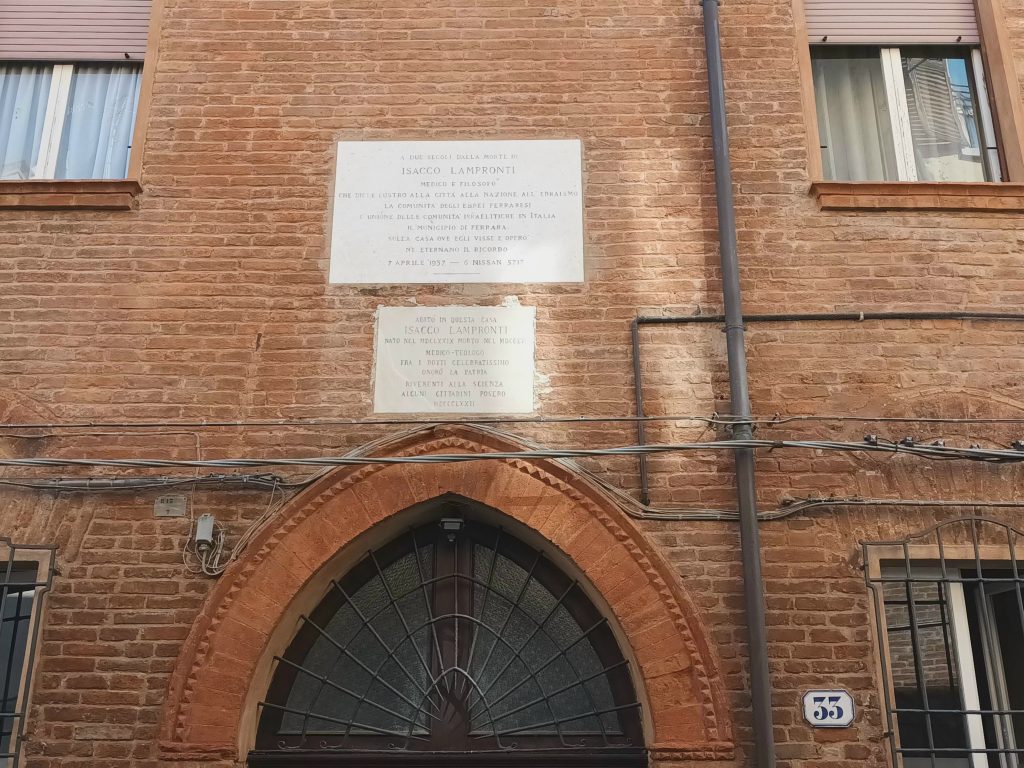
Un peu plus loin sur la Via Mazzini vous tournez à gauche sur la Via Vignatagliata, une des rues principales de l’ancien ghetto juif . Au numéro 33 se trouve la maison d’Isacco Lampronti, médecin, philosophe et représentant important de la communauté.

L’école juive était située au 81 de la même rue avec ses nombreuses jolies maisons orangées.

Une petite place porte le nom de Lampronti entre Via Vittaglia et Via della Vittoria, une des autres rues principales du ghetto de Ferrare.

En sortant du ghetto, on empreinte la Via Ragno jusqu’à la Corso Porta Reno qui mène à la très belle Piazza Trento-Trieste, où domine la Cathédrale de Ferrare et la Torre della Vittoria. Entre celles-ci, se situe le beau Palazzo Municipale, le tout formant un centre-ville spirituel et temporel rassemblé, comme dans de nombreuses villes italiennes de la région.

De nombreux hommages sous formes de plaques sont posés sur les bâtiments municipaux et palais entournant la cathédrale, en souvenir des personnes de différentes époques qui se sont battues pour la liberté.

Un peu plus haut sur la Corso Porta Reno, on arrive au château entouré de bassins d’eau, à se demander lequel des deux protège l’autre.

En faisant le tour du château par la gauche, on arrive Corso Ercole d’Este. Celle-ci mène du grand château vers le musée de la Résistance, les extérieurs du tournage du film Finzi-Contini et le célèbre Palazzo dei Diamanti, nommé ainsi à cause de son architecture toute particulière. Il accueille de très belles expositions.

Un peu plus loin on tourne à gauche sur la via Arianuova vers le petit cimetière juif levantin , trace de l’ancienne présence sépharade de Ferrare. Il est situé sur la petite Via Gianfranco Rossi entre quelques maisons et un parking et à côté d’une école où l’on peut voir sur le mur extérieur une plaque en hommage à un professeur déporté à Buchenwald. Le cimetière est actuellement fermé au public.

Pour se rendre ensuite au le cimetière juif , on peut traverser le joli parc Massari, qui pourra nous faire penser à l’immense actrice Léa Massari, même s’il s’agit dans ce cas d’un hommage bien plus ancien. Il y a beau y avoir un café nommé Central Park, peu de chance que ce parc soit jumelé avec celui de Manhattan.

Mais il est agréable de s’y promener pour y saluer notamment les statues de Verdi et Dante et admirer la fresque de 2015 consacrée au 70 ans de la libération de Ferrare.

En sortant du parc, on prend la rue Corso Porta Mare. Puis, on arrive Via delle Vigne au Cimetero Ebraico, en usage depuis 1620, face à sa grande porte d’entrée avec des inscriptions hébraïques. Le cimetière est principalement accessible au public le matin.

Suite à cette longue journée, vous pourrez profiter de la belle place Ludovico Ariosto, en choisissant de s’asseoir sur les bancs en pierre qui l’entoure ou au café sous les arcades qui vous rappelleront Bologne.

Interview
Le MEIS représentait un défi dès sa construction, à savoir transformer un lieu d’enfermement en un espace ouvert et inclusif. Rencontre avec Rachel Silvera, Directrice de la communication du MEIS, qui nous parle de ce lieu important du patrimoine culturel juif italien et des nombreux projets qu’il organise.

Jguideeurope : Pouvez-vous nous présenter certains des objets exposés dans l’exposition permanente consacrée à l’histoire des Juifs d’Italie ?
Rachel Silvera : Dans notre exposition permanente « Les Juifs, une histoire italienne », nous présentons des objets prêtés par d’autres musées italiens, des reconstitutions et des installations multimédia. Par exemple, nos visiteurs peuvent admirer le relief de l’Arc de Titus montrant le butin du Temple, une reproduction en plâtre réalisée en 1930. Le relief représente la procession triomphale de Titus à Rome après la campagne militaire en Judée, paradant les butins pillés du Temple de Jérusalem. On trouve également des reconstitutions de catacombes juives, à Rome (comme la Villa Torlonia et la Vigna Randanini) et dans le sud de l’Italie (Venosa).
Comment percevez-vous l’évolution de l’intérêt pour les études sur la Shoah en Italie ?
C’est un moyen fondamental : 1) de connaître l’histoire et de renforcer la prise de conscience ; 2) d’offrir des outils utiles aux étudiants et de transmettre des valeurs à la prochaine génération ; 3) de combattre le déni et la déformation de l’Holocauste.
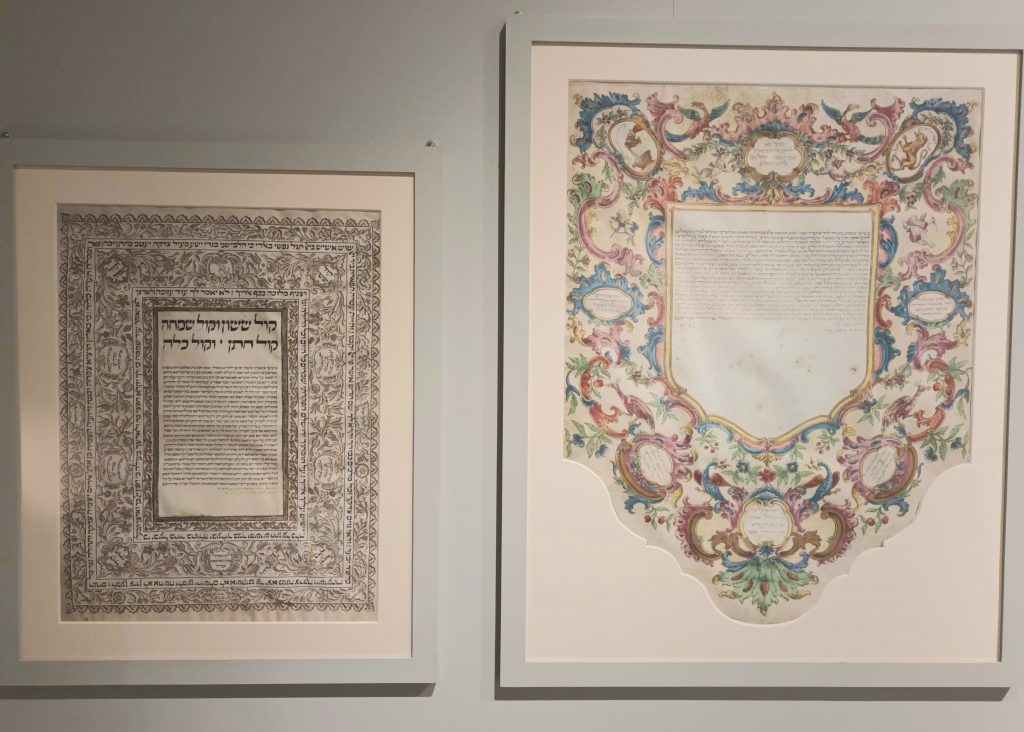
Quels projets éducatifs axés sur la Shoah sont menés par le musée ?
Pendant la pandémie, nous avons organisé deux importants événements en ligne pour les élèves, consacrés à la Shoah et à l’avenir de la mémoire. Nous avons touché plus de 12 000 élèves. Chaque année, nous proposons également un cours en ligne destiné aux enseignants et axé sur l’histoire de la Shoah et la relation avec les nouveaux médias. Nous travaillons également sur un projet financé par le ministère de l’éducation publique avec un lycée de Ferrare (Liceo Roiti) et l’Institut d’histoire contemporaine de Ferrare : les étudiants travaillent avec nous pour créer une exposition sur les lois raciales et la persécution.
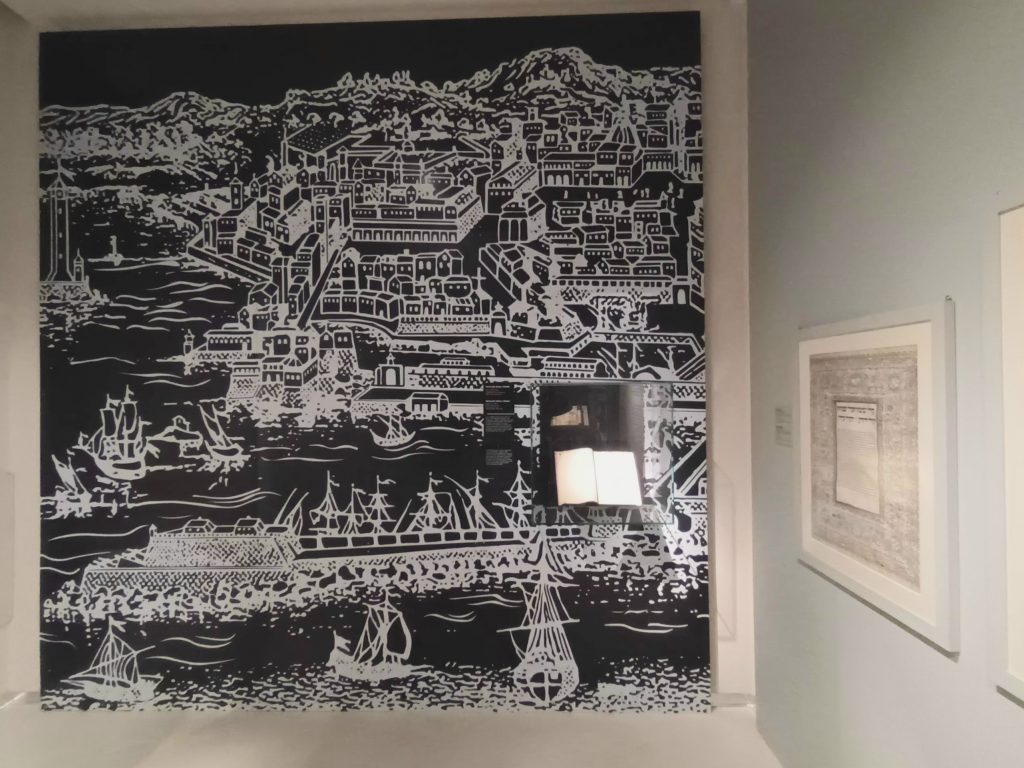
Pouvez-vous nous raconter une rencontre émouvante au Musée avec un visiteur ou des participants à l’exposition ?
Le Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah (musée national du judaïsme italien et de la Shoah) se trouve à Ferrare, dans les anciennes prisons de la via Piangipane. Pendant la guerre, ses murs ont emprisonné des opposants antifascistes et des Juifs, dont l’écrivain Giorgio Bassani, Matilde Bassani et Corrado Israel De Benedetti. Le défi consistait à transformer un lieu d’enfermement en un espace ouvert et inclusif.
Lors de la dernière Journée internationale de commémoration de l’Holocauste, nous avons dévoilé une plaque commémorative qui rappelle l’histoire de ce lieu. L’invité spécial était Patrizio Bianchi, le ministre italien de l’éducation. Ce fut un moment très émouvant.
Bologne est connue pour avoir été une des principales villes européennes du Moyen âge. Grâce sa grande population vivant au sein de ses murailles, la richesse de l’agriculture locale, le développement des échanges commerciaux avec les autres villes d’Emilie-Romagne, mais aussi et peut-être surtout par ce dynamisme assuré par son université, la plus ancienne d’Europe.

Histoire des juifs bolognais
Les premières traces de la présence juive bolognaise date de 1353, un document mentionnant un certain Gaio Finzi, « judeus de Roma ». Des juifs originaires des villes environnantes de Fabriano, Pesaro, Orvieto et Rimini s’y installent également dans la deuxième moitié du 14e siècle.
Les rabbins italiens se réunissent à Bologne en 1416 afin de s’accorder sur une requête soumise au Pape Martin V. En 1468, un professeur d’hébreu est recruté par l’université de Bologne. Entre 1477 et 1482, de nombreuses maisons d’éditions juives voient le jour et demeureront actives jusqu’à la moitié du 16e siècle.
Suite à l’Inquisition espagnole de 1492, des juifs sépharades s’installent à Bologne, parmi lesquels le rabbin Jacob Mantinus. Ovadyah Sforno, médecin et rabbin fonde une école talmudique renommée en 1527. En 1553, suite à une campagne de la contre-réforme, des Talmud et autres livres juifs sont brulés publiquement.

Deux ans plus tard, le Pape Paul IV impose aux juifs de vivre dans des ghettos juifs dans toutes les villes des Etats pontificaux. Celui de Bologne est créé en 1556 et fermé par deux portes. En 1569, les juifs bolognais sont expulsés de la ville. Le Pape Sixtus V autorise leur réinstallation en 1586. Mais ils sont à nouveau expulsés sept ans plus tard.
Ce n’est qu’en 1796, avec la conquête de Napoléon que les juifs sont autorisés à y revenir et surtout à pratiquer librement leur culte, comme c’est le cas en France, suite au souffle émancipateur de la Révolution de 1789.
Signe de sa reconnaissance officielle, la communauté juive dispose d’un oratoire en 1829. Suite à la perte de pouvoir de l’Eglise et la proclamation de la République romaine, tous les juifs italiens sont officiellement proclamés libres en 1860. Neuf ans plus tard, un terrain dans le cimetière municipal de Bologne est accordé aux juifs. La synagogue de Bologne, construite par l’architecte Guido Lisi, est inaugurée en 1877.

Suite à la promulgation des « lois raciales » en 1938 par le régime de Mussolini, les professeurs et élèves juifs sont exclus des écoles et universités. Les déportations des juifs bolognais débutent en novembre 1943. Ce sera le cas pour 85 d’entre eux, parmi lesquels le rabbin Alberto Orvieto. Suite à la Shoah, la communauté juive se reconstruit et compte en 2026 près de 300 membres.
Comme dans de nombreuses villes européennes, la ville de Naples a subi l’importation et l’instrumentalisation du conflit entre le Hamas et Israël suite au pogrom du 7 Octobre. Des manifestations violentes se sont produites à Bologne, notamment une supposée contre la police qui trouva « prétexte » au vandalisme de la synagogue en 2025.
Visite de Bologne
Nous vous invitons à suivre un itinéraire, dans cette somptueuse ville aux bâtiments et tempérament rouge le jour et aux subtils éclairages jaunes le soir.
Le train prend 7 minutes de l’aéroport à la gare, un peu l’Orlyval à Paris, sauf que vous arrivez directement au nord de Bologne intramuros. Dès qu’on descend, on remarque les arcades.

Des arcades de différentes époques, différents styles, présentes partout, surplombant les rues. Une politique d’extension immobilière mise en place suite aux problèmes de surpopulation dans cette ville qui fut déjà au Moyen-Age une des cinq plus grandes d’Europe. Une envie donc de construire vers l’avant et non vers le haut. Peut-être aussi une manière de protéger et d’accompagner les passants.
A droite de la gare, on trouve des quartiers populaires, ainsi que le MAMBO, musée d’Art Moderne, un ensemble culturel pluridisciplinaire qui accueil notamment une école de cinéma avec un joli graffiti en hommage à Agnès Varda à l’entrée. Mais aussi dans le coin, le parc nommé en hommage du 11-Septembre et le monument de la place Lamé, avec ces sculptures en souvenir des partisans.
Prenez le grand boulevard de la Via Giovanni Amendola qui part de la gare et débouche sur la place des Martyrs 1943-1945 et devient ensuite la Via Guglielmo Marconi qui mène directement à la synagogue de Bologne en prenant à gauche sur la Porta Nova.

La synagogue contemporaine se trouve rue Finzi, à l’entrée ouest du vieux quartier. Un petit oratoire fut fondé par Angelo Carpi dans sa maison en 1829. En 1868, la communauté en expansion loue une pièce dans un bâtiment rue Gombruti. Entre 1874 et 1877, une synagogue plus spacieuse est aménagée dans le même immeuble. La synagogue est détruite lors d’un raid aérien en 1943 et reconstruite en 1953.
La salle principale n’accueille plus que les grandes fêtes. En 2017, une petite synagogue a été construite en dessous du bâtiment. Lors des travaux, une mosaïque romaine et d’autres magnifiques œuvres anciennes ont été découvertes. Afin de les préserver et de permettre aux visiteurs de les voir, le sol de la synagogue a été construit sous la forme d’un grillage. La communauté est certes petite, mais elle demeure assez dynamique et accueille avec enthousiasme les visiteurs le shabbat. Lesquels, bien entendu, pour des raisons de sécurité, doivent faire la demande de visite par mail. La synagogue de Bologne a été victime d’une attaque antisémite en janvier 2025, causant des dégâts.

On reprend ensuite la Porta Nova qui débouche sur la Via IV novembre afin de retrouver le cœur de la vieille ville. On passe par devant le lieu où habita Marconi. Toujours en ligne droite, on arrive sur les célèbres Piazza Maggiore et Piazza Neptune, qui accueillent notamment les somptueux bâtiments de l’Hôtel de Ville (le Palazzio d’Accursio) et de la basilique, construite en deux temps comme on le voit de l’extérieur.

Ces places sont très fréquentées de jour comme de nuit, où se mêlent concerts improvisés, terrasses, étudiants, sorties de boulot et touristes.
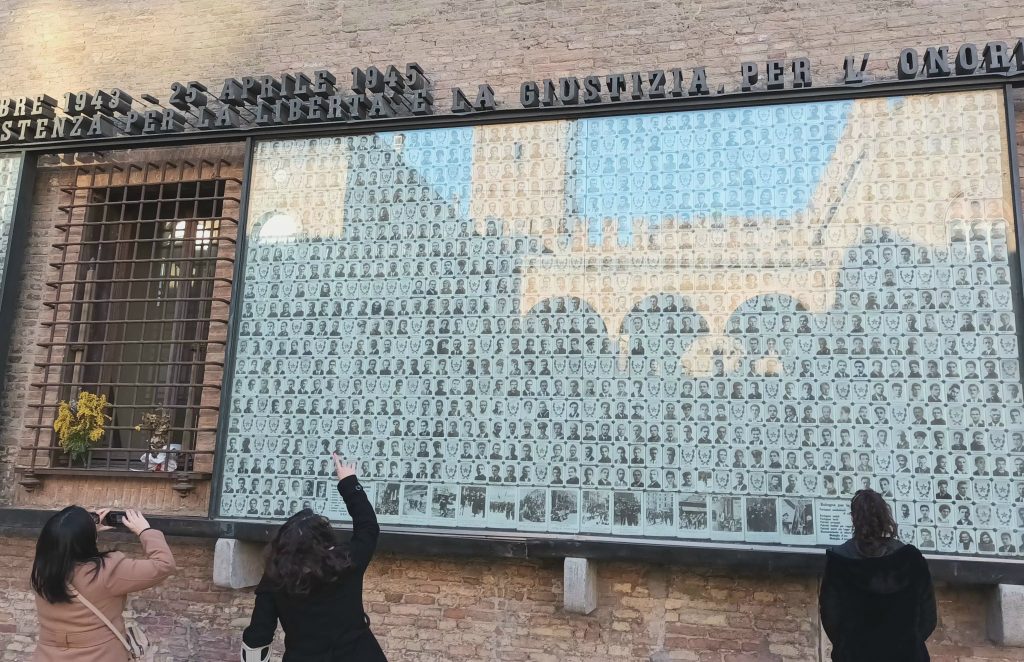
A l’extérieur du Palazzio d’Accursio est installé un hommage aux Partisans qui sont morts pour libérer Bologne lors de la Seconde Guerre mondiale. On se dirige vers le musée médiéval en prenant la rue Via dell’Independenza, passant devant l’imposante cathédrale San Pietro et les très belles et interminables arcades et ses boutiques de marques.

Vous tournez à gauche sur la Via Manzoni pour arriver au Musée médiéval , une étape importante permettant découvrir l’histoire de Bologne et la grandeur de cette ville en ces temps-là. En entrant dans le musée, on découvre un chandelier en bois ressemblant fortement à une menorah.
Entre les différentes salles de ce musée labyrinthe, sont exposées entre deux cour trois anciennes pierres tombales juives et une pierre tombale musulmane côte à côte.

Derrière la deuxième cour on trouve le Lippo di Dalmasio consacré aux œuvres du trecento et du quattrocento. On y présente des œuvres d’époque et on revient sur les liens économiques entre les Bologne et Pistoia ayant permis leur développement mutuel en cet âge d’or.
La visite se poursuit dans d’autres pièces avec notamment des fresques gothiques avec des professeurs entourés d’étudiants en cette ville du savoir. On trouve ensuite des petites statues très appréciées dans la Renaissance, d’immenses livres mêlant textes et graphisme ancien, des tenues de chevaliers.
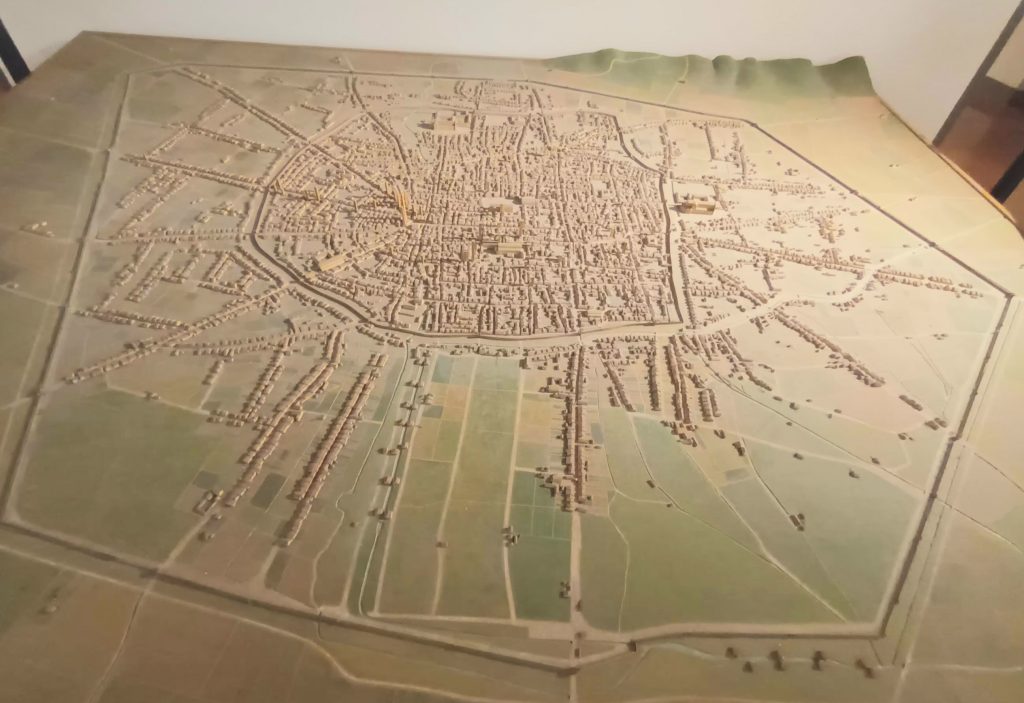
Et surtout une très belle maquette de la ville à l’époque médiévale, qui comptait au 13e siècle 50 000 habitants, une des plus peuplées d’Europe à cette époque.
En sortant du musée, vous reprenez la Via dell’Independenza vers le nord puis tournez sur la première rue à droite. Situé Via Goito, le Palazzo Bocchi fut construit en 1545 et 1565 par Jacopo Barozzi et Sebastiano Serlio.

C’est un exemple type d’architecture de la Renaissance. L’érudit Achille Bocchi y fonda son Académie littéraire. Il fit apposer sur la façade deux inscriptions. L’une en hébreu extraite du Psaume 120 « Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère, De la langue trompeuse » ; l’autre en latin, tirée d’une épître d’Horace « Conduis-toi bien et tu seras roi, disent-ils ».

Poursuivant la Via Goito, vous débouchez sur la Via Guglielmo Oberdan. Il s’agit d’un des deux accès historiques du ghetto. Sur la rue Oberdan, vous prenez la Vicolo Tibertini. On y aperçoit une carte qui décrit les anciens lieux d’habitations des juifs bolognais. L’ancienne Via del Ghetto a été rebaptisée Vicolo Mandria.

La synagogue était située Via dell’Inferno. En entrant dans cette rue, on arrive sur la Via Canonica, puis enfin Via de’ Giudei, la rue des Hébreux et Via del Carro.

Au bout de celle-ci, on arrive sur les fameuses tours de Bologne, érigées au 12e et 13e siècles. La tour Asinelli mesure 97,2 mètres et la tour Garisenda ne mesure que 48 mètres, mais a eu le mérite d’inspirer Dante. Elle a été raccourcie car elle menaçait de s’écrouler.

En remontant la Via Zamboni, reprenant la Via del Carro puis la Via Valdonica, vous arriverez au Museo Ebraico di Bologna . Ce musée juif est installé dans le palazzo Pannolini qui fut, au XVe et au XVIe siècle, l’habitation de la famille homonyme de producteurs et marchands de draps de laine.

Musée d’avant-garde, inauguré en 1999, il est divisé en deux salles. Une consacrée à l’exposition permanente et l’autre à l’accueil aux expositions temporaires. La salle permanente commence par une présentation générale du judaïsme, des différentes coutumes, communautés et évolutions de celles-ci à travers le temps.

L’ancienneté des communautés italiennes est soulignée et leur accueil à l’enthousiasme fluctuant selon les dirigeants politiques et religieux des différentes époques depuis l’Antiquité. Un panneau indique que les juifs étaient présents dans 37 villes et villages. On parcourt l’histoire antique et contemporaine.
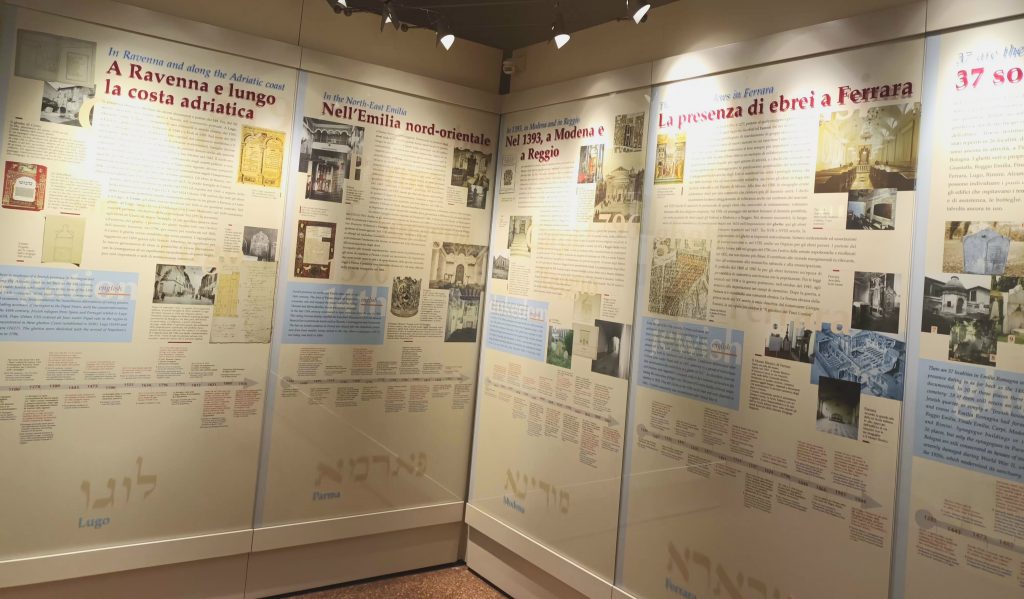
Une petite salle est également réservée à un monument en mémoire des déportés de la région dans les camps.
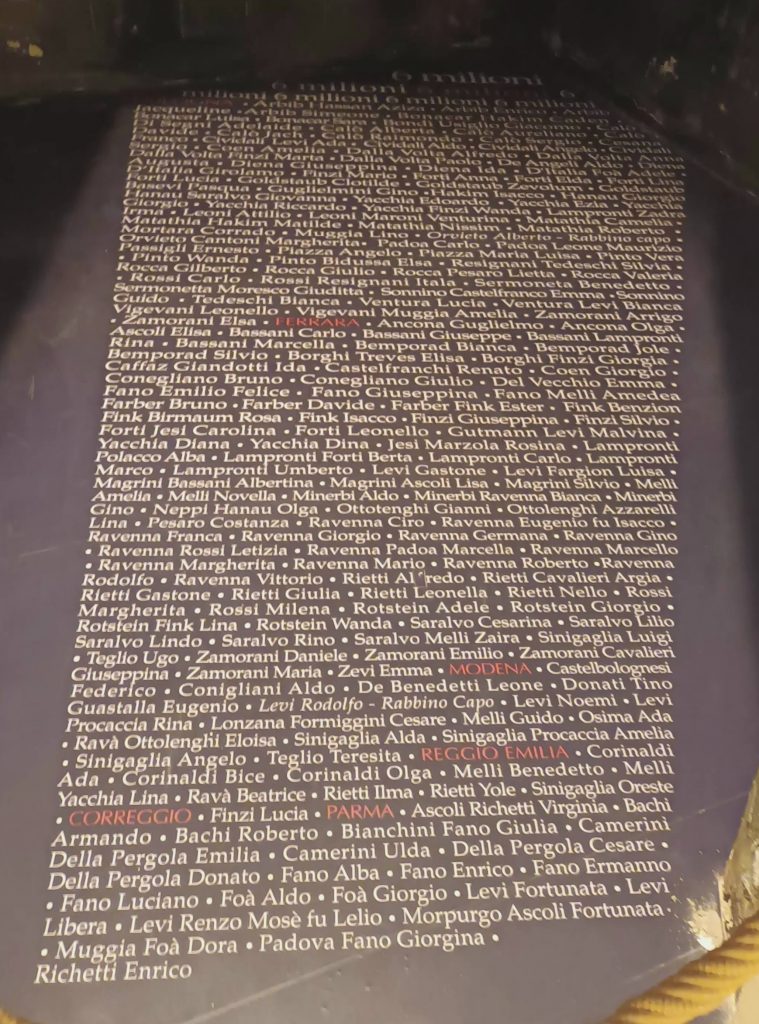
En traversant la place Verdi, le théâtre communal et le conservatoire avec son grand resto où se retrouvent de nombreux étudiants on arrive à l’Université de Bologne .

Fondée en 1088, il s’agit de la plus ancienne d’Europe ! Elle forme un grand complexe, divisée en départements d’études : physique, sciences naturelles, humanités, droit, littérature…
A l’entrée de l’université qui mène au musée, on trouve une plaque en mémoire des étudiants juifs qui subirent les lois de discriminations raciales en 1938, sous le régime mussolinien.
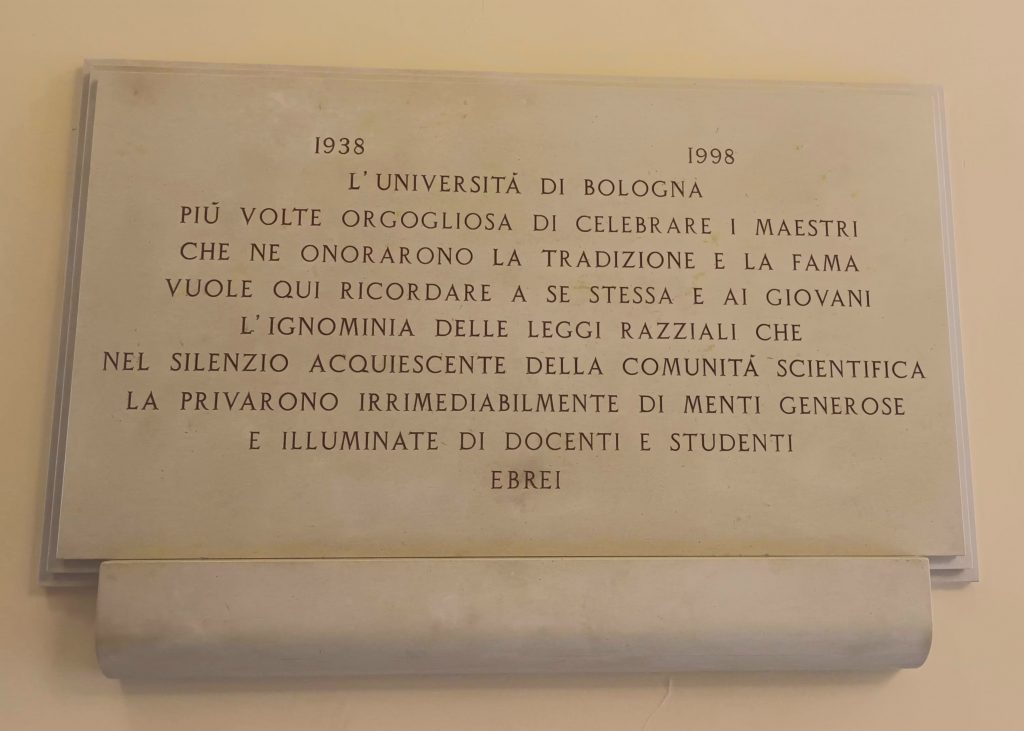
Dans le musée, lorsqu’on entre à gauche, on traverse différentes salles célébrant les découvertes scientifiques et tous les êtres courageux qui ont permis et accompagnés ces découvertes lors de luttes politiques et religieuses, en encourageant les rencontres et la curiosité. Le résultat étant bien entendu le développement de l’université accompagnant le statut de Bologne comme une des cinq villes européennes du Moyen âge.
En entrant à droite dans le musée, on aperçoit une salle dédiée à la stratégie militaire, avec les plans des forteresses, bateaux de guerre et anciens canons. Puis, une salle d’initiation à la science pour les enfants. A côté de laquelle était présenté en 2024 des œuvres artistiques japonaises du 20e siècle.
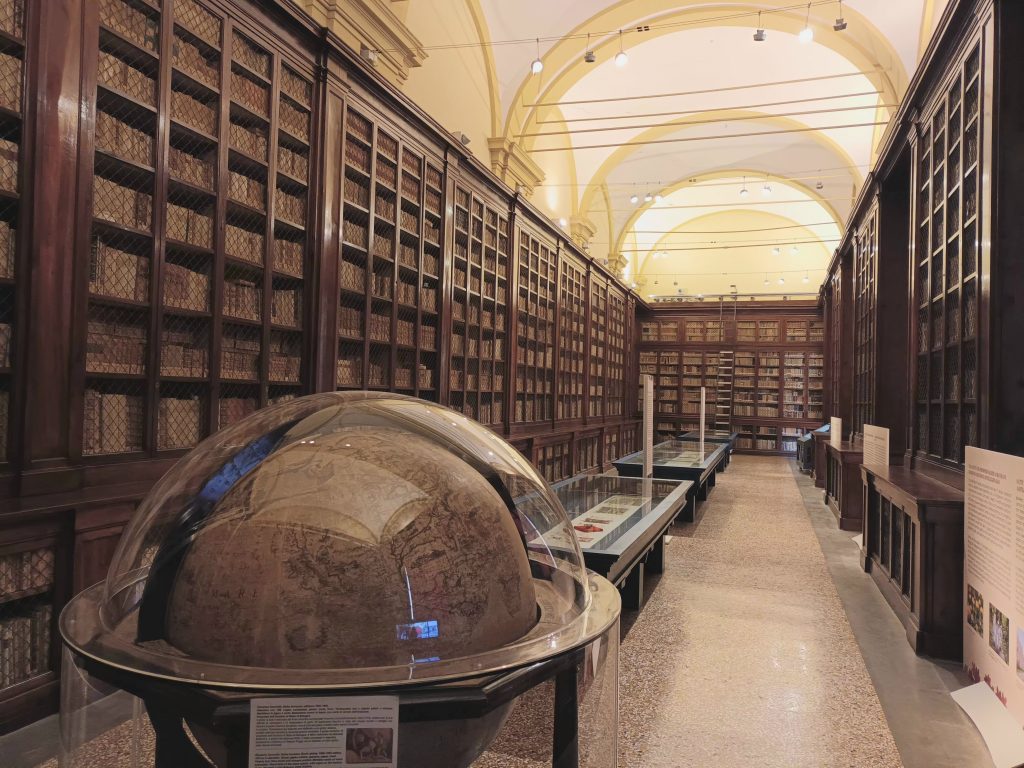
L’expo se termine par la très impressionnante et ancienne bibliothèque de l’université. A l’entrée de la bibliothèque nouvelle on trouve le buste d’un ancien étudiant, un certain Dante !
En sortant de l’université, vous vous dirigez vers la Via Irnerio pour arrivez sur la Piazza dell’8 Agosto qui accueille un grand marché. A sa droite, vous montez les marches du Parco della Montagnola. Un jardin aux étonnantes statues et fresques représentant les luttes entre animaux et êtres mythologiques, ainsi que des luttes historiques. Ces œuvres entourent la fontaine, et les nombreux enfants qui y jouent une fois l’école terminée.

En haut à gauche du jardin, vous verrez la Porta Galliera et en dessous et à côté les ruines anciennes. La gare se trouve juste en face. Derrière elle, à l’extérieure donc des enceintes de la ville, est situé le mémorial de la Shoah .

Inauguré le 27 janvier 2016, il se trouve au croisement de Via dé Carracci et Via Giacomo Matteotti. Deux rectangles en acier se font face. Entre eux, un couloir qui commence avec une largeur de 1.60 mètres et va en se rétrécissant jusqu’à 80 cm pour générer un sentiment d’oppression. L’intérieur des parallélépipèdes est un rappel aux dortoirs d’Auschwitz. Le sol est en ballast, comme les pierres fabriquées par les prisonniers Auschwitz I et II. Enfin, le choix de l’acier, une matière qui rouille et s’altère avec le temps est délibéré.

La très ancienne communauté juive de la ville, renforcée par l’arrivée de juifs d’Espagne au début du XVIe siècle, se réduisit de plus en plus dès les XVIIe et XVIIIe siècles avec le développement de Livourne.
L’actuelle synagogue, construite en 1756, a été plusieurs fois remaniée, notamment à la fin du XIXe siècle.

La visite s’impose au nom de la mémoire, même si les opérations d’urbanisme du début du siècle autour du port et les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, en 1943-1944, ont détruit la plus grande partie du centre-ville, comme la Livourne juive, notamment la Grande Synagogue.
Dans aucune cité italienne, les juifs ne jouèrent un tel rôle, et jamais ils n’y furent contraints à vivre dans un ghetto. Ils furent les vrais fondateurs de la ville et les maîtres d’œuvre de sa splendeur, appelés par le grand-duc de Toscane qui, avec l’édit de la Livornina du 10 juin 1593, leur garantissait, pour vingt-cinq ans renouvelables, la liberté du commerce, le droit de s’installer où ils voulaient sans porter les signes de l’opprobre comme les autres juifs du duché. Ils pouvaient avoir des serviteurs chrétiens, rouler en carrosse, etc. Mieux, Ferdinand Ier leur offrait sa protection contre l’Inquisition : « Nous désirons que, pendant ladite période, aucune inquisition, inspection, dénonciation ou accusation ne soit prononcée contre vous et vos familles, même si, dans le passé, elles ont vécu hors de nos dominions en tant que chrétiennes ou dénommées comme telles. »

Les marranes furent donc naturellement très nombreux dans la cité. Cette petite ville d’un littoral ravagé par les fièvres devint en quelques années un port florissant où la communauté juive jouait un rôle de tout premier plan. L’espagnol était sa langue officielle, le judéo-espagnol sa langue de tous les jours, utilisée d’ailleurs par tous les expulsés d’Espagne, à Salonique comme dans les autres ports du Levant. Puis, peu à peu, les juifs livournais créèrent un nouveau dialecte que les plus âgés parlent toujours, le bagitto, mélange d’espagnol, d’hébreu et de dialecte local.
La communauté livournaise connut son apogée aux XVIIe et XVIIIe siècles. Son déclin commença avec l’arrivée des troupes de Bonaparte, pourtant favorable aux autres juifs de la péninsule. Le blocus pénalisait le port. Avec l’unité italienne et l’émancipation, les juifs de Livourne émigrèrent vers Florence ou Rome. En 1900, il ne restait plus dans la ville que 2500 juifs, une diminution de moitié en cinquante ans. La Seconde Guerre mondiale et les déportations nazies faillirent donner le coup de grâce à la communauté, réduite aujourd’hui à 800 membres.

Achevée en 1962, la nouvelle synagogue , édifice de béton aux formes futuristes de l’architecte romain Angelo Di Castro, se dresse piazza Benamozegh (l’ancienne piazza del Tempio) où s’élevait le temple détruit par les bombardements de 1944. Le magnifique aron, du début du XVIIIe siècle, en bois doré et finement sculpté, provient de la vieille synagogue de Pesaro, dans les Marches.
Dans la toute proche via Micali, se trouve l’oratoire Marini qui, pendant toute l’après-guerre et jusqu’à la construction de la Nouvelle Synagogue, servait aux offices religieux. Au fond de la salle presque carrée de la yeshiva, on peut voir un extraordinaire aron de bois doré, aux décors floraux très finement travaillés. Il daterait du XVe siècle et serait arrivé à Livourne avec des juifs chassés d’Espagne. Certains experts estiment, néanmoins, que ce chef-d’œuvre est d’une facture plus tardive. Dans ce même bâtiment se trouve aussi le Musée juif qui regroupe, dans deux vitrines, quelques beaux objets liturgiques.

Le ghetto fut instauré dans cette ville en 1571, à la même période qu’à Florence. Une importante communauté juive vivait dans la ville, et des documents du début du XIIIe siècle évoquent déjà une universita iudarum. Le quartier juif s’élevait au cœur de la cité, près de la piazza Campo et s’étendait entre les actuelles via San Martino et via di Salicotto. Les étroites ruelles aux hautes maisons ont été en partie détruites pendant les travaux d’urbanisme de 1935, mais certaines ont gardé un peu de leur aspect original, comme dans la via delle Scotte, tout près de la synagogue, et parfois leurs noms (vicolo della Fortuna, vicolo della Manna).

La synagogue , de belle facture néo-classique, a été édifiée en 1756 sur les plans de l’architecte florentin Giuseppe Del Rosso. Sa construction dura trente ans. La grande salle, très haute de plafond, possède, au centre, une élégante bimah de bois sculpté, ornée de chandeliers à neuf branches. Les fenêtres sont entourées de moulures de colonnes ioniennes, et les murs sont ornés de quatorze versets bibliques au milieu de stucs baroques. Le bel aron du XVIIIe siècle est entouré de colonnes de marbre corinthiennes. En 2024, la communauté juive de Florence organisa une collecte de fonds afin de sauver la synagogue de Sienne, très endommagée suite au tremblement de terre de février 2023.
En face, dans la via degli Archi, s’élève l’ancienne fontaine du ghetto, qui était ornée d’une belle statue de Moïse. Celle-ci fut enlevée au siècle dernier sous la pression de juifs orthodoxes s’indignant de cette transgression de l’interdiction de la représentation humaine. Elle est depuis au Musée communal .
Aux portes de la ville, via Certosa, on peut aussi voir l’ancien cimetière juif dont les plus vieilles tombes datent du XVIe siècle.
À l’extrême sud de la Toscane, au milieu des collines et des cyprès, s’élève sur un piton rocheux cette bourgade qui fut jadis surnommée « la petite Jérusalem » par les juifs de Toscane. Une telle appellation n’est pas sans emphase, mais l’histoire de cette communauté, formée à l’origine de juifs fuyant les États du pape après les édits de 1555, est étonnante.

Ils y restèrent pendant presque quatre siècles, formellement en ghetto après 1622, mais commerçant ou travaillant même la terre dans une tranquillité quasi-parfaite, qui fut interrompue, en 1799, par des violences francophobes qui s’en prirent aux juifs, accusés d’être complices des idées nouvelles. Le recensement de 1841 enregistrait 3189 résidents, dont 359 juifs, soit un habitant sur dix.
Après l’émancipation en 1859, les juifs de Pitigliano restèrent sur place jusqu’au début du siècle, bénissant les temps et prénommant leurs enfants Garibaldi ou Mazzini, des noms des héros du Risorgimento. Puis, la communauté dépérit au profit de celle de Florence et de la capitale. Il reste toutefois un vin blanc casher, qui est le meilleur d’Italie, et une vieille synagogue, datant du XVIe siècle et refaite au XVIIIe siècle. Effondrée depuis les années 1960, elle a été restaurée et rouverte au public en 1995. Elle se dresse dans l’ancien quartier juif, au pied du château Orsini, à côté de l’ancien four à pain. Seul un mur de la synagogue , celui de la galerie des femmes, était demeuré intact. Le reste a été soigneusement reconstitué avec ses stucs dorés, ses inscriptions saintes en hébreu et les plaques commémorant la visite dans le temple, au début du XIXe siècle, des grands-ducs de Toscane, Ferdinand III et Leopold II.

L’ancien ghetto, créé en 1571, se situait au cœur de la vieille ville, près du marché, dans une zone totalement détruite à la fin du siècle dernier, qui se situait entre les actuelles via Brunelleschi, piazza della Repubblica et via Roma. Bernardo Buontalento, l’architecte du Grand Duc, fut chargé de la réalisation de ce quartier de réclusion. Les ruelles donnant sur le pâté de maisons furent murées à l’exception de deux portes, fermées le soir.

Là, comme à Sienne, s’entassèrent, dans un labyrinthe de venelles et de cours, les juifs venus de tous les villages et petites villes de Toscane. Ils étaient aussi exclus des corporations, et la fripe était leur seule activité autorisée. Ils restèrent dans le ghetto pendant presque trois siècles, jusqu’en 1848. Deux synagogues, l’une de rite italien, l’autre espagnol, furent détruites en même temps que le vieux quartier juif à la fin du siècle dernier. En 1882, peu avant l’inauguration du Grand Temple, furent ouverts deux petits oratoires, le premier de rite italien, et le second ashkénaze, installé, comme le commémore une plaque, dans un immeuble au no 4 de la via delle Oche, qui était le siège de la confraternité Mattir Assurim. Ils fonctionnèrent jusqu’en 1962.
L’imposant bâtiment de style néo- mauresque du Tempio maggiore a été inauguré en 1882, après huit années de travaux. Dessinée par Marco Treves, aidé par les architectes Mariano Falcini et Vincenzo Micheli, cette synagogue, à la majestueuse façade de pierre blanche et rose, est dominée par une grande coupole verte à laquelle répondent deux petits minarets sur le devant. Les Tables de la Loi surmontent le fronton. L’intérieur est somptueux, avec de riches décorations dans le style mauresque, des arcades, de fines colonnes et, au fond, une abside semi-circulaire où trônent l’aron et la bimah, séparés du reste de la salle de prière par une grille finement ouvragée. Les mosaïques et les fresques d’or et d’azur sont l’œuvre de Giovanni Panti. Pendant la guerre, les nazis utilisèrent le temple comme garage militaire et tentèrent de le dynamiter pendant leur retraite, sans grands dommages. Soigneusement restaurée, la synagogue subit en 1966 la grande crue de l’Arno qui l’emplit de quelque 2 mètres d’eau. Une grande partie des 15 000 volumes de la bibliothèque fut gravement endommagée.
La façade de la basilique Santa Croce
Elle est ornée d’une grande étoile de David qui intrigue volontiers le curieux. Dans leur Guida all’Italia ebraica, Annie Sacerdoti et Luca Fiorentino3 en racontent l’étrange origine : « En 1860, on décida d’enrichir de marbre polychrome la façade gothique du XIIIe siècle de l’église et le travail fut confié à l’architecte Nicolò Matas, juif originaire d’Ancône, qui intégra dans son projet cette grande étoile comme élément de décoration. Personne ne fit attention à l’origine juive de l’architecte, même s’il avait spécifié dans son contrat qu’il ne travaillerait pas le samedi. Au moment de sa mort, il mit encore plus dans l’embarras la communauté juive et les franciscains de Santa Croce, exigeant dans son testament d’être enseveli dans la basilique. Un compromis fut finalement trouvé: il est enterré juste à l’extérieur sous la rampe des escaliers face à l’entrée principale. »
Le Musée juif, ouvert en 1981, se trouve au premier étage de la synagogue, dans une vaste salle divisée en deux parties: l’une rassemble des photos et des témoignages iconographiques sur la vie des juifs florentins, l’autre, de très beaux objets rituels, notamment de l’argenterie et des broderies. Vous admirerez un très bel et très ancien rimmon, datant de la fin du XVIe siècle. À la sortie du musée, une grande plaque commémore les 248 juifs de la ville déportés et morts dans les camps ou exécutés par représailles.
Rencontre avec Emanuele Viterbo, Responsable de la Communauté juive de Florence
Jguideeurope : Comment le Musée juif de Florence a-t-il été créé?
Emanuele Viterbo : La conception du Musée juif de Florence, fortement soutenu par le rabbin Fernando Belgrado, a été lancée en 1981 à la suite du don de Marta del Mar Bigiavi. La première exposition occupait le premier étage dans une salle derrière la galerie des femmes et comprenait la section historique et les meubles et accessoires de maison du culte de la synagogue. Le projet a été conçu par l’architecte Alberto Boralevi, avec la conception de l’exposition par Dora Smooth. La deuxième partie du musée, ouverte en 2007, est située au dernier étage, et a été conçue par l’architecte Renzo Funaro en collaboration avec l’architecte Michael Tarroni. Elle et a été créée par Dora Smooth et pour la section industrie textile par Laura Zaccagnini.

Le musée a été divisé en deux sections : le premier étage contient le mobilier cérémoniel utilisé dans la synagogue, dans ce dernier ont été déplacés vers des objets pour le culte domestique. Une salle, organisée par Renzo Funaro et Liana Funaro, était consacrée à l’Holocauste.
Le choix des salles et de l’aménagement du musée a été fait sur la base de considérations muséologiques et de conservation. Tout d’abord, il a été décidé de l’installer dans le Temple qui, en raison de son importance artistique et historique pour sa monumentalité, représente non seulement l’idéal, mais est devenu une partie intégrante du cours de l’histoire juive à Florence. Les caves, bien que belles et impressionnantes, mais qui n’avaient pas de politique de sécurité en raison du danger d’inondations (dont la dernière, en 1966, s’élevait à deux mètres de hauteur au-dessus du dénivelé créé par les marches extérieures), ont été mis au rebut. C’est un musée relativement petit, mais très impressionnant.
Les collections du Musée juif de Florence sont réparties sur deux étages à l’intérieur de la synagogue.
La première section documente l’histoire des Juifs de Florence au cours des siècles et leur relation avec la ville. Dans les vitrines se trouvent des meubles, du textile et de l’argent, utilisés pour les cérémonies de la synagogue entre la fin des XVIe et XIXe siècles. Au deuxième étage, dans une salle avec une belle vue sur l’intérieur du temple, il y a des objets et du mobilier de dévotion domestique et privée, illustrant les moments forts des festivités et de la vie religieuse d’un juif comme la naissance, le mariage et les cérémonies religieuses. Beaucoup de ces objets sont des cadeaux de familles juives qui voulaient témoigner ainsi de leur attachement à la Communauté. Personnages importants de la communauté dans le chevalier David Levi, qui a laissé sa fortune pour construire la synagogue, et aidé le rabbin Shmuel Zvi Margulies, d’origine polonaise, qui a renouvelé le Collège rabbinique italien et l’a amené à Florence.
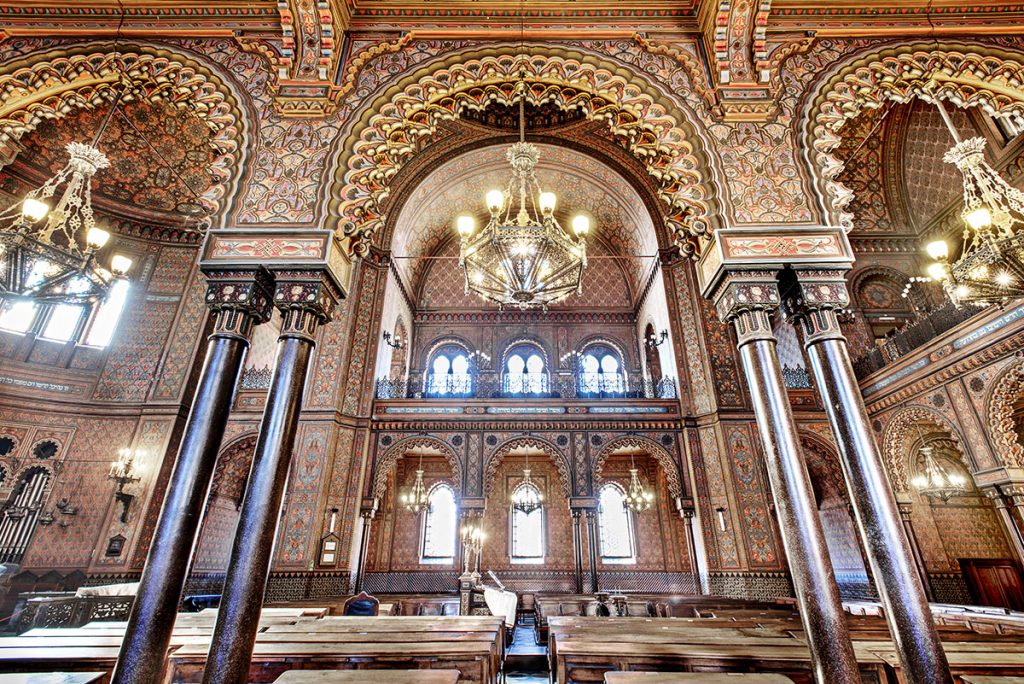
La visite se poursuit avec un film qui présente l’histoire de la communauté au cours des deux derniers siècles, et une salle du souvenir, où des photos et des archives de la vie des juifs à Florence. Selon l’évolution historique : l’égalité retrouvée après l’âge des ghettos, la persécution, les lois raciales, et la déportation vers les camps de la mort, la renaissance et la reconstruction après la guerre. Une salle informatique relie le musée de Florence aux principaux musées juifs du monde et replace la vie juive florentine dans un contexte très large.
Le musée se compose d’une première section, qui documente l’histoire du juif florentin de naissance, en 1437, au moment de la fondation du Ghetto, son extension en 1571, et de nouveau de 1704 à 1721, jusqu’à la démolition du dernier décennie du XIXe siècle. Ceci est illustré par des photographies de plantes, des images du ghetto détruit et d’anciennes synagogues. Des images plus récentes illustrent l’histoire de la conception et de la construction du temple. Il y a aussi un clin d’œil aux autres sites de la Florence juive.
La plupart des meubles proviennent de deux synagogues du Ghetto, que les Italiens ont ouvertes après la création du quartier destiné à être assigné à résidence par les Juifs en 1571, et les Espagnols et Levantins, ouverts quelques années plus tard, auxquels ont été ajoutés les objets qui appartenaient aux synagogues d’Arezzo et de Lippiano – communautés aujourd’hui éteintes – et près de la synagogue, pour laquelle elles ont été spécialement conçues. Un espace considérable est consacré aux ornements du Sefer Torah, les rouleaux de parchemin sur lesquels la Bible hébraïque est écrite.

La deuxième partie du musée, ouverte au dernier étage en 2007, est une collection d’objets et de dessins qui résument les origines de la communauté juive de Florence.
Si le chevalier David Levi est le symbole de l’excellence du judaïsme italien (illustré dans «l’italien», un beau portrait d’Antonio Ciseri en 1854), le noyau des juifs les plus influents était d’origine séfarade, originaire d’Espagne, par la suite, des pays d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Ici, vous pouvez voir des objets significatifs qui illustrent les moments les plus importants de la vie et des fêtes religieuses, avec des meubles personnels ou ménagers organisés par type et selon différentes occasions. La famille a un rôle très important dans la religion juive.
La plupart des six cents commandements (mitsvot) sont mis en pratique dans la vie quotidienne. De nombreuses expositions du musée retracent l’histoire d’une importante famille florentine, la famille Ambron-Errera, dont l’histoire peut être vue ici.

Tempio Maggiore est considérée comme l’une des plus belles synagogues d’Europe. Comment son style a-t-il été imaginé ?
La synagogue de Florence a été inaugurée en 1882, pas plus longtemps après l’émancipation des juifs italiens qui a été proclamée en 1861 lors de la création du royaume d’Italie. La synagogue de Florence est l’un des plus beaux exemples d’Europe d’un mélange du style mauresque exotique avec des éléments arabes et byzantins qui caractérisent la façade en travertin blanc et calcaire rose, le revêtement en cuivre sur les dômes central et latéral (à l’origine, ils étaient dorés), et les portes en noyer massif. Le style se reflète également dans les décorations et les meubles intérieurs. La communauté débattait sur une nouvelle synagogue depuis 1847, mais le manque de fonds empêchait de prendre des mesures concrètes. Puis, en 1868, le cavalier David Levi lègue l’argent pour la construction d’un « Temple monumental digne de Florence ». Deux ans plus tard, en 1870, trois architectes, Mariano Falcini, Marco Treves et Vincenco Micheli, ont été nommés pour concevoir le temple.
L’emplacement a finalement été choisi après de longues discussions entre les factions qui le voulaient dans le centre-ville et le groupe qui préférait un site à l’extérieur. Ce dernier a prévalu et le choix s’est porté sur le quartier « Mattonaia » qui, bien que toujours à l’intérieur des murs de la ville, n’était pas complètement développé, en effet il y avait encore de nombreux parcs et jardins. Le nouveau temple a été ouvert le 24 octobre 1882.
Deux approches apparemment opposées, mais en fait liées, ont influencé la conception. D’une part, il y avait l’influence des églises chrétiennes et des anciennes synagogues espagnoles, et d’autre part le désir d’exprimer l’identité juive à travers un style architectural distinctif. Le résultat final, « l’enfant » de l’éclectisme du XIXe siècle, était quelque chose de nouveau qui combinait des éléments maures, byzantins et romans.
Comment la Résistance a-t-elle sauvé le Tempio Maggiore de la destruction pendant la guerre?
En 1938, le régime fasciste a promulgué des lois raciales qui privaient les Juifs de travail et de scolarité, entre autres restrictions et les appelait une « race inférieure ». En septembre 1943, les nazis ont effectivement pris le contrôle d’une grande partie du pays. Certains juifs se sont sauvés en fuyant à l’étranger tandis que d’autres se sont cachés et ont été abrités par la population locale. Au total, 9 000 Juifs italiens ont été déportés ou tués, dont plus de 500 originaires de Florence. Après la guerre, l’école juive a été rouverte et la synagogue a été rénovée.

Les juifs de la capitale italienne sont peut-être les plus vieux Romains de souche : ils sont installés depuis 2000 ans dans les mêmes quartiers du cœur de la Ville éternelle, l’ancien ghetto et le Trastevere, de part et d’autre du Tibre au niveau du pont Fabricio ou des Quattro Capi.

S’il est le plus ancien de la péninsule, le judaïsme romain représente aussi aujourd’hui la communauté la plus importante, la plus vivante et la plus fortement enracinée, possédant son propre dialecte mélangé de mots hébreux et sa propre tradition culinaire. Cette résidence doublement millénaire en un même lieu, sans équivalent hors d’Israël, a laissé de nombreux monuments de toutes les époques, depuis les catacombes juives ou la synagogue d’Ostia Antica jusqu’au Grand Temple construit au début du XXe siècle sur l’emplacement de l’ancien ghetto.

La visite de la Roma ebraica mérite au moins cinq jours. Aux riches vestiges de l’histoire juive proprement dite, s’ajoutent en effet, dans cette capitale de la chrétienté, beaucoup de témoignages sur la politique des papes qui, parfois pour le meilleur et le plus souvent pour le pire, conditionnèrent la vie des juifs de Rome sinon de tout l’Occident.

Certains de ses plats font désormais pleinement partie de la gastronomie romaine et figurent au menu de nombreux restaurants. C’est notamment le cas des carcioffi alla giudea (« artichauts à la juive »): l’artichaut, dont les petites feuilles craquent merveilleusement sous la dent, est frit dans l’huile. La cuisine traditionnelle du petit peuple de la Ville éternelle est à base d’ingrédients pauvres, de bas morceaux et de beaucoup de légumes. Ces caractères sont encore plus accentués dans les plats typiques des juifs de la capitale, confinés trois siècles durant dans la misère du ghetto.

Beaucoup de recettes, notamment pour le poisson, sont agro-dolci (« aigre-doux», avec sucre, vinaigre, pignons et raisins secs), témoignant ainsi d’une tradition qui remonterait à l’époque romaine. Les fritures se taillent la part du lion avec, outre les artichauts déjà mentionnés, les beignets de fiori di zucchine (« fleurs de courgette » farcies de mozzarella et d’anchois) ou le fritto di baccalà (« beignet de morue salée »). Les recettes de pâtes et de soupes tiennent bien au corps, comme la traditionnelle ceci e pennerelli (« pois chiches et petits restes de viande ») que l’on fait mijoter à feu très doux pendant trois heures.
L’ancien ghetto
Ce quartier, où les juifs furent forcés de résider pendant trois siècles jusqu’en 1870, est au centre de la capitale italienne, entre le largo Argentina, le Capitole et le Tibre. Il ne reste presque rien des étouffantes venelles du vieux serraglio degli ebrei, détruit, assaini et reconstruit dans les premières années du siècle dernier. Mais des ruelles avoisinantes, comme la via della Reginella, ou le début de la via Sant’Angelo in Pescheria, permettent de se faire une idée de ce que fut, pendant plus de 300 ans, la vie des juifs de la ville.

Le Portico d’Ottavia, construit par Cecilius Metella en 146 avant Jésus-Christ, avec ses restes de colonnes cannelées du grand temple de Junon surgissant au milieu des gros pavés de la via del Portico d’Ottavia, demeure le lieu symbolique de l’ancien ghetto romain.
Des restaurants étalent leurs tables sur le trottoir et les habitants du lieu prennent le frais sur des chaises. Ce portique marquait l’une des cinq issues de ce quartier de résidence forcée. Elle était barrée la nuit d’une grosse chaîne de fer.
La piazza delle Cinque Scole entoure une fontaine de Giacomo della Porta (1591, reconstruite en 1930), dédiée au souvenir des cinq synagogues de l’ancien ghetto (Catalana, Castigliana, Tempio, Siciliana, Nova), toutes regroupées en un seul bâtiment aujourd’hui disparu, qui s’élevait au niveau du no 37 de la place actuelle. Celle-ci a été construite sur le site de l’ancienne platea judea : la grande place, divisée en deux parties par le mur du ghetto, qui était le point d’arrivée des deux anciennes rues principales du quartier juif, la via Pescaria et la via Rua.
C’était sur la platea judea, à la fois dans et hors du ghetto, que se déroulaient les activités économiques consenties aux juifs de Rome, comme le commerce de vieilles hardes, un marché d’objets usagés et quelques activités artisanales.
Dans les moments de tolérance, ces étals pouvaient être ouverts le dimanche, et les paysans montés en ville qui ne voulaient pas perdre un jour y venaient faire leurs achats.
La piazza delle Cinque Scole reste aujourd’hui le cœur du quartier avec ses magasins, notamment la pâtisserie dite de Boccione, qui vend les gâteaux typiques de la tradition juive romaine, comme cette extraordinaire tarte à la ricotta (fromage blanc).
Près de là, est aussi installée la librairie Menorah , très bien fournie en ouvrages modernes ou anciens sur le judaïsme, en italien, en français et en anglais.
En remontant cette rue étroite et sombre vers la place de Mattei, ornée d’une magnifique fontaine « des tortues» construite en 1581- 1584, il est possible d’avoir une idée de ce qu’était le ghetto. Les blocs d’immeubles situés entre la via Reginella et la via Sant’Ambrogio avaient été inclus dans le quartier juif, que le pape Léon XIII daigna un peu élargir en 1823.
À l’autre extrémité de l’ancien quartier juif, en allant vers le Tibre et le Grand Temple, se dresse la petite église de San Gregorio alla Divina Pietà, construite au XVIIIe siècle face à l’une des portes du ghetto. Sa façade est ornée d’une inscription en latin et en hébreu citant le prophète Isaïe s’adressant « à ce peuple rebelle qui agit selon ses idées dans une voie qui n’est pas bonne, à ce peuple qui continuellement provoque ma colère ». C’était l’un des lieux où, chaque dimanche, des représentants de la communauté juive étaient obligés d’écouter la messe chrétienne.
Il est difficile de procéder à la « pesée » des différences et des points communs. Les Juifs, via leurs communautés et les discours qu’elles leur tiennent, via leurs pratiques socio-culturelles ou matrimoniales,
Le Grand Temple
Sa coupole de zinc s’élève à 46 m au-dessus de la rue et se voit de tout Rome, dressée au milieu des autres coupoles baroques des nombreuses églises de la Ville éternelle.

Elle est aisément reconnaissable par sa section carrée. Construit entre 1901 et 1904, le Grand Temple de la capitale, de style oriental, que d’aucuns appellent ironiquement néo-babylonien, célébrait, à peine plus de trente ans après la fin du ghetto, la liberté des juifs italiens et leur extraordinaire intégration. « Entre le Capitole et le Janicule, entre le monument à Victor Emmanuel et celui à Garibaldi, les deux grands maîtres d’œuvre de notre Italie, se dresse ce temple majestueux entouré du libre et pur soleil, indice de liberté, d’égalité et d’amour », affirmait lors de l’inauguration le président des communautés, Angelo Sereni, dans une rhétorique un peu pompeuse, traduisant bien l’état d’esprit de ses coreligionnaires à l’époque.

Entouré d’un beau jardin orné de palmiers, le bâtiment avait été construit sur un grand terrain de 3000 m2 provenant de la démolition de l’ancien ghetto complètement rasé peu avant et remplacé par des grands immeubles liberty. Ses deux architectes Vincenzo Costa et Osvaldo Armani étaient des « gentils», car il n’y avait pas encore de professionnels juifs confirmés. La façade décorée de palmes, avec ses trois amples fenêtres, est couronnée par un tympan orné des Tables de la Loi, surmontées du chandelier à sept branches. L’intérieur de la grande salle est somptueux. Orné de colonnes de marbre en style orientalisant, l’aron, en haut des marches d’une tribune au bout de la nef, évoque quelque peu un autel d’église, comme dans la plupart des synagogues construites au moment de l’émancipation.

Une abondante lumière provient des grandes fenêtres aux décorations liberty. L’intérieur de la grande coupole est orné de peintures orientalisantes (palmes et ciel étoilé) d’Annibale Brugnoli et de Domenico Bruschi.
Dans les salles du Grand Temple, a été regroupée une grande partie du patrimoine provenant des cinque scole, les cinq synagogues de l’ancien ghetto, avec notamment les aronot aux magnifiques colonnes de marbre de la scola Siciliana datant de 1586 et celui de la scola Castigliana commencé en 1642.
Le Temple espagnol, installé depuis 1932 dans une partie du Grand Temple, perpétue la tradition des juifs venus de la péninsule Ibérique, alors que la majorité de la communauté est désormais de rite italien. La salle avec l’aron et la tévah se faisant face évoque l’atmosphère de ce qu’étaient les scole romaines, aujourd’hui disparues.
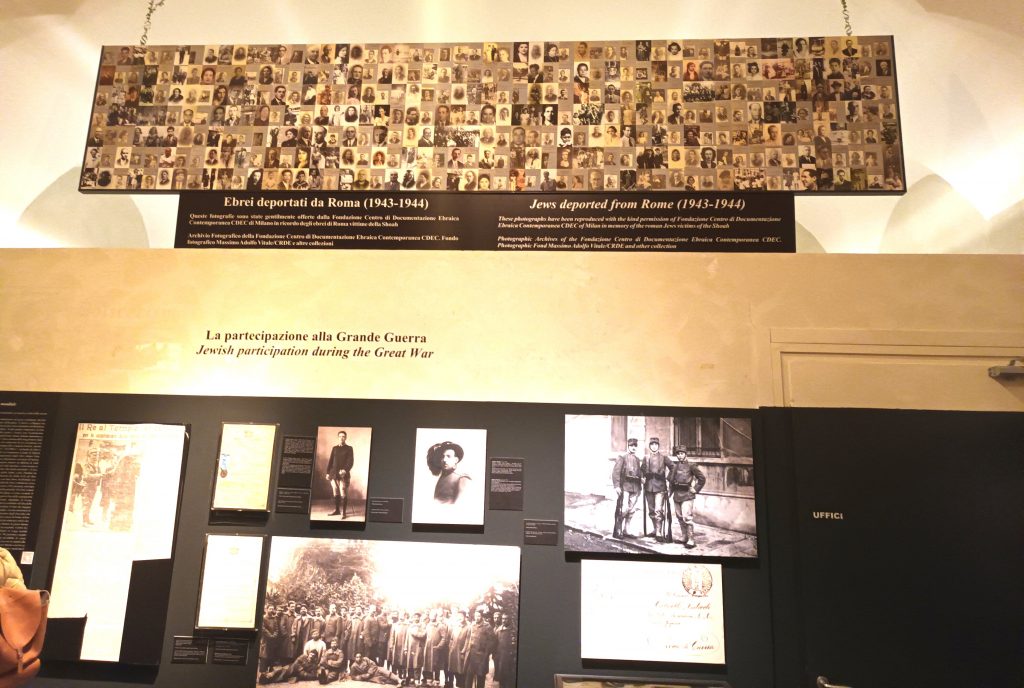
Le Musée juif occupe l’une des ailes du Grand Temple. Dans deux vastes salles, sont exposés de nombreux objets rituels en argent, des sièges de circoncision, des chandeliers, des tissus, des manuscrits, dont les trois volumes de poèmes en judéo-romain de Crescenzo del Monte (1868-1935).
L’île du Tibre et le Trastevere
Consacrée dans la Rome antique à Esculape, le dieu de la médecine, et toujours site d’hospices ou d’hôpitaux depuis le Moyen Âge, l’Isola tiberina – seule île sur le cours du fleuve dans la ville – reliait les quartiers juifs de part et d’autre du Tibre, d’où le nom de pons judeorum donné encore au XIe siècle au ponte Fabricio ou des Quattro Capi. Là, s’installèrent en 1870 les confraternités de l’ex-ghetto pour créer les structures d’assistance aux juifs désormais émancipés.
D’un côté de la rue centrale de l’île, vers l’amont, se dressent l’hôpital israélite et l’oratoire Panzieri-Fatucci , dit tempio dei giovanni, avec un aron en bois du XIXe siècle provenant des cinquescole, et des vitraux vivement colorés représentant les fêtes juives, réalisés en 1988.
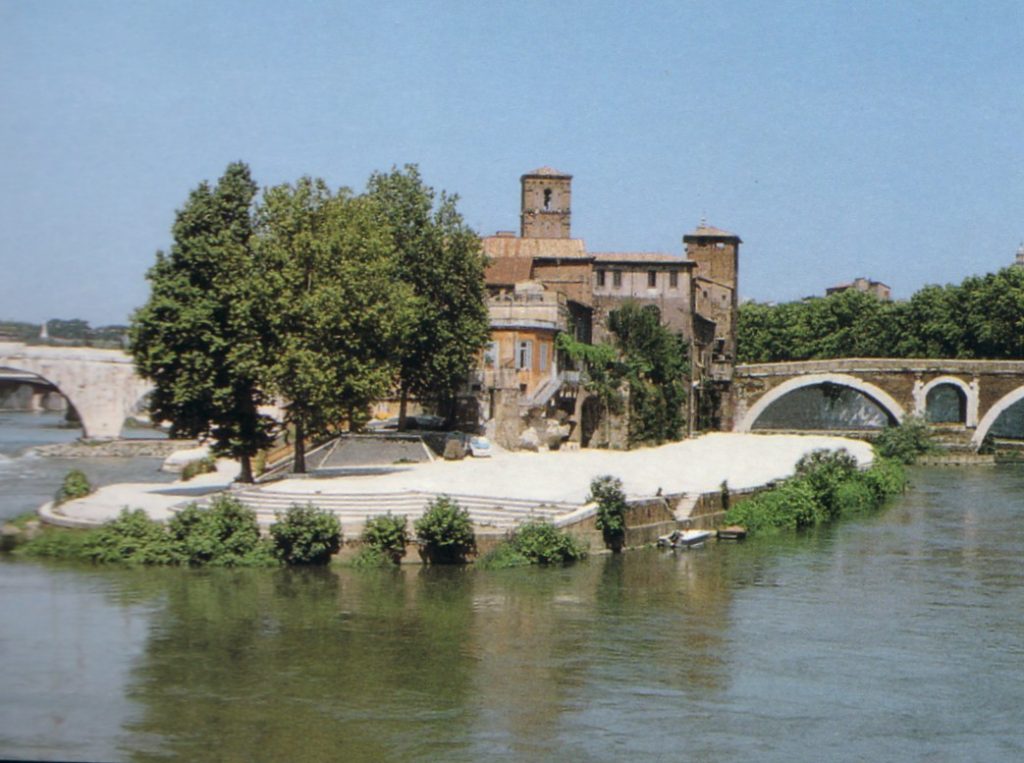
Sur l’autre rive du fleuve, commence le Trastevere (littéralement « au-delà du Tibre »), où, sous la Rome impériale comme à l’époque médiévale, vivaient de nombreux juifs, comme le raconte Benjamin de Tudela, juif de Navarre, dans son voyage en Italie au XIIe siècle. Les traces de ce passé effacé avec l’enfermement des juifs dans le ghetto en 1555 sont rares, mais, dans le vicolo de l’Atleta, au no 14, se dresse un petit édifice de brique avec deux arches, qui était probablement une synagogue médiévale, comme en témoigne une inscription hébraïque sur la colonne de la loggia et un puits dans la cour.
L’ancien cimetière se trouvait dans la zone de Porta Portese, où se tient chaque dimanche le marché aux puces. Après 1870, une grande partie de la vie juive romaine s’est à nouveau déplacée vers ce quartier du Trastevere, où se concentre aujourd’hui la plus grande partie des institutions communautaires dont Il Pittigliani , l’ancien orphelinat juif transformé en centre culturel avec une cantine casher et une bibliothèque possédant de nombreux documents sur la vie juive dans la capitale.

De l’autre côté du viale Trastevere, la grande avenue qui divise le quartier, se trouvent le siège de l’Union des communautés israélites italiennes , un centre bibliographique sur le patrimoine juif, et, un peu plus loin, respectivement aux nos 14 et 12, la crèche et l’école primaire israélites. Le musée du Folklore et des Poètes romains mérite une brève visite pour trois tableaux d’Ettore Roesler Franz (1845-1907) montrant des scènes de la vie du ghetto.
Le Forum
Centre du pouvoir sous la République puis sous l’Empire, les fori imperiali, entre la place de Venise et le Colisée, méritent aussi une visite pour deux monuments directement liés à l’histoire juive.

L’Arco di Tito – l’arc de triomphe de Titus – construit après la mort de l’empereur en 81, célèbre sa victoire et celle de son père Vespasien sur la révolte juive de 70. À l’intérieur de l’arche, deux grands bas-reliefs illustrent le cortège triomphal chargé du butin pris dans le Temple de Salomon, dont notamment un chandelier à sept branches et des trompes d’argent. Ce lieu, symbole de la défaite et de la dispersion, était naturellement honni des juifs romains. Mais lors de la proclamation de l’État d’Israël en 1948, « ils défilèrent sous l’arc dans le sens contraire à celui de la marche triomphale de Titus », racontent Bice Migliau et Michaela Procaccia, dans leur ouvrage sur les itinéraires juifs à Rome et au Latium.

À l’autre bout du forum, en allant vers le Capitole, se dresse l’ancienne prison Mamertina avec ses lugubres cellules souterraines, où étaient emprisonnés puis exécutés les ennemis de Rome, après l’humiliant défilé derrière le char du vainqueur. Une plaque rappelle que tel fut notamment le sort de Simon bar Ghiora, le défenseur de Jérusalem en 70.

En sortant du forum par l’entrée principale et en remontant la via Cavour, se trouve sur la droite, en haut d’un grand escalier, la basilique San Pietro in Vincoli , construite à l’origine pour conserver les chaînes de saint Pierre (Ve siècle), puis refaite au début du XVIe siècle par le cardinal Della Rovere, le futur pape Jules II. Là, dans le monument funéraire de ce pape, se dresse la célèbre statue de Moïse par Michel-Ange. Il est assis, puissant et courroucé, représenté au moment où, descendu du Sinaï, il voit son peuple s’adonner à l’idolâtrie. Il porte les Tables de la Loi.
Les catacombes juives
Les catacombes ont été construites aux premières années de l’ère chrétienne par les juifs qui s’inspiraient, pour ces lieux de sépulture, des usages romains d’enterrer les morts dans de profondes galeries. Six sites ont été découverts autour de Rome.
Le premier fut celui de Monteverde, près du Janicule, mis au jour dès le XVIIe siècle. Seules deux catacombes juives, celle de Villa Torlonia sur la via Nomentana et celle de Vigna Randanini, près de la via Appia Antica, sont aujourd’hui ouvertes. Leur structure de galeries larges d’à peine 1 mètre et hautes de 2 ou 3 mètres ne diffère guère de celle des catacombes chrétiennes.

« Considérées comme des lieux religieusement impurs, les catacombes n’étaient pas utilisées par les juifs pour des célébrations liturgiques autres que les inhumations », souligne Attilio Milano dans son Histoire des juifs italiens. Les murs sont ornés d’inscriptions, le plus souvent en grec, et de symboles: la menorah, mais aussi des rouleaux de la Loi, des chofarim ou des rameaux de palmier.
Deux salles des galeries de Vigna Randanini sont ornées de motifs profanes (aigles, paons, griffons), et sur les plafonds, figurent une représentation de la Victoire et une autre de la Fortune. Certains les interprètent comme la conséquence des influences de la société environnante, d’autres soulignent qu’il s’agit vraisemblablement de tombes païennes antérieures intégrées, par la suite, à la catacombe juive.
Le mémorial des fosses adréatines
Près de la via Appia Antica, sur la via Adreatina, peu après le croisement avec la via delle Sette Chiese, s’élève le mémorial des Fosses adréatines. À cet endroit, furent massacrés le 24 mars 1944, par les SS d’Herbert Kappler, 335 otages dont 75 juifs – une exécution de masse en représailles de la mort de 32 soldats allemands victimes d’un attentat de la Résistance. Le monument funéraire, Les Martyrs, a été sculpté en 1950 par Francesco Coccia. Une croix et une étoile de David se dressent en haut de la paroi de la carrière.

Ostie
Les fouilles d’Ostie (Ostia Antica), le grand port de la Rome impériale, sont un témoignage passionnant sur l’urbanisme romain et méritent aussi une visite pour la synagogue découverte en 1962, lors du creusement d’une route pour l’aéroport de Fiumicino. Elle se dresse en lisière nord-est de la zone archéologique, juste au-delà de la Porta Marina. Le début de la construction remonte à la moitié du Ier siècle, et elle aurait été remaniée plusieurs fois jusqu’au IVe siècle. On peut encore voir l’aron entouré de deux colonnes dont les chapiteaux portent les restes d’une frise ornée de menorot, de rameaux de palmier et de chofarim. À l’autre extrémité de la salle, se trouve un petit podium qui était la bimah. Les restes du mikveh sont encore visibles. L’ensemble des bâtiments de la synagogue, avec ses trois entrées (pour les hommes, pour les femmes et pour le mikveh), comportait la salle de prière, une salle d’étude, un four pour le pain azyme.
Le musée de la Zone archéologique expose quelques belles lampes ornées du chandelier à sept branches.

Capitale de la région de l’Algarve, au sud du Portugal, la ville de Faro abritait une importante communauté juive, expulsée en 1497. Certains ont continué à y vivre en tant que conversos. Les juifs ne se réinstallèrent « officiellement » dans la ville qu’au XIXe siècle.
Au XVe siècle, époque de son apogée, Faro était un centre bien connu d’imprimerie hébraïque. Samuel Porteira y imprimera en 1481 le premier livre de l’histoire du Portugal : une édition du Pentateuque en hébreu. Pas que juive d’ailleurs, puisque la publication en 1487 d’une Torah en hébreu par Samuel Gacon fut probablement une des premières impressions portugaises.
La plupart des juifs qui s’installèrent à Faro à cette époque étaient originaires du Maroc et de Gibraltar. Principalement dans la Rua de Santo Antonio, contribuant au développement économique du quartier. Vers 1830, la communauté juive construisit deux synagogues et un cimetière.
Le cimetière juif de Faro compte 107 tombes. Il fut en service entre 1838 et 1932. Le cimetière figure dans la liste des lieux d’intérêt du registre portugais des monuments historiques. Sur le portail de l’entrée figure la date 5638 (1878), dont on pense qu’elle correspond à la date de construction du mur d’enceinte du cimetière. Le cimetière est tombé en décrépitude dans les années 1980. Isaac Bitton, natif de Lisbonne, fonde en 1984 le fonds de restauration du cimetière de Faro, qui a permis sa rénovation en 1992-3. À l’intérieur du cimetière juif , vous trouverez un petit musée consacré aux traditions juives, ainsi qu’une synagogue.
En plus du cimetière, on sait que se trouvait dans les années 1850 une synagogue. Au début du XXe siècle, la communauté comptait environ 50 familles. Dans les années 1970, il ne restait que 5 juifs dans toute la région. On retrouve des descendants maranes de la communauté de Faro à Bayonne, Londres, Dublin, et aussi loin que la Jamaïque.
Sources : Encyclopaedia Judaica

Si les juifs ont dû fuir la ville au 16e siècle, Lisbonne a aussi été la ville qui permit l’accueil des juifs fuyant l’Inquisition espagnole ou le transit des juifs fuyant le nazisme vers le continent américain. Mais elle depuis le tournant du 21e siècle une renaissance de sa vie juive.
En décembre 2024, une cérémonie s’est déroulée à Lisbonne, en mémoire du bateau Serpa Pinto, lequel transporta de nombreux réfugiés juifs pendant la guerre. Le bateau fit de nombreux allers-retours, financé par le JDC, afin de sauver les juifs et de leur permettre d’arriver aux Etats-Unis ou dans des pays d’Amérique centrale et du Sud, ouvrant parfois leurs portes. Une plaque fut dévoilée en présence de représentants politiques portugais, dont le maire de Lisbonne, Carlos Moedas, ainsi que le rabbin Eli Rosenfeld. Parmi ses passagers, le célèbre rabbin Menachem Schneerson et sa femme Chaya Mushka, fuyant la France en 1941 pour arriver à New York.
D’un côté il y a la mer et de l’autre la rivière. Allers fréquents, retours récents, racontant 1000 ans d’une histoire juive passionnante, principalement dans un quartier, Alfama et d’autres que nous vous emmenons visiter pour trois jours et demi magiques à Lisbonne…
Jour 1 Alfama
Sur la place principale de Lisbonne, Sao Domingos, se trouve une église et un théâtre. L’église où a commencé le massacre des juifs convertis en 1506. Deux mille victimes en trois jours. Un monument sur la place commémore aujourd’hui cette tragédie. Et à côté un Mur de la Tolérance, qui célèbre cette valeur dans toutes les langues. Le grand théâtre Dona Maria a été pendant trois siècles le siège de l’Inquisition. Mais depuis un demi-siècle, la culture et le partage prennent au Portugal le pas sur le repli religieux.

Partage de pas entre citoyens et touristes lorsque vous descendez la sublime rua Agusta pour arriver à son Arc de triomphe où depuis 2013 vous pouvez monter pour profiter d’une magnifique vue. Et un peu plus bas, la toute aussi belle praça de Comerio aux bâtiments jaune safran.

Ensuite, on part un peu à l’est du quartier d’Alfama, vers la rua da Judiaria. Avant la conversion forcée (1497), il y avait à Lisbonne 3 judiarias, des quartiers juifs et non des ghettos, situés au milieu de la vieille ville. En vous y rendant, passage obligé par deux lieux intéressants.

Tout d’abord une maison témoin de cette époque avec des pierres taillées en pointe de diamant. Elle accueille aujourd’hui la fondation de l’auteur José Saramago qui a consacré d’ailleurs un livre à l’Inquisition. Deuxième lieu à visiter, la Cathédrale Sé, le plus ancien monument religieux de Lisbonne. L’intérieur est particulièrement étonnant avec ses influences artistiques romane, gothique, arabe et baroque.
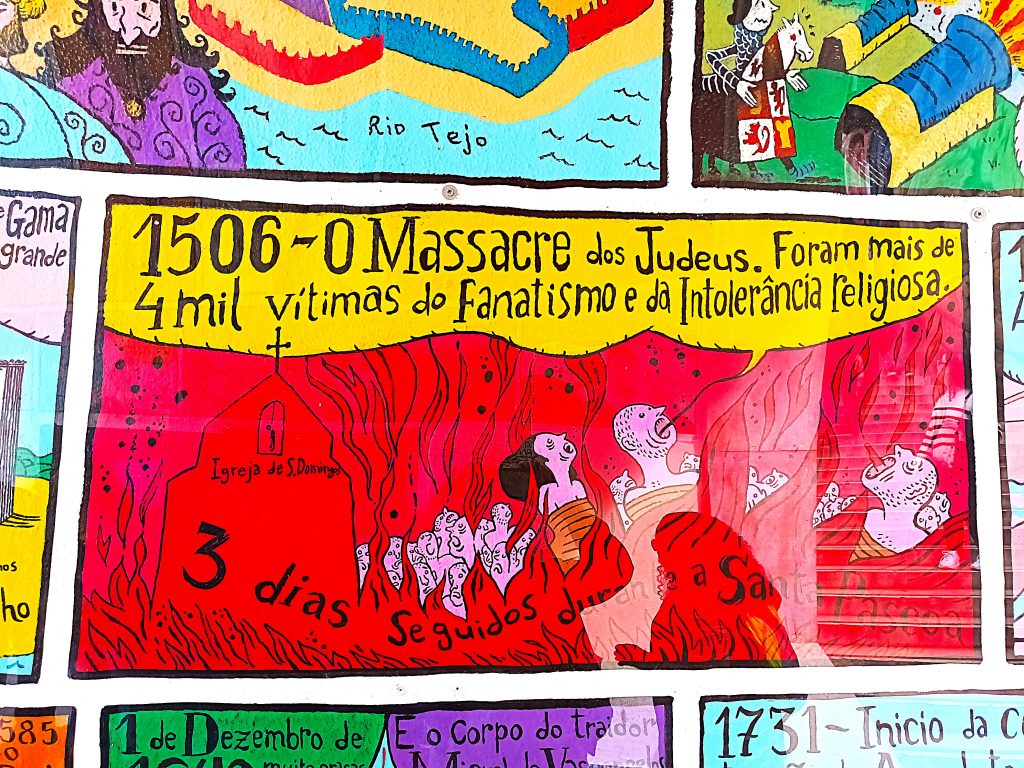
Lors de la conversion forcée, les synagogues ont été réattribuées ou démolies. De même pour les commerces fournissant des produits cashers ou de culte. Il y a donc peu de traces de ce que fut l’ancien quartier. Néanmoins, le Portugal poursuit aujourd’hui ses efforts pour mettre en valeur le patrimoine culturel juif. Ce qui n’empêcha pas parfois de légères erreurs historiques.

Ainsi, la grande synagogue, située au milieu du quartier a été donnée à un ordre religieux catholique. Le bâtiment étant démoli en 1755, l’ordre est parti dans une autre église. Ainsi, petite erreur d’indication touristique, une plaque sur le portail manuelien, symbole de la renaissance portugaise, indique l’ancien emplacement de la synagogue en ce deuxième lieu où se réinstalla l’ordre chrétien.
Le quartier Alfama est également le berceau du fado, avec son musée dont nous vous conseillons la visite. Pour son exposition permanente très complète, mais aussi les inspirations étonnantes de cette musique. En 2012, lors d’une tournée européenne, Leonard Cohen déclara à un journaliste portugais qu’il avait toujours aimé le fado et qu’un des premiers albums qu’il acheta fut de Amalia Rodrigues. La visite d’Alfama est d’autant plus urgente que peu de traces de ces références, juives et artistiques demeurent depuis l’urbanisation massive encouragée par les investisseurs étrangers, notamment français. Les petites ruelles et échoppes aux plats locaux de sardines à deux euros ont été remplacés par des avenues et grands restaurants répondant aux nouvelles demandes et aux vacations airbnb.

En remontant vers le nord-ouest, nous vous conseillons la visite d’un autre musée, celui dédié aux arts décoratifs. Cet ancien palais racheté par le collectionneur Ricardo do Espirito Santo Silva, présente aujourd’hui de nombreuses œuvres locales mais aussi internationales. Une variété dans l’espace et le temps, différentes époques étant à l’honneur. Et pour clôturer la journée, l’inévitable Château Saint Georges, situé à proximité du musée. Anciennement témoin d’une histoire violente, il motivera aujourd’hui votre passage par sa vue imparable et ses sublimes promenades.
Pour dîner, nous vous recommandons le Barrio de Avillez. Un lieu qui offre plusieurs ambiances, taverne, pizzeria, bar, où l’on savoure tout particulièrement, Portugal oblige, les fraicheurs de la mer.
Jour 2 Campolide et Alcantara
Lors de cette première partie de journée, nous vous invitons à visiter les deux synagogues actuelles de Lisbonne et les autres lieux intéressants sur le chemin de trois kilomètres qui les lie.
La synagogue Ohel Jacob a été fondée en 1934 par des juifs ashkénazes originaires d’Europe centrale. Une époque où la majorité des juifs portugais étaient séfarades. La synagogue dispose également d’un petit musée présentant son histoire.

Vous descendez ensuite l’av. dos Combatentes jusqu’à la Fundaçao Museu Calouste Gulbenkian. De nombreuses œuvres d’arts sont présentées dans ce lieu symbole de curiosité et d’engagement depuis qu’il fut créé sous l’ère Salazar. Une visite qui se prolonge avec ses jardins qui accueillent aussi des événements culturels majeurs.
A peine 200 mètres au sud, en prenant la rua Marques de Fronteira, la visite en plein air se poursuit au Parque Eduardo VII. Traversez ensuite au sud du Parque la place Marques de Pombal en prenant la rua Braamcamp pour arriver sur la rue Alexander Herculano. Ainsi nommée, en hommage à l’historien qui raconta la vie juive.

Sur cette rue se trouve Shaare Tikva . La synagogue est en fonction en 1904, suite à l’abolition de l’Inquisition, et le retour timide des juifs, de Gibraltar et d’Afrique du Nord. Une synagogue discrète en conformité avec la volonté étatique.
Après les jardins, les plages pour cette journée qui vous fera douter comme Belmondo face à Gabin dans Un Singe en hiver, sur l’accueil que réserve un monument à la nature environnante ou l’inverse. Mais avant de ramasser des coquillages et crustacés alcoolisés, rendez-vous à Alcantara, à 10 minutes de voiture ou 20 minutes de bus de la synagogue.

Ce quartier accueille quelques-uns des plus chouettes bistrots de la ville et de nombreuses boutiques, notamment aux alentours de la LX Factory. Prenez votre temps et votre plaisir à vous promener à Alcantara en laissant les cartes et boussoles de côté. La plupart des établissements n’existaient pas il y a quelques années. Comme quoi, si l’ancien quartier Alfama a été ravagé par le béton qui bouffe l’herbe et les vieilles pierres, la créativité immobilière et culturelle a transformé Alcantara pour notre plus grand bonheur.
Notre coup de cœur, la librairie Ler Devagar. Cette ancienne imprimerie transformée en immense librairie est un cadre magnifique et inspirant. Son nom, « ler devagar » signifiant « lire lentement ». Tout un programme. Vous pouvez également y manger.
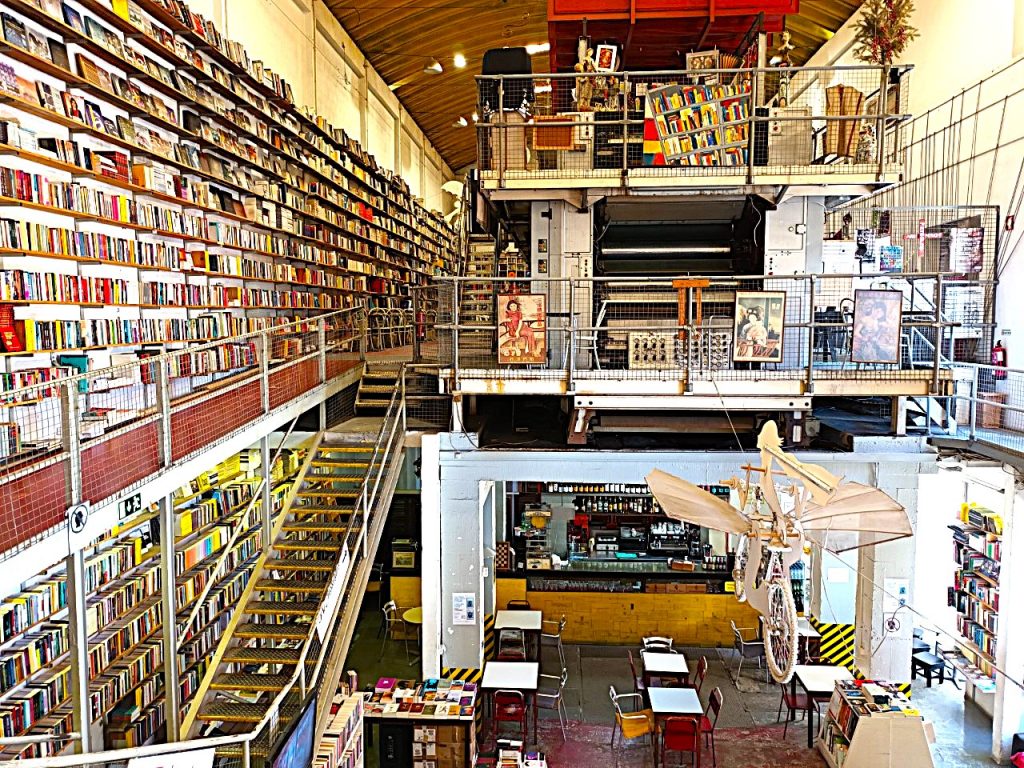
Et si les jambes vous l’autorisent et l’estomac vous le recommande, une ballade en fin de journée le long des plages sera idéale. Les restaurants et docks serviront d’étapes aux leveurs de coudes.
Parmi les lieux proches que l’on vous recommande pour diner, le long des docks vous trouverez le restaurant Le Chat avec ses plats variés des fonds de marins ou le Club des Journalistes dans une ambiance cosy avec ses risottos et ceviches.
Jour 3 Belem
Un Musée juif, Hatikva, est actuellement en construction, confié au grand architecte Liebeskind. Un terrain à Alfama était prévu, mais finalement il sera situé à Belem, le quartier des musées et du plus grand monastère de la ville, celui des Hiéronymites. Mais avant la visite de ce monument manuélien, passage obligatoire à la célèbre pâtisserie du quartier, « Pastéis de Belem ». De grandes salles accueillent les clients dans un somptueux décor, idéal pour savourer les spécialités, les azulejos.

Suite à la visite du monastère, vous trouverez en face le jardin Vasco da Gama. Abraham Zacuto a d’ailleurs créé des tables astronomiques avec des caractères en hébreu, facilitant le voyage de Vasco da Gama et des autres explorateurs. Un tableau rend hommage à cette contribution historique.

Au sud du jardin se trouve l’emblématique Monument des découvertes. Construit en 1940, il célèbre le 500e anniversaire d’Henri le Navigateur. C’est d’ailleurs en ce lieu précis que Vasco da Gama embarqua. Autre monument emblématique qui ponctuera votre séjour, la Tour de Belem, située à un petit kilomètre à l’est. Construite au 16e siècle, elle servait de Sentinelle et veillera cette fois à la fin heureuse de votre séjour…

Rencontre avec Esther Mucznik, présidente de l’Association Hagada, en charge du projet du Musée juif Tikva de Lisbonne
Jguideeurope : Dans la présentation du futur musée, vous mettez en valeur aussi bien la dimension portugaise que juive. Quelles ont été les principales contributions juives à la culture et l’histoire du pays ?
Esther Mucznik : Comme beaucoup d’autres Musées, le Musée Juif Tikva de Lisbonne raconte une histoire, l’histoire des juifs portugais, de sa présence documentée à partir de l’époque romaine jusqu’à aujourd’hui. Contrairement au stéréotype que les juifs sont un peuple à part, étranger en quelque sorte, notre objectif est de démontrer que c’est en tant que Portugais de religion juive qu’ils contribuent à la nation à laquelle ils appartiennent. Cette contribution a été extrêmement importante au long des siècles et continue de l’être. Mais il faut bien comprendre que cette contribution a lieu surtout pendant les moments de l’histoire où l’interaction nationale et une liberté, même relative, étaient possibles.
C’est le cas au Moyen Âge, entre le XIIème et le XVème siècle, lorsque les juifs étaient les médecins et les financiers des rois et de la noblesse. Quand ils ont pu jouer un rôle fondamental dans ce qu’on appelle aujourd’hui « l’expansion portugaise ». En tant que financiers, mais plus encore comme astronomes, diplomates et interprètes, grâce aux nombreuses langues qu’ils maîtrisaient. Dans le domaine de la culture, il faut rappeler que ce sont les juifs qui ont introduit au Portugal l’imprimerie. Le premier livre imprimé dans le pays fut le Pentateuque en hébreu, en 1487. Pendant le XVème siècle, il y avait au Portugal trois imprimeries (à Lisbonne, Faro et Leiria), ainsi qu’un atelier de copistes et enlumineurs qui a produit des manuscrits superbes. Cette contribution ne s’arrête pas au Moyen Âge. Elle continue dans la Diáspora à un niveau planétaire suite aux conversions forcées et à l’installation de l’Inquisition au XVIème siècle, et se maintient au Portugal après son abolition jusqu`à aujourd’hui.

David Harris, ancien CEO de l’American Jewish Committee, a réalisé une vidéo personnelle émouvante, diffusée sur votre site, concernant le rôle du Portugal dans le sauvetage des juifs pendant la guerre. Pouvez-vous nous parler un peu plus de ce rôle ?
À partir de 1933, les premières vagues de réfugiés du nazisme arrivent au Portugal, principalement des Allemands. Cette même année, l’organisation de jeunesse sioniste » Hehaver crée la COMASSIS, la Commission portugaise d’assistance aux réfugiés juifs, présidée d’abord par Adolfo Benarus, puis par le médecin Augusto Esaguy. La COMASSIS, qui a existé jusqu’en 1941, a joué un rôle décisif tout au long de ses huit années d’existence. Notamment avec le soutien de la Cantine Israélite et de l’Hôpital Israélite, et en parvenant à faire subventionner matériellement son action par HICEM et le JOINT. Ces organismes juifs américains d’aide aux réfugiés ont pris en charge les voyages et les frais de subsistance des réfugiés.
C’est également COMASSIS qui obtient des autorités portugaises les autorisations d’établissement au Portugal, après la chute de la France, du JOINT et d’HICEM, leur permettant d’exercer leur activité caritative au Portugal.

Avec l’entrée en guerre en 1941, les États-Unis perdent leur neutralité et les deux organisations américaines ont été contraintes de quitter le Portugal. Dès lors, fort de sa notoriété et crédibilité, le président de la Communauté Israélite, Moisés Amzalak, déjà vice-recteur de l’Université technique de Lisbonne, auteur de nombreuse bibliographie et, fait important à l’époque, jouissant de la confiance de Salazar, assume directement, avec l’accord des directeurs du JOINT et de l’HICEM, l’aide aux réfugiés à travers la structure de la Communauté. C’est ainsi que fut créée la Section d’Assistance aux Réfugiés de la Communauté Israélite de Lisbonne, dirigée par le médecin Elias Baruel, vice-président de la Communauté, qui fonctionnera jusqu’au milieu des années 1950.
D’un point de vue religieux également, la Communauté fournissait aux juifs pieux les livres et les ustensiles nécessaires à la prière dans les zones de résidence fixe où ils étaient cantonnés par l’État. Bien que petite, la communauté juive de Lisbonne a joué un rôle important dans le soutien et l’accueil des réfugiés. Composée de médecins, d’avocats, d’enseignants et d’hommes d’affaires, bien intégrée dans la société portugaise et dirigée par un homme qui jouissait de la confiance des autorités, la communauté a mis ces caractéristiques au service des persécutés du nazisme, contribuant ainsi au sauvetage de milliers de personnes.

Tikva signifiant « espoir », donc espoir d’avenir, quels types de projets pédagogiques sont prévus pour la jeunesse ?
Il faut d’abord que les jeunes sachent ce qu’est le judaïsme, car les communautés au Portugal sont petites et n’ont pas la visibilité nécessaire pour se faire connaître. L’ignorance est le terrain plus fertile des stéréotypes. Il y a aussi la musique qui est importante, ainsi que les fêtes juives avec leurs traditions culinaires. Sans oublier bien entendu les grandes dates de l’Histoire. Nous utiliserons évidemment les nouvelles technologies pour rendre chaque projet plus clair et attractif. Mais tout dépend, entre autres, de l’âge des jeunes et de la qualité professionnelle du responsable du service éducatif. Il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus.
Les juifs vécurent à l’abri des murailles de cette petite ville, perchée sur une colline, où ils exerçaient les métiers traditionnels du commerce et de l’artisanat et, quelquefois, la médecine. La population augmente après 1492, grâce à l’arrivée des juifs espagnols.

Vous reconnaîtrez assez facilement l’ancienne judaria autour de la place du Marché , ses rues typiques qui conduisent à la petite synagogue des XIVe et XVIe siècles, dont il ne reste que le souvenir.
Une niche, qui a servi d’autel d’église au XVIIe siècle, est peut-être un vestige de l’aron ha-kodesh. Des fouilles et des recherches sont menées par la municipalité sur cette synagogue, très émouvante dans sa simplicité.
Tandis que l’Inquisition espagnole provoque le départ de nombreux juifs, la ville de Castelo de Vide se développe économiquement, notamment grâce à l’arrivée de juifs natifs du pays voisin. Les juifs y travaillèrent dans les arts et l’artisanat, la botanique et la médecine.
Suite à l’ordre d’expulsion promulgué en 1496, de nombreuses familles juives demeurèrent à Castelo de Vide, en acceptant de se convertir au christianisme. Ils purent ainsi poursuivre un semblant de normalité de vie active. Parmi les personnages célèbres de la ville, on peut citer Garcia da Orta, l’auteur d’un livre de médecine important au 16e siècle.
Sources : Encyclopaedia Judaica, Rede de Judiarias
Il semble, selon les chercheurs, qu’une communauté juive existait à Tomar dès le XIVe siècle. En effet, des archéologues ont retrouvés une inscription sur une tombe mentionnant le rabbin Jossef de Tomar, mort à Faro en 1315. De plus, un document officiel datant de 1476 fait état d’une communauté juive dans la ville. Il semble que la communauté juive atteint son apogée au XVe siècle, entre 1430 et 1460. La synagogue se trouvait au milieu du quartier juif, dans ce qui fut plus tard appelé « Rua Nova que fui Judaria » (la rue nouvelle qui fut la judaria). Aujourd’hui, cela correspond aux rues Direita dos Açougues et dos Muinhos.

On pense aujourd’hui que la synagogue de Tomar est la plus ancienne (et la mieux préservée) des synagogues portugaises. Construite en 1438, elle fut un lieu de culte jusqu’en 1496. Le bâtiment servi ensuite de prison, puis d’église.
En 1920, un groupe d’archéologues portugais visite le bâtiment et y reconnaît une synagogue. Elle est classée monument national en 1921. En 1923, l’ingénieur Samuel Schwarz, qui travaille dans les mines de la région, apprend l’existence de ce bâtiment et l’achète à son compte personnel. Il entame une première série de travaux. En 1939, il décide d’en faire don à l’État portugais à la condition que l’on y installe un musée luso-hébraïque.

Elle repose sur quatre colonnes centrales, d’une grande finesse, qui rappellent celles de l’église portugaise d’Ourem réalisée par des ouvriers hispano-mauresques. Les mêmes artisans pourraient d’ailleurs en être les auteurs. Récemment, des fouilles ont mis au jour certaines parties du mikveh. On a également retrouvé quelques pièces de monnaie de l’époque du roi Alphonse V (1446-1481), ainsi que de la vaisselle d’usage.
Sans surprise, la façade et la porte d’entrée sont très modestes. Vous aurez même à descendre quelques marches, destinées à abaisser la hauteur de la façade sur la rue. Autre curiosité de la synagogue : vous apercevrez, pris dans les murs aux quatre coins, le col d’amphores insérées là au cours de la construction de l’édifice. On prétend que, en démultipliant le son, elles amélioraient l’acoustique de la synagogue.
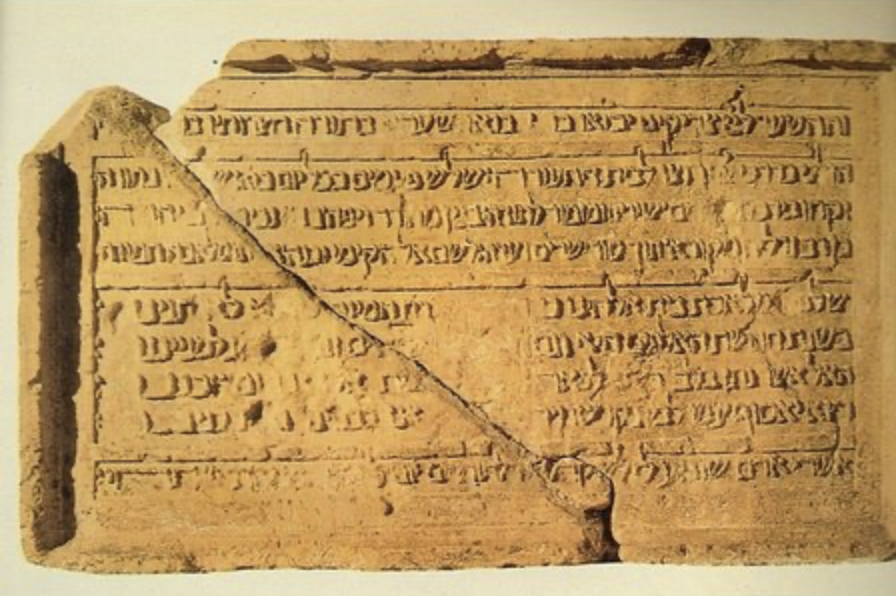
Dans l’enceinte de la synagogue, se trouve le musée Abraham Zacuto, nommé en l’honneur du mathématicien et auteur de l’almanach perpétuel (1450-1522). L’exposition permanente inclut des trouvailles archéologiques qui attestent de la présence juive au Portugal au Moyen-Âge. On y trouve en effet une inscription de 1307 venant de l’ancienne synagogue de Lisbonne. Une autre, datant du XIIIe siècle, et trouvée à Belmonte est tout aussi intéressante : en effet, le nom divin est représenté par trois points, à la manière des manuscrits de la mer Morte.
En 1917, lors d’une mission au nord du Portugal, Samuel Schwarz découvre des marranes à Belmonte. Grâce à une approche multidisciplinaire, son livre Les Nouveaux-Chrétiens au Portugal au XXe siècle, publié en 1925, devint un classique absolu sur l’étude du phénomène marrane et surtout permettra la renaissance de la vie juive dans la région.
Le livre a été publié en français avec un grand succès sous le titre La Découverte des marranes aux éditions Chandeigne. Rencontre avec son petit-fils Joao Schwarz.
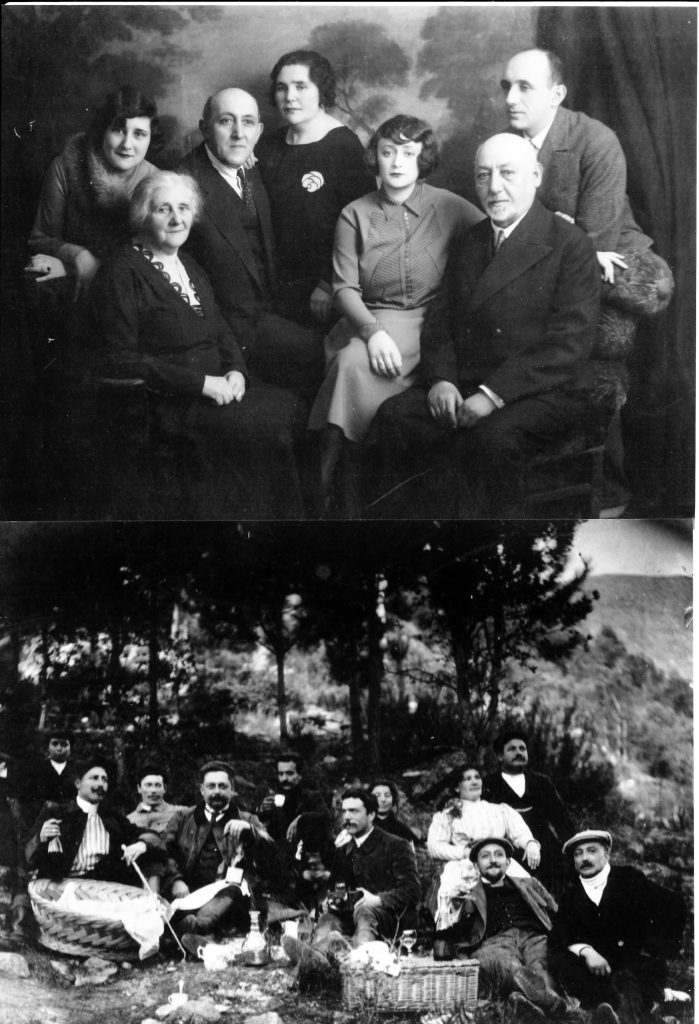
Jguideeurope : D’où est venue l’idée chez Samuel Schwarz de transmettre son expérience en livre ?
Joao Schwarz : Pendant son séjour en Espagne en 1908 et 1909, il avait déjà écrit ses premiers articles sur les marranes (en français d’ailleurs). Avec le père qu’il avait et la tradition culturelle qui régnait chez lui en Pologne, cela a été naturel pour lui de publier le résultat de ses recherches. A cela, il faut ajouter que la période 1919-1926 de la République au Portugal se prêtait à une certaine forme de liberté. La situation changea avec l’Estado Novo qui, entre autres, ouvrit les vannes de l’antisémitisme et remit en selle un cléricalisme beaucoup plus affirmé.

Pourquoi cela a-t-il pris huit ans pour le publier ? Et comment a-t-il été accueilli ?
Depuis le début de ses recherches et jusqu’à la publication du livre, il s’écoule en effet une période de huit ans, mais le processus de recensement des populations et prières marranes dura pratiquement jusqu’en 1924. En même temps, il travailla sur le livre traitant des inscriptions hébraïques au Portugal, publié en 1923. Cela dit, la publication du texte en portugais fut accompagnée par la publication d’articles dans la presse juive. En consultant les débats de l’époque, on peut estimer que les articles et le livre ont eu un retentissement considérable dans le milieu juif de par le monde. C’est pour cela que Lucien Wolf et Paul Goodman, parmi d’autres, furent dépêchés au Portugal afin d’enquêter sur ce phénomène. Dans le pays, ce fut le début de la renaissance du fait juif, avec énormément de populations de la région de Tras-os-Montes s’y reconnaissant. Des réunions se multiplièrent auxquelles Samuel fut convié. C’est de là aussi que part l’Oeuvre du Rachat sous la houlette du capitaine Barros Basto.
Quel est l’impact de l’engagement de Samuel Schwarz sur les recherches concernant les Marranes et la (re)découverte nationale du patrimoine culturel juif ?
Je crois pouvoir dire que l’impact sur les recherches fut déterminant. Cela dit, il a fallu attendre le milieu des années 80 pour voir de nombreux travaux mettre en exergue la renaissance du fait juif dans la région. Des historiens tels que Anita Novinski, David Canelo, Maria Antonieta Garcia etc… En matière de redécouverte du patrimoine culturel juif, c’est une autre question. En effet, depuis seulement une quinzaine d’années, un effort est entrepris visant le patrimoine, sa préservation et sa valorisation. Notamment depuis la création du Rede de Judiarias de Portugal. Il faut aussi mentionner que l’octroi de la nationalité portugaise aux descendants de juifs séfarades du pays a beaucoup fait, surtout dans les dernières années, pour attirer au Portugal des visiteurs intéressés par leurs racines. On parle déjà de quelques 30 000 nouveaux Portugais qui viennent s’installer, particulièrement dans les régions du Nord du pays.
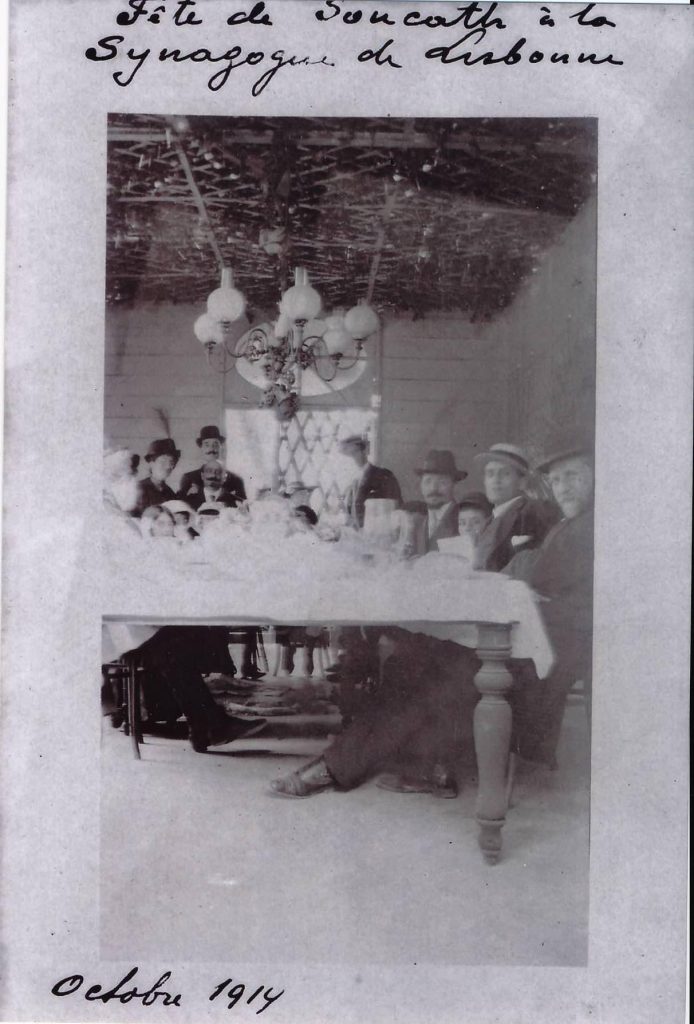
Samuel Schwarz donna un terrain à Tomar pour qu’elle y construise un musée juif. Ce qui sera officialisé en 1939. Événement rare sur le continent en cette année. Que contenait ce musée ?
En réalité, Samuel acheta un édifice en 1923. Il s’agissait alors d’une espèce de dépôt d’épicerie. Cet édifice était déjà reconnu comme monument national, sans que rien ne fut accompli pour le préserver. Samuel y réalisa des travaux de nettoyage afin de révéler au pays ce qui représente aujourd’hui la plus vieille synagogue portugaise encore debout. La publication la plus ancienne (1925) concernant ce temple est de Garcês Teixeira, un archéologue qui livra les premiers éléments sur ce qui fut la communauté juive de Tomar vers la fin du XV siècle. Il faut noter au passage que le bâtiment annexe de la synagogue, qui loge le mikvé, ne fut découvert que dans la années 1980. Après des travaux assez considérables de réfection, qui ont pris beaucoup de temps vu les moyens dont disposait Samuel Schwarz, ce dernier a décidé d’en faire donation à l’Etat portugais. Cela, à condition que l’on y crée le « Museu Luso-Hebraico Abraão Zacuto ». L’espace de la synagogue contenait à l’époque quelques stèles et pierres tombales évoquant le passé juif du Portugal. En contrepartie de ce don, le gouvernement portugais accédait à la demande de Samuel et lui octroyait la nationalité portugaise.

L’introduction du livre par Livia Parnes décrit l’oubli de la vocation du musée pendant de nombreuses années. Qu’en est-il aujourd’hui de la mise en valeur de ce patrimoine par Tomar ?
En effet, pendant de très longues années le bâtiment fut oublié, pour des raisons de maîtrise administrative et les portes de la synagogue ne furent ouvertes que grâce à la bonne volonté du couple Luis et Teresa Vasco. Lequel, été comme hiver, assurait l’ouverture permanente de ces portes. C’est ainsi que le nombre de visiteurs a pu se maintenir et atteindre presque 100 000 par an en 2015. Les autorités municipales, faute de moyens, ont ignoré l’existence de la synagogue pendant presque 80 ans. Avec la création du Rede de Judiarias, la donne changea et la municipalité a pu refaire « à neuf » la synagogue et l’espace attenant où se trouve le mikvé. Cependant, je crois que pour préserver et faire vivre ce patrimoine, un effort soutenu est nécessaire et non pas par à-coups, comme ce fut le cas jusqu’à aujourd’hui. Cela suppose que le musée soit doté d’une personne ressource.
Samuel Schwarz, La Découverte des marranes. Editions Chandeigne, Paris 2015.
Cette petite communauté, de 100 à 300 personnes, fut découverte en 1920 par l’ingénieur Schwarz. Les Marranes de Belmonte, court-métrage de Frédéric Brenner, en révéla l’existence au monde entier dans les années 1980.

Les juifs de Belmonte sont parmi les derniers à pouvoir nous rappeler quelle fut l’existence précaire des juifs traqués par une Inquisition et une Église toutes-puissantes. Ils vécurent sans rabbins, sans synagogue et sans livres. La transmission, exclusivement orale, se faisait par les femmes, qui décidaient du moment où elles jugeaient leurs enfants capables d’apprendre leur appartenance à la communauté. Sur le plan social, ils participaient à la vie catholique du village : baptêmes, mariages et enterrements.
En fait, le reste de la population, et en particulier le curé du village, était probablement au courant de leurs pratiques secrètes. Les rites, réduits à leur plus simple expression, consistaient à inclure des mots hébreux ou quelques personnages emblématiques (Adonaï, la reine Esther…), dans des prières en portugais, à allumer de façon discrète une lumière le vendredi soir, à jeûner très souvent et à cuire les pains azymes de la Pâque.

Les prières étaient récitées soit à la maison, toutes fenêtres fermées, soit dans les bois ou au bord d’une rivière. Après un difficile retour au judaïsme favorisé par les autorités israéliennes, la communauté de Belmonte, raffermie par la construction d’une synagogue offerte par un mécène, M. Azoulay, semble avoir repris une vie communautaire normale.
Ces dernières années, la culture juive revit à Belmonte. La synagogue accueille des offices les soirs d’été, et les shabbats et fêtes tout au long de l’année. En 2005, un mikveh et un musée juif ont également ouvert. Le musée a été rénové en 2016, et a réouvert en 2017 avec une nouvelle exposition permanente consacrée à la vie juive locale.
Juif, synonyme de Portugais
La diaspora judéo-portugaise a une histoire brillante. Deux symboles l’illustrent. La communauté d’Amsterdam construit une grandiose synagogue en 1666, et les œuvres de ses membres immortalisent son éclat: Menasseh ben Israel, élevé dans la foi chrétienne sous le nom de Manuel Dias, rédige, en 1650, Esperanca de Israel ; Isaac Aboab de Fonseca se rend au Brésil pour établir une communauté à Recife entre 1645 et 1654 ; enfin, le philosophe Baruch Spinoza échafaude un système philosophique des plus avancés. L’histoire remarquable de la « Senhora », Dona Gracia Nassi, veuve d’un banquier, est tout aussi emblématique: elle s’installe à Anvers, puis en Italie et, enfin, à Constantinople où elle développe ses affaires et devint la protectrice de nombreuses institutions charitables, fondant même une communauté de juifs portugais et espagnols à Tibériade, en Palestine, retrouvant ainsi l’espérance du retour à Sion. À cette époque, les juifs portugais sont présents dans toute l’Europe. Juif est alors souvent synonyme de portugais…

Porto est la capitale du nord du Portugal. Une ville qui représente la seconde agglomération du pays après Lisbonne. Elle est surtout connue pour ses monuments historiques et son vin. La présence juive date du Moyen âge. Le plus ancien quartier juif se situait à l’intérieur des murs de la vieille ville, où se trouve l’actuelle Rua de Santa Ana, à proximité de la cathédrale romanesque.
En 1386, Dom Joao I accorda aux juifs des terres afin qu’ils puissent y construire un nouveau quartier, à proximité de l’église Nossa Senhora da Vitoria, qui abrita peut-être une ancienne synagogue. La synagogue était située sur le site actuel du couvent de S. Bento da Vitoria. Une plaque indique aujourd’hui cet ancien lieu.

A l’époque de l’Inquisition, les marranes furent contraints de s’installer à R. de S. Miguel, une synagogue secrète se trouvant entre les numéros 9 et 11 de la rue, comme l’attesta une récente découverte.
Un quartier juif, Monchique, fut également présent dans le Bairro de Miragaia. En 1826 fut découvert une inscription hébraïque historique, la « pierre de Monchique », qui est présentée au Museu Arqueologico do Carmo à Lisbonne.
Parmi les personnalités juives de la ville, on peut citer le philosophe Uriel da Costa (1590-1647), le médecin Samuel da Silva (1571-1631), le rabbin et médecin Abraham Pharar (?-1663) et le poète Bento Teixeira (1561-1618).
Le nom de la synagogue de Porto , Kadoorie, est emblématique du « rayonnement international» que connut la communauté portugaise. Kadoorie est, en effet, le nom d’une famille d’origine judéo-portugaise, nationalisée anglaise et installée à Shanghai. Ses membres ont généreusement subventionné la construction de ce beau monument avec l’aide des communautés portugaises de Lisbonne, Londres et Amsterdam, en 1936. La synagogue peut accueillir 300 personnes et dispose de toutes les installations nécessaires au culte. Elle est en grande partie l’œuvre du capitaine Barros Basto, qui a essayé de faire revenir les crypto-juifs de la région à la foi de leurs ancêtres.
En 2007, un mikveh a ouvert dans l’enceinte de la synagogue. Et, depuis 2015, un musée juif s’y est également ouvert, témoignant du dynamisme de la communauté locale. Le musée loge dans trois des salles du premier étage de la synagogue. Dans l’une d’entre elles, a été reproduite une synagogue séfarade classique. L’exposition met en valeur des documents et objets illuminant des pans de l’histoire juive moderne de la communauté juive de Porto. On y trouve notamment une réplique d’une inscription qui se trouvait sur la façade d’une synagogue ouverte en 1380 à Porto, ainsi que la liste des 842 personnes torturées par l’Inquisition aux XVe et XVIe siècles.
En 2021, un musée de l’Holocauste a été créé à Porto. Deux ans plus tard a été inauguré un mémorial dédié aux 842 victimes de l’Inquisition de Porto. Un long travail de numérisation par la communauté des documents des Archives nationales de Lisbonne, aboutissant à l’identification des noms de ces victimes, aujourd’hui posés sur une paque commémorative de 4 mètres de large et 2 mètres de haut. Elle est posée sur un des murs extérieurs du musée juif de Porto .
On constate en 2025 que le nombre de juifs habitant à Porto a triplé en une décennie, atteignant un millier de personnes, en grande partie grâce à la loi sur la citoyenneté pour les juifs expulsés suite à l’Inquisition et l’arrivée de nombreux étudiants, notamment français. Des dizaines de dirigeants de communautés juives européennes se sont réunis cette année-là à Porto pour constater et saluer cette rare progression continentale.
Ainsi, on trouve actuellement à Porto une boucherie et plusieurs restaurants cashers et une autre synagogue. Malgré cette évolution très positive, la communauté est victime d’attaques antisémites prétextées sous le couvert de soutien palestinien, avec notamment des immeubles dégradés, dont la synagogue Kadoorie vandalisée en octobre 2023.
Sources : Encyclopaedia Judaica, Rede de Judiarias, Times of Israel
Un Dreyfus portugais
Élevé dans une famille chrétienne de Porto, Barros Basto retrouve le judaïsme après une visite à la synagogue de Lisbonne. Il se marie avec une jeune fille juive, après s’être lui-même converti à Tanger. Il va alors parcourir inlassablement tous les petits villages autour de Porto où existaient des groupes de crypto-juifs, à qui il insuffle, par son ardeur et sa prestance, le courage d’affirmer au grand jour leur judaïsme, après des siècles de vie clandestine. Il s’attache en particulier à l’éducation juive des enfants, seul moyen, selon lui, de redonner vie aux anciennes communautés. À cette fin, il crée d’ailleurs un collège d’enseignement à Porto. En butte à des accusations mensongères et à l’opposition des milieux salazaristes, il est destitué et condamné en 1938. Il meurt dans la misère, en 1961. Il sera réhabilité par l’État portugais en 1997, qui reconnaît son innocence et son inlassable dévouement.

C’est l’industrie horlogère qui a attiré des juifs alsaciens dans le Jura dès 1835. Parmi les grands noms de cette industrie, Achille Picard. À partir de 1858, les juifs pieux se retrouvent dans un local de prière.
Ils inaugurent leur synagogue mauresque en 1884. Sa dernière rénovation intérieure, en 1995, souligne les contrastes entre les murs sobres et les douze vitraux multicolores aux sujets bibliques, œuvre de l’artiste israélien Robert Nechin.
La rénovation extérieure, en 1999, a rétabli quatre petites coupoles en forme de cloches, retirées en 1956. Les façades sont beige clair, discrètement décorées de motifs rouges sur les frises et autour des fenêtres. La synagogue fut victime d’attaques antisémites en 2021.
Une section du cimetière de Tanzmatten puis de Bienne-Madretsch est donnée par le conseil municipal à la communauté juive.
Si la population juive atteint 500 personnes au début du 20e siècle (dont une bonne partie est originaire des pays de l’Est), ils ne sont que 150 au début des années 1990.

La présence juive bernoise date probablement du 6e siècle. Des juifs sont mentionnés dans les textes de loi. Durant le Moyen Age, comme dans de nombreuses autres villes de la région, la situation des juifs varia entre accueil, persécutions (qui débutèrent à Berne en 1294) et expulsions, selon le pouvoir en place. Dans la vague des grandes expulsions qui se déroulèrent entre la fin du 14e et la fin du 15e, les juifs bernois furent expulsés en 1427.
Au XIVe siècle, le ghetto juif s’étendait sur l’emplacement actuel de l’administration fédérale: l’Inselgasse, siège du département de l’Intérieur, s’appelait la Judengasse; Le Palais fédéral a pris la place du cimetière juif. Le centre communautaire actuel et sa synagogue mauresque ne sont pas loin, sur la Kapellenstrasse.

Une curiosité de la Kornhausplatz : la fontaine de l’Ogre qui date de 1544. Pour les uns, la statue de l’ogre en train de dévorer des enfants est une simple image de carnaval. Pour les autres, elle est une représentation moyenâgeuse du juif accusé de tuer des enfants chrétiens. L’ogre porte un chapeau jaune pointu, identique à celui qui était imposé aux juifs pour les discriminer.
En 2017, le Musée des Beaux-Arts de Berne a présenté l’exposition « Art dégénéré, confisqué et vendu ». Parmi ces 200 œuvres, des peintures de Franz Marc, Otto Dix et Otto Mueller. Elles font partie d’un leg du collectionneur Cornelius Gurlitt qui céda également au musée des tableaux de Cézanne, Delacroix et Munch qu’il avait caché dans son appartement de Munich pendant des décennies. Son père fut chargé par les Nazis de vendre les œuvres d’art volées aux juifs par le régime, art étiqueté de « dégénéré ». La récupération des œuvres par les familles fut au cœur d’une longue procédure juridique. Les œuvres montrées pendant l’exposition ne concernent pas les tableaux volés.
Rencontre avec Jacob Guzman, historien et membre actif de la communauté juive de Berne
Jguideeurope : Qu’est-ce qui a motivé votre engagement pour la mise en valeur du patrimoine culturel juif de Berne ?
Jacob Guzman : Ce patrimoine risque de disparaître si on ne prend pas la peine de le faire connaître à la population. Il faut d’autres médias que les livres d’histoire.
Comment s’est déroulée la grande exposition consacrée à Albert Einstein ?
Le directeur du musée d’histoire a contacté la communauté de Berne pour avoir quelques indications sur la vie juive à Berne à l’époque d’Albert Einstein. Nous avons remis, en prêt à long terme, quelques objets rituels, une Thora, et une serviette ayant appartenu à Einstein.
Pouvez-vous nous raconter une rencontre avec un visiteur ou un conférencier lors d’un événement culturel qui vous a particulièrement marqué ?
Un exemple parmi beaucoup d’autres : la rencontre avec l’architecte Ron Epstein qui a écrit un livre sur l’architecture des synagogues en Suisse. Nous avons eu le privilège, à Berne, d’avoir, pendant plusieurs années, des séries de conférences à thèmes juifs. Ces conférences payantes étaient, bien qu’organisées par un membre de notre communauté, ouvertes à tout le monde. Cela nous a donné l’occasion d’avoir du contact avec de nombreux conférenciers et a permis au public non-juif de connaître certains aspects de la culture juive.

La présence juive zurichoise date probablement du 13e siècle. Durant le Moyen Âge, comme dans de nombreuses autres villes de la région, la situation des juifs varia entre accueil, persécutions et expulsions, selon le pouvoir en place. Dans la vague des grandes expulsions qui se déroulèrent entre la fin du 14e et la fin du 15e, les juifs zurichois furent expulsés en 1436.

Zurich est le siège de la Fédération suisse des communautés israélites , fondée en 1904, dont les archives ont été récemment confiées à l’École polytechnique fédérale de Zurich (ETHZ) pour y être mieux conservées.
Le fonds inclut la documentation de la JUNA, l’agence de presse de la FSCI, de l’Union des comités juifs d’entraide, de la Centrale d’aide aux réfugiés, de l’Union des étudiants juifs de Suisse, de l’Action pour les juifs soviétiques, ainsi que des archives privées importantes.
L’ancien ghetto, aux Brunnengassen, fut le théâtre d’un pogrom en 1349 contre les juifs, accusés d’avoir propagé la peste. Une plaque commémorative a été inaugurée 650 ans plus tard au 4, Froschausgasse, où se trouvait l’ancienne synagogue. L’étroite ruelle sans nom qui menait au Neumarkt a été rebaptisée Synagogengasse.
Aujourd’hui, l’Israelitische Cultusgemeinde Zurich , fondée en 1862, est la plus importante communauté juive de Suisse. En 2025, elle compte près de 2 500 membres. La synagogue de l’ICZ, à l’angle de la Löwenstrasse et de la Nuschelerstrasse, construite en 1884, est de style mauresque : façade à rayures beiges et rouges, deux tours surmontées de coupoles, fenêtres typiques.

Son centre communautaire abrita un restaurant casher qui fut fermé en 2019. On y trouve également une école, une bibliothèque et un mikve.
D’autre part, trois communautés habitent la ville, chacune autour de sa synagogue : l’Israelitische Religionsgesellschaft , orthodoxe ; la communauté libérale Or Chadasch ; enfin, aux alentours de la synagogue Agudas Achim où vit une communauté hassidique importante, se dégage une atmosphère de shtetl.
En 2024, des agressions antisémites violentes se sont déroulées à Zurich, notamment des agression physiques et une tentative d’incendier une synagogue.
En 2025, on estima la population juive à près de 7 000 personnes. Il y a deux magasins cachères dans la ville dont The Shuk, situé sur la Waffenplatzstrasse.

La présence juive à Bâle date probablement de 1213. Durant le Moyen Age, comme dans de nombreuses autres villes de la région, la situation des juifs varia entre accueil, persécutions et expulsions, selon le pouvoir en place. Dans la vague des grandes expulsions qui se déroulèrent entre la fin du 14e et la fin du 15e, les juifs bâlois furent expulsés en 1397.
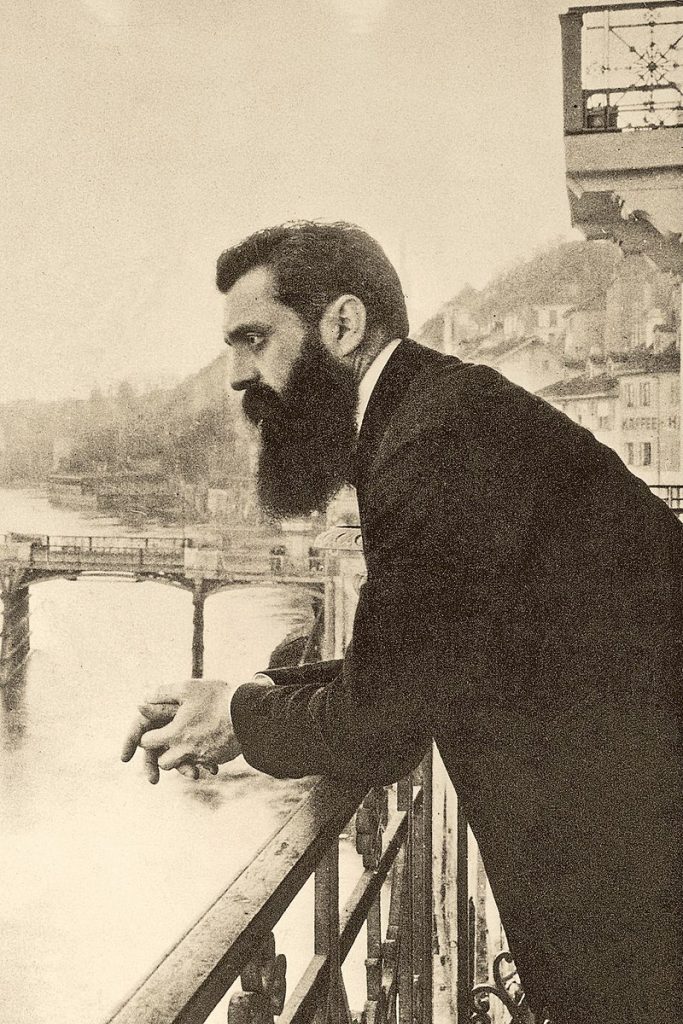
« À Bâle, j’ai créé l’État juif », écrivit Theodor Herzl dans son journal, après la tenue du premier congrès sioniste, du 29 au 31 août 1897. Neuf autres congrès se tiendront à Bâle. Une rue à son nom et une plaque dans le casino rappellent aujourd’hui les origines bâloises de l’aventure sioniste. La synagogue , inaugurée en 1868, est l’œuvre de l’architecte Hermann Gauss, qui prit comme modèle celle de Stuttgart, de style néo-byzantin, mauresque et roman. Vingt ans plus tard, elle fut agrandie et une seconde coupole fut ajoutée. Lors de la rénovation en 1947, on décida de recouvrir d’un gris uniforme les murs vivement colorés de la synagogue. Ce gris correspondait mieux à l’époque austère et au goût local.
Quarante ans plus tard, les couleurs de jadis ont ressuscité dans l’édifice refait. Le style oriental a été néanmoins atténué, en modernisant les motifs. À l’intérieur, le jaune beige domine, avec des décorations bleues et rouges. Une multitude d’étoiles dorées se détachent de la coupole. Les façades polychromes sont en rouge et blanc.

Le seul musée juif de Suisse se trouve à Bâle. Sa collection reflète le patrimoine juif de la région, comme des livres en hébreu imprimés à Bâle, des pierres tombales, des documents sur l’histoire des juifs et sur les congrès sionistes.
Le centre communautaire abrite également le restaurant casher Topas.
En 2012 fut ouverte la première synagogue depuis 83 ans. La communauté juive comptait alors près de 2000 membres. Elle fait partie du Centre Juif Chabad Feldinger . Elle se situe à proximité de la synagogue Chabad. Elle a été vandalisée en 2018. Cette même année une boucherie cachère fut attaquée à plusieurs reprises.
Rencontre avec Barbara Haene, Directrice des recherches et de l’événementiel au Musée juif de Suisse

Jguideeurope : Quels sont les événements prévus pour les Journées Européennes de la culture juive ?
Barbara Haene : Le Musée juif de Suisse s’occupe de l’organisation des Journées Européennes de la culture juive en Suisse depuis l’initiation en 1999, avec de nombreuses activités proposées. La visite guidée de la ville « sur les traces de Herzl à travers Bâle » et la visite guidée de la synagogue sont également très appréciées chaque année.
Pouvez-vous présenter certains objets qui figurent à l’expo « Jewish for beginners and experts » ?
En tant qu’historienne travaillant sur l’histoire juive de la Suisse, j’ai bien sûr certaines préférences. J’aime particulièrement les objets qui témoignent de la vie simple des juifs dans la campagne d’Endingen Lengnau, par exemple un manteau de la Torah utilisé à l’origine pour une robe de femme. Ou bien une montre à gousset de la Chaux-de-Fonds qui témoigne de l’importance des juifs dans le métier de l’horlogerie en Suisse.
Pour l’histoire juive de Bâle, le premier congrès sioniste, qui fête cette année son 125e anniversaire, est bien sûr aussi d’une grande importance. Le Musée juif conserve de nombreux objets relatifs au premier congrès sioniste. Une collotypie sur laquelle les participants au congrès sont représentés vaut, par exemple, la peine d’être vue.

Constatez-vous une évolution des attentes du public ces dernières années ?
Au cours des dernières décennies, les connaissances des jeunes se sont transformées. Auparavant, ils avaient une connaissance relativement grande des histoires bibliques, d’Adam et Eve, de Moïse et des Dix commandements, de Rachel et de Léa. Ils connaissaient les personnages de l’Ancien Testament grâce à l’église, aux cours de religion ou à leurs bibles pour enfants.
Aujourd’hui, la sécularisation a fortement augmenté. Peu de jeunes visitent les églises. Presque personne ne lit la Bible. Pourtant, les jeunes connaissent mieux les coutumes juives. Ils connaissent Hanoukka et le shabbat, les fêtes de bar / batmitzva et la réglementation de la casherouth. La diversité est en vogue.
Les jeunes rencontrent la culture juive à l’école, sur Netflix et Youtube, dans la musique pop et dans la gastronomie. Leur connaissance du judaïsme est marquée, entre autres, par le houmous, les falafels et les bagels.

Pouvez-vous nous raconter une rencontre avec un visiteur ou un conférencier lors d’un événement culturel qui vous a particulièrement marqué ?
Il y a quelques semaines, nous avons accueilli la rabbine Bea Wyler au musée. Nous avons son châle de prière, son talith, dans notre collection. Bea Wyler a été la première femme à officier en tant que rabbin en Europe germanophone après la Shoah. Lorsqu’elle a été ordonnée dans les années 2000, elle a été confrontée à de nombreux courants contraires en tant que femme dans une profession exclusivement masculine. Aujourd’hui, elle est la première d’une série de jeunes femmes rabbins. Les femmes sont appréciées, jouissent d’un certain prestige et ne ressentent plus de vents contraires que dans certains milieux orthodoxes et ultra-orthodoxes.
Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, ces deux villages étaient les seuls à autoriser l’établissement permanent de juifs. Dès 1622, ils résidaient en qualité d’« étrangers protégés », et leurs communautés géraient en toute indépendance le culte et l’administration interne. Un document de cette année atteste de leur présence.

En 1750, les deux communautés achetèrent un terrain à mi-chemin pour le cimetière . Avant cela, les juifs étaient obligés d’enterrer leurs morts au-delà du Rhin, sur une île achetée par la suite par la ville de Waldshut. Le cimetière juif compte 2700 tombes.
Les premières synagogues datent de 1750 pour Lengnau et 1764 pour Endingen . Elles ont été refaites respectivement en 1848 et 1852. Elles figurent dans un livre de Johann Caspar Ulrich paru en 1768.
Ces synagogues ressemblent à des églises, avec une horloge sur le fronton et un clocher, éléments exigés par les autorités. Il y avait en 1850, dans ces deux villes, 1515 juifs présents. Ces juifs étaient principalement issus des villes de Haute-Alsace (Buschwiller, Hegenheim, Hagenthal…), la région de Bade (Randegg, Wangen, Gailingen, Worblingen…) et Hohenems. Des villes proches de la Suisse, avec laquelle les populations générales entretenaient des liens économiques et culturels.

Les autorisations de migrer dans les autres communes accordées provoquèrent une chute constante de ce nombre. La vague d’émancipation des juifs helvétiques se réalisa entre le long du 19e siècle selon les communes.
À Endingen, village sans église, c’est la synagogue sur la place centrale qui sonnait les heures. La synagogue a été ensuite rénovée en 1998.
Cette politique tolérante ne doit pas occulter la discrimination encore en vigueur vers 1910 : les maisons avaient deux portes d’entrée, l’une réservée aux chrétiens, l’autre aux juifs.
On retrouve de nombreuses maisons témoins de cette époque. Contrairement à la plupart des ghettos juifs d’Europe, les traces de la vie juive sont encore très présentes dans ces villages. Parmi les personnalités issues de ces villages, William Wyler, le réalisateur de Ben Hur et Funny Girl.
Depuis 2009, un tour culturel juif est présenté par les autorités locales afin de rendre hommage au patrimoine historique des villages. Les visiteurs peuvent se promener entre les synagogues, cimetières, maisons à double entrée ainsi que les anciens mikve et commerces.
En 2018, il ne restait plus qu’une vingtaine de juifs à Lengnau et Endingen. La plupart étant des personnes âgées vivant dans une maison de retraite.
Fondée en 1833, la communauté juive de La Chaux-de-Fonds se réunit dans un appartement rue Jaquet-Droz. Puis, en 1853, une maison privée accueille une synagogue. Un cimetière juif est utilisé à partir de 1872 dans la commune des Eplatures.

La communauté a inauguré sa synagogue en 1896. L’architecte Kuder s’est inspiré de la synagogue de Strasbourg, plus tard détruite par les nazis. De style roman, en pierre de taille, l’édifice possède une coupole octogonale avec vingt-quatre fenêtres et des tuiles polychromes, et culmine à 32 mètres. Sur la façade, les Tables de la Loi et deux tourelles. À l’intérieur, la coupole centrale et les quatre petites coupoles des angles sont multicolores, en harmonie avec les vitraux. Le motif principal est une étoile de David, d’où partent des rayons portant les noms de personnages bibliques dans un ciel constellé.
En 1900, La Chaux-de-Fonds est la quatrième ville suisse ayant le plus d’habitants de confession juive, derrière Zurich, Bâle et Genève. Des grands noms de l’industrie de l’horlogerie y vécurent. Parmi les autres professions pratiquées par les juifs de La Chaux-de-Fonds, on retrouve l’artisanat, la brocante et l’enseignement. Ils jouent également un rôle important dans les arts et la culture, ainsi que le monde du sport.
Dans la deuxième partie du 20e siècle, la population juive chute. On dénombre ainsi 70 juifs au tournant des années 2000.

La présence juive lausannoise est attestée de manière continue à partir de 1848, lorsque plusieurs familles se réunissent dans un local loué. En 1895, la communauté compte 41 membres. Ils sont 110 en 1909. À noter que l’immense majorité des juifs alors ne participent pas à la vie communautaire. Car en 1909 il y a en tout 989 personnes de confession juive à Lausanne. La viande cachère est importée d’Évian à cause des lois sur l’abattage.
Un oratoire est inauguré à la ruelle du Grand-Pont en 1878. Un local de prière est utilisé dès 1884 rue du Petit-Saint-Jean. En 1898 est construite une synagogue rue du Grand-Chêne. Dans cet élan, la synagogue de Lausanne , construite en 1910, à l’époque dans un quartier excentré, se trouve aujourd’hui en plein centre, tout près de la gare.

De style romano-byzantin, elle rappelle celle de la rue Buffault à Paris, avec ses Tables de la Loi qui surplombent la façade, à quoi s’ajoutent une rosace en étoile de David, l’arc en plein cintre des fenêtres, des absides romanes et deux tours. L’intérieur est néo-byzantin. Le centre communautaire est orné de vitraux de Jean Prahin.
Il y a deux cimetières qui sont utilisés par les juifs lausannois. Celui du Bois de Cery , de Prilly et de Vassin . Celui de Prilly date du début du 20e siècle, lorsque le cimetière utilisé jusqu’alors à Montoie arrive à saturation. Les tombes de Montoie seront d’ailleurs transférées à Prilly en 1950. Un deuxième cimetière est créé à Prilly en 2002.
La vie juive lausannoise connait un essor à partir des années 1970, notamment grâce à la venue de juifs sépharades. Les offices religieux sont plus réguliers et un groupe scolaire est créé. En 1975 parait le premier bulletin de la communauté israélite de Lausanne.
En 2010 est célébré le 100e anniversaire de la synagogue de Lausanne.
Avant que les juifs puissent s’installer à Genève, la ville voisine de Carouge (rattachée alors au royaume de Sardaigne) leur avait ouvert ses portes vers 1779. Aujourd’hui, il reste pour seul vestige juif l’ancien cimetière , restauré en 1996.

Un grand esprit de tolérance religieuse qui permet cette venue à l’époque, alors qu’à Genève les juifs sont expulsés depuis 1490. L’acceptation des juifs genevois ne se réalise concrètement qu’à la fin du 19e siècle, en 1874 plus précisément, date de l’émancipation au niveau fédéral.
Le nouveau cimetière, à la frontière franco-suisse de Veyrier, abrite les tombes de nombreuses personnalités, comme celle de l’écrivain Albert Cohen.

La ville des banques et de l’horlogerie… mais pas seulement. Genève est une ville bien plus complexe, accueillant une grande université et d’éminents penseurs depuis des siècles et publia une des deux premières bandes dessinées de l’Histoire.

Il semble que la présence juive genevoise date du 13ᵉ siècle, principalement autour de la Place du Grand-Mézel dans la vieille ville. Les juifs furent expulsés de la ville en 1490 et interdits d’y séjourner jusqu’au 19e siècle. Le Grand-Mézel fut d’ailleurs le plus ancien quartier juif fermé d’Europe, créé en 1428 (88 ans avant le ghetto de Venise).

La vieille ville se trouvant sur une petite colline, avec d’un côté les rues commerçantes et de l’autre l’université et les bâtiments culturels. En descendant du Grand-Mézel, à 200m vous trouverez la synagogue historique de Genève.

Refondée en 1852 par des juifs alsaciens, la communauté de Genève a reçu de la ville un terrain pour y édifier une synagogue, en signe de tolérance envers les minorités non protestantes. Située sur la place de la Synagogue, mélangeant style oriental et caractéristiques polonaises, la synagogue Beth Yaacov , conçue en 1857 par Jean-Henri Bachofen, a retrouvé ses couleurs d’origine en 1997 : façade rayée de rose et de gris, coupoles couronnant quatre tourelles à créneaux, coupole centrale surmontée des Tables de la Loi. L’intérieur a une dominante bleu clair (arches et coupole), tandis que les vitraux et les boiseries ajoutent à la vivacité des couleurs.

Traversez la place de Neuve avec ses théâtres et musées pour retrouver l’université genevoise a été créée à l’initiative de Jean Calvin en 1559. Le besoin urgent de remplir les amphis à la fin du 19e siècle bénéficia de manière inattendue des bouleversements politiques d’Europe de l’Est. La période très réactionnaire de l’Empire russe force de nombreux étudiants à quitter le pays et à trouver des places dans des universités occidentales. Motivant surtout pour les femmes qui trouvent, événement rare à l’époque, un accès libre aux universités genevoises. Ainsi, les juifs de l’Est, souvent de conditions très modestes, constitueront jusqu’à plus de la moitié des étudiants genevois. Parmi eux, Lina Stern, spécialiste mondiale du cerveau et la première femme professeure à l’Université de Genève. Mais aussi Chaïm Weizmann, futur premier président d’Israël, qui y enseigna la chimie et y fonda une maison d’édition. Il y élabora avec d’autres étudiants l’idée de ce que deviendra l’université hébraïque de Jérusalem. Ainsi, que de nombreuses figures sionistes, communistes et bundistes.

Dans l’esprit de réconciliation des études et du travail manuel, Aron Syngalowski établit en 1943 à Genève le siège provisoire de l’ORT (Organisation – Reconstruction – Travail), fondée en 1880 en Russie afin de venir en aide aux juifs nécessiteux. Ce siège mondial restera en Suisse jusqu’en 1980.
La synagogue Hekhal Haness , de rite séfarade, a été érigée en 1970. La nécessité de cette construction en marbre reflète le changement ethnique de la communauté genevoise, où les juifs méditerranéens sont devenus majoritaires.

La Communauté juive libérale de Genève – GIL , créée par le Rabbin François Garaï en 1970 rassemble aujourd’hui un tiers des juifs genevois. Il s’agit de la première synagogue francophone à avoir fait monter des filles à la Torah pour leur bat-mitsva.

Ville connue pour ses missions diplomatiques, Genève inspira de nombreux auteurs parmi lesquels deux qui furent aussi impliqués dans des missions diplomatiques, Romain Gary et Albert Cohen. Qui ne se souvient pas des déambulations des Solal dans les rues de Genève et de leur moment inoubliable à l’ONU dans le roman Mangeclous ?

Albert Cohen arrive à Genève afin d’y poursuivre ses études. Naturalisé suisse, il sera inscrit au barreau genevois. Suite à son élaboration du passeport pour personnes déplacées, il reviendra dans la ville en 1947 afin de diriger la Division de protection de l’OIR. Genève sera la ville où l’œuvre de Cohen confronte les générations et malaises entre elles. Tout d’abord entre lui et sa mère, ayant comme son personnage Solal, honte de ses origines et des personnages qui la représentent trop « bruyamment ». Il pleurera pour ces moments de honte dans Le Livre de ma mère et se moquera de sa propre attitude dans Mangeclous, le personnage principal de ce roman et qui porte le même nom causant un grand capharnaüm dans la ville et les plus hautes instances onusiennes, en s’érigeant en émissaire de la création de l’Etat d’Israël.

Le centre communautaire abrite la bibliothèque centrale juive, riche de plusieurs fonds de haute qualité scientifique et artistique, ainsi que Le Jardin et un restaurant casher. C’est également un lieu très actif dans l’organisation d’événements culturels.

La population juive était composée de 1100 personnes en 1900. En 2024, les estimations tendent à dire qu’il y en aurait 6000.

Rencontre avec le rabbin Éric Ackermann, lors de notre visite à la très belle et ancienne Synagogue Beth-Yaacov.
Jguideeurope : Depuis quand êtes-vous le rabbin de cette synagogue ?
Éric Ackermann : Je ne suis pas rabbin de la synagogue, mais rabbin à la synagogue. En effet, il y a plusieurs rabbins dans Genève, et je suis venu compléter l’équipe de Beth-Yaacov, dont le plus ancien, qui est le pilier de celle-ci, est le rabbin Jacob Tolédano. Rabbin et chantre depuis plus de 50 ans, qui enchante les fidèles de sa voix des plus belles d’Europe. Cela dit, je suis dans cette synagogue depuis près de 20 ans.
De par son ancienneté et sa place importante dans le judaïsme genevois, remarquez-vous un désir croissant des nouvelles générations d’y perpétuer les célébrations ?
C’est la plus ancienne synagogue genevoise encore debout, qui date d’avant l’émancipation des Juifs. Aujourd’hui, un nombre toujours croissant de fidèles désirent y perpétuer leurs fêtes familiales : de la circoncision au mariage, et autres anniversaires et cérémonies.
Quelles sont les activités cultuelles et culturelles organisées par la synagogue ?
Comme je le mentionnais, sur le plan cultuel, de nombreuses cérémonies dans le cadre de la CIG marquent la vie de cette synagogue, ainsi que les rencontres interreligieuses et autres formations et visites des écoles genevoises. Sur le plan culturel, de très nombreux cours, débats, et conférences y sont dispensés. Les fêtes et les rencontres communautaires ne manquent pas. N’hésitez pas à consulter le site de la communauté : comisra.ch
Vous êtes très impliqué dans le dialogue judéo-chrétien, comment percevez-vous son évolution en Suisse ?
Je crois que, depuis le concile Vatican II, la confiance et le respect se sont installés, et le dialogue a pu se renforcer et s’épanouir. Du reste, j’ai obtenu en 2018 de la part de la FSCI : le prix suisse du dialogue, dans le cadre de mes activités au sein de la Plateforme interreligieuse de Genève, dont je fus président durant 7 ans. Son évolution contribue au « vivre ensemble » et demeure donc généreuse. En somme, le dialogue avec les autres communautés est l’exercice des temps que nous traversons.
L’histoire des juifs de Spire remonte à plus de 1000 ans. Au Moyen-Âge, la ville de Spire (anciennement Spira) abritait l’une des communautés juives les plus importantes du Saint Empire romain germanique. Son importance est attestée par la fréquence du patronyme juif ashkénaze Shapiro/Shapira et de ses variantes Szpira/Spiro/Speyer. La communauté a été totalement anéantie en 1940 pendant la Shoah. Avec la chute du rideau de fer en 1989, les Juifs se réinstallèrent à Spire et un premier minyan se tint en 1996.

Une riche histoire
Les premiers témoignages attestant d’une communauté juive à Spire remontent aux années 1070. Ils émanaient de la célèbre famille Kalonymos de Mayence, émigrée d’Italie un siècle auparavant. D’autres juifs de Mayence se sont peut-être aussi installés à Spire à la même époque.
L’histoire des de la communauté de Spire commence en 1084, lorsque des Juifs fuyant des pogroms de Mayence et Worms se réfugièrent avec leurs proches à Spire. Ils sont certainement venus à l’instigation de l’évêque Rüdiger Huzmann (1073-1090), qui autorisa un grand nombre de juifs à vivre dans sa ville avec l’accord de l’empereur Henri IV. Dans sa charte (Freiheitsbrief) des Juifs, l’évêque approuve l’établissement de la communauté dans un espace défini.

Cette zone correspond à l’ancienne banlieue d’Altspeyer dans l’espace situé à l’est de la gare d’aujourd’hui. Ce quartier fortifié se trouvait au nord, en dehors des murs de la ville, et constitue le premier ghetto documenté de la ville.
La charte ratifiée par l’évêque Huzmann allait bien au-delà de la pratique en cours ailleurs dans l’empire. Les juifs de Spire étaient autorisés à effectuer toute sorte de commerce, à échanger or et argent, à posséder des terres, à disposer de leurs propres lois, de leur système judiciaire et administratif, à employer des non-juifs comme domestiques, et n’étaient pas tenus de payer les droits de douane des frontières de la ville.
Les deux chartes
La raison pour laquelle les juifs sont appelés à venir à Spire par l’évêque était leur rôle important dans le commerce fiduciaire et commercial, et en particulier leurs liens avec les régions éloignées. Les bailleurs de fonds étaient nécessaires à grande échelle pour la construction de la cathédrale. Spécificité de Spire : notez que les droits et privilèges spécialement accordés aux juifs de cette ville ont été finalement étendus à tous les Juifs de l’empire.

Les deux chartes de 1084 et 1090 ont marqué le début de « l’âge d’or » des juifs à Spire qui, avec des restrictions, devait durer jusqu’au 13ème ou 14ème siècle. Selon ces documents, un « Archisynagogos », également appelé « évêque juif », présidait l’administration ainsi que le tribunal de la communauté. Il était élu par la communauté et « adoubé » par l’évêque. Plus tard, des sources font état d’un « conseil de juifs » de douze membres, présidé par « l’évêque juif » qui représentait la communauté à l’extérieur. En 1333 et 1344, l’autorité du conseil des juifs fut ratifiée par le conseil municipal de Spire.
En 1096, les Juifs de Speyer sont parmi les premiers touchés par les pogroms provoqués par l’épidémie de peste, mais, comparé aux communautés de Worms et de Mayence qui ont suivi quelques jours plus tard, ils furent relativement épargnés.
Développement de la vie juive
À peu près à cette époque, un deuxième quartier juif fut établi à proximité de la cathédrale, le long de la Kleine Pfaffengasse qui était autrefois la Judengasse (rue des juifs), tandis que l’ancien quartier juif et sa synagogue subsistaient à Altspeyer. On estime que la communauté juive de Spire était alors composée de 300 à 400 personnes.

Au cours de ces années, la communauté juive de Spire devint l’une des plus importantes du Saint Empire romain germanique. C’était un centre important d’études de la Torah et, malgré les pogroms, les persécutions et les expulsions, avait une influence considérable sur la vie spirituelle et culturelle générale de la ville. Lors d’un synode de rabbins à Troyes, vers 1150, la direction de la communauté juive allemande fut transférée aux communautés de Spire, Worms et Mayence.
Développement intellectuel et religieux
Les trois communautés créèrent une fédération appelée « ShUM » (שום: initiales des noms hébreux des trois villes) et ont conservé ce pouvoir jusqu’au milieu du 13ème siècle. Les villes de SHUM avaient leur propre rite et étaient reconnues comme une autorité centrale en matière juridique et religieuse. Spire avait des écoles juives renommées et une Yeshiva très fréquentée.
En raison de la haute estime à laquelle étaient tenues, au Moyen Âge, les trois villes de ShUM, elles furent louées comme une « Jérusalem rhénane ». Ces villes eurent une influence considérable sur le développement de la culture ashkénaze européenne. Au 13ème siècle, Issac ben Mose Or Sarua de Vienne écrit : « De nos professeurs à Mayence, Worms et Spire, les enseignements ont été étendus à tout Israël … ».

Pourtant, même en cette période florissante, des violences antisémites éclatèrent en 1146, 1195, 1282 et 1343. En 1349, pendant la peste noire, la communauté juive de Spire est totalement anéantie. Dans les années suivantes, une petite communauté se rétablit sans jamais retrouver la taille et le statut qu’elle avait avant 1349. Les juifs sont expulsés de Spire de 1405 à 1421, puis « pour l’éternité » en 1435. L’un des réfugiés de Spire est Moses Mentzlav, dont le fils, Israël Nathan, a fondé la célèbre imprimerie hébraïque de Soncino, en Italie.
Retour des juifs à Spire
De 1621 à 1688, les Juifs se ré-établissent à Spire. C’est surtout pendant la Guerre de Trente ans et les années suivantes que les villes endettées font appel au pouvoir financier de la communauté. La ville commence à contracter des emprunts auprès des juifs dès 1629. Cependant, à la suite de plaintes, avant que Spire ne soit incendiée par les Français en 1689, les échanges et les transactions financières avec les juifs avaient été totalement interdits. Au cours des années suivantes de reconstruction, les juifs n’étaient pas autorisés à se réinstaller de manière permanente.
Une communauté juive s’établit à Spire après la Révolution française. Elle se distingue par ses attitudes libérales et émancipées qui, maintes fois, le mettent en conflit avec les communautés juives plus conservatrices de la région rhénane. En 1828, la communauté fonde un organisme caritatif et contribue aux efforts du conseil municipal pour lutter contre la grande pauvreté dans la ville. En 1830, la communauté juive de Spire compte 209 membres. En 1837, une nouvelle synagogue est construite sur le site de l’ancienne église Saint-Jacques de la Heydenreichstraße ; la synagogue comprenait une petite école.
Montée de l’antisémitisme
En 1890, la communauté juive compte 535 membres, le plus grand nombre jamais enregistré à Spire ; en 1910, leur nombre avait diminué à 403. Au début des années 1930, les juifs de Spire commencent à partir pour les grandes villes ou à émigrer en raison de la montée de l’antisémitisme.

En 1933, le nombre de Juifs à Spire était tombé à 269 et au moment où leur synagogue fut incendiée pendant la Nuit de Cristal, il ne restait plus que 81 personnes. Dans la nuit du 9 novembre, des troupes de SA et de SS pillent la synagogue de la Heydenreichstraße, emportant la bibliothèque, les étoffes précieuses, tapis et ustensiles rituels, et incendient le bâtiment. Avec la synagogue, les Juifs perdent également leur école. La même nuit, le cimetière juif est vandalisé. Un membre de la communauté aménage une salle de prière dans sa maison de Herdstraße. La ville a ensuite utilisé cette maison comme lieu de stockage pour les meubles volés aux juifs déportés.
Le 22 octobre 1940, 51 des 60 Juifs restant à Spire sont déportés dans le camp d’internement de Gurs, dans le sud de la France.
Certains d’entre eux réussissent à s’enfuir en Suisse, aux États-Unis et en Afrique du Sud avec l’aide de la population locale, tandis que les autres sont déportés à Auschwitz. Caché à Spire, un seul juif a survécu à l’ère nazie.

Il fut décidé de construire une nouvelle synagogue dans le prolongement de l’ancienne église médiévale de Saint-Guido dans les années 1990. La consécration de la synagogue Beith Shalom eut lieu le 9 novembre 2011. Elle abrite également un centre communautaire.
Le cimetière juif médiéval de Spire se trouvait en face de la Judenturm (tour des juifs), à l’ouest de l’ancien quartier juif d’Altspeyer (aujourd’hui entre Bahnhofstraße et Wormer Landstraße). Après la réinstallation des Juifs à Spire au 19ème siècle, un nouveau cimetière fut construit à St. Klara Klosterweg et resta en service jusqu’en 1888. L’ancienne morgue et une partie du mur occidental sont toujours visibles. En 1888, le cimetière juif a été transféré dans le nouveau cimetière municipal construit au nord de Spire, le long de la rue Wormser Landstraße, où il occupe maintenant la partie sud-est.
Itinéraire
Lorsque vous sortez de la gare de Spire, sur la Banhoferstrasse, le parc Adenauer vous accueille. Nommé en hommage à l’ancien chancelier allemand Konrad Adenauer, il accueille la tombe d’un autre ancien chancelier, Helmut Kohl.

Après avoir traversé ce très joli petit parc, vous tombez sur la St.-Guido-Stiffts Platz. Et là, ne soyez pas surpris de trouver un panneau en 2 langues, en allemand d’un côté et en hébreu de l’autre, parce qu’il indique l’emplacement du Kikar Yavne . Une place ainsi nommée en hommage à la ville israélienne de Yavné, avec laquelle Spire est jumelée depuis 1998.

En prenant la petite allée Weidenberg, le joli petit parc très fleuri vous ferez face à une sculpture de menorah en métal et juste derrière la nouvelle synagogue de Spire.

En descendant ensuite la Wormser Strasser et ses ruelles adjacentes avec des maisons de couleurs différentes et leur végétation très présente, vous arrivez au cœur de la vieille ville. En face du numéro 9 de la rue ont été posées des stolpersteine.

Au bout de cette rue, l’inévitable Maximilian Strasse. A droite, on aperçoit un des plus célèbres monuments de la ville, l’Altpörtel, une porte du moyen-âge mesurant 55 mètres de haut, construite au 13e siècle.

La Maximilian Strasse est la rue commerçante principale de la vieille ville. Elle relie ses principaux monuments anciens de l’Altpörtel à la cathédrale de Spire. En face du début de la Wormser strasser, à 50 mètres de l’Altpörtel est située la Galeria Speyer, un grand magasin situé sur le lieu de l’ancienne synagogue détruite pendant la Nuit de Cristal.
En prenant la ruelle Karlsgasse qui longe le magasin, vous trouverez le Mémorial qui rend hommage aux Juifs de Spire déportés pendant la Shoah, érigé en 1992.

En prenant ensuite sur votre gauche sur la Hellergasse, qui se prolonge dans la Kutschergasse, vous arriverez sur la petite place du marché. En la traversant en diagonale, vous prenez la Kleine Pfaffengasse où se situe le musée juif de Spire, le SchPIRA .
Juste avant le musée, sur votre droite, vous verrez la Judengasse et la Judenbadgasse, respectivement nommée ruelle des Juifs et la ruelle du Bain rituel juif.

Le SchPIRA est relativement petit. Avec quelques objets anciens, vestiges de l’ancienne synagogue et des pierres tombales. Lesquelles semblent dater du 13e siècle.
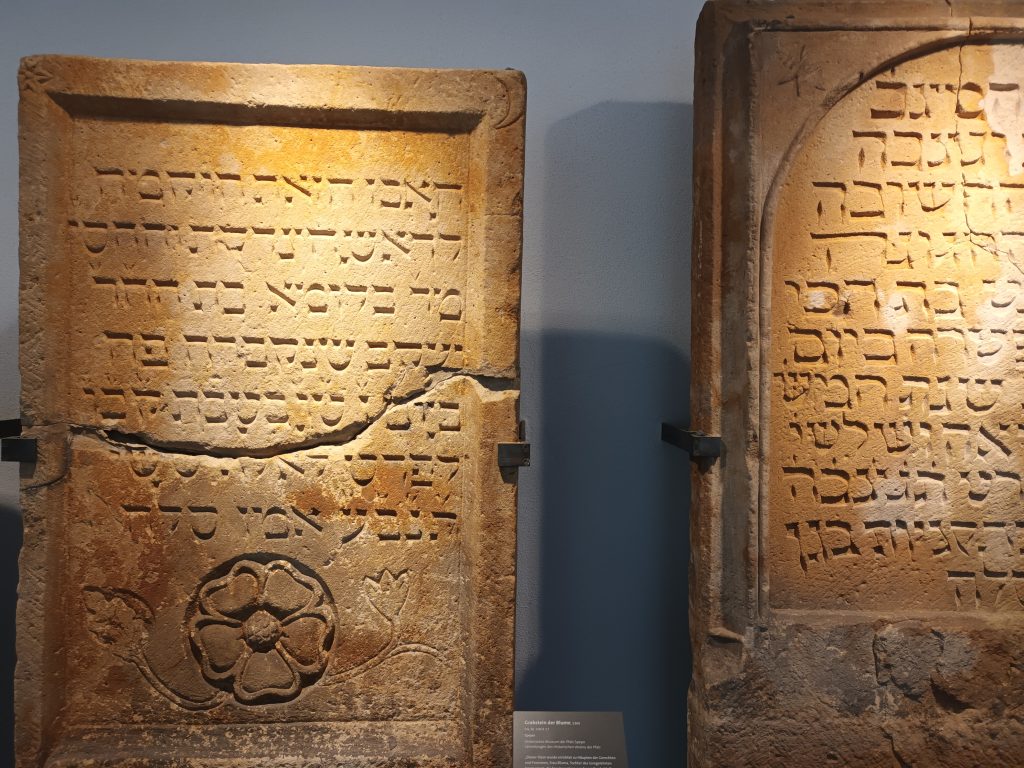
Une maquette de l’ancien mikvé est présentée afin de permettre aux visiteurs de voir à quoi celui-ci ressemblait dans son ensemble. Sur le sol ensuite est dessinée une carte de l’ancienne Spire.
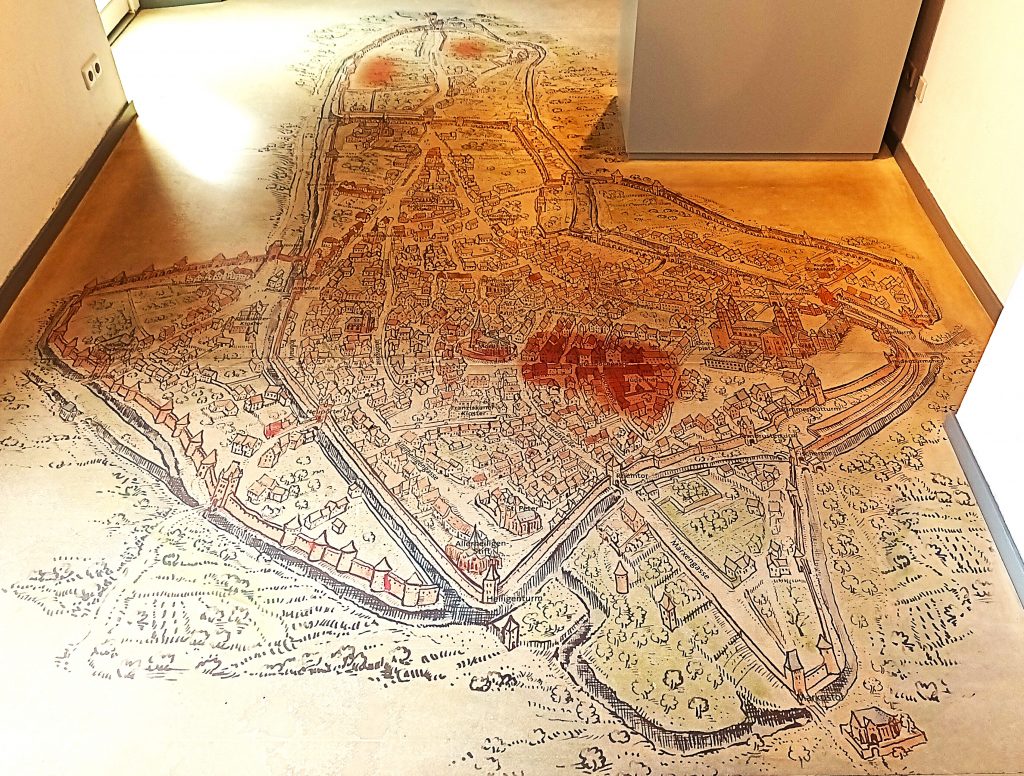
Dans la salle suivante, quelques panneaux retracent l’histoire. Des sièges vous permettent de regarder tranquillement des vidéos de présentation en allemand ou en anglais. Ainsi, deux films sont disponibles en anglais. Le premier dure 12 minutes et raconte l’histoire de la synagogue, avec son évolution au fil du temps et les (re)constructions nécessaires. Elément particulièrement intéressant dans cette présentation, la construction de la salle des femmes. Dans certaines synagogues de l’époque, les femmes n’étaient pas juste assises derrière ou au-dessus mais disposaient de leur propre salle. A travers de laquelle quelques fenêtre les liaient à la salle réservée aux hommes afin qu’elles puissent suivre les prières.

On voit donc dans la vidéo l’évolution architecturale de la synagogue et le rôle influent que joua cette communauté à la fin du Moyen-Âge. Sans oublier de parler de sa destruction, suite aux accusations antisémites classiques d’empoisonnement des puits, comme ce fut le cas à travers l’Europe médiévale. L’autre vidéo est consacrée aux rituels juifs, dans un souci de vulgarisation de leur signification pour les visiteurs.
Dans le petit jardin très fleuri du musée, vous verrez quelques sculptures, dont une intitulée « Les sages de Spire », en souvenir de tous les éminents rabbins qui s’y formèrent et enseignèrent.

En face du petit jardin intérieur, on aperçoit à droite les vestiges de la synagogue avec ses deux salles. Des pierres rouges et jaunes témoignent de l’évolution architecturale des synagogues à travers le temps. Et on peut voir, encore intactes, certaines fenêtres reliant la salle des hommes à celle des femmes. Ces fenêtres, en réalité six petites ouvertures, ont été percées dans le mur entre les 2 salles. Il y avait également une porte de communication entre celles-ci, située à l’extrême ouest du mur. Des bancs étaient positionnés tout autour de la salle de prière des femmes. Un d’entre eux est toujours conservé aujourd’hui.

La synagogue consacrée en 1104, a été construite comme une pièce romane d’environ 10 mètres de large et 17 mètres de long. La maison de culte fut endommagée lors du pogrom de 1349 et réparée en 1354 avec plusieurs modifications dans sa construction. Après l’expulsion des juifs au début du 16ème siècle, la synagogue fut transformée en un arsenal municipal avant d’être finalement démolie.
Le premier architecte à avoir travaillé sur la synagogue n’était pas juif, car à cette époque les juifs étaient interdits de pratique de certains métiers. Notamment ceux liés à l’artisanat. En 2025, nous avons pu observer les travaux de restauration de cette ancienne synagogue.

Juste à côté des vestiges de la synagogue est situé le célèbre mikvé de Spire. Le bain rituel tombe en désuétude au 16ème siècle, mais ses ruines représentent aujourd’hui les plus anciens vestiges visibles d’un mikveh en Europe centrale. Aujourd’hui, ce site du patrimoine archéologique européen a été rendu accessible au public et le bassin est toujours alimentée par les eaux souterraines. La première mention du mikvé date de 1128. Il a donc été probablement construit en même temps que la synagogue, au début du 12e siècle. Il est très bien conservé et éclairé, vous permettant de descendre vers l’endroit où était situé le bain rituel l’eau toujours abondante.

Le mikveh de Spire est considéré aujourd’hui comme le mieux conservé d’Europe. Un escalier voûté en tonneau mène à travers un vestibule à un puits carré situé à 10 mètres sous le sol. Le mikveh est orné de riches ornements colorés de l’époque romane. Une fenêtre en deux parties ouvre la vue sur le bassin. Le mikveh est aujourd’hui recouvert d’une structure de verre afin de la protéger. Le bain n’est plus officiellement employé aujourd’hui, mais son utilisation peut être organisée en dehors des heures d’ouverture officielles pour les touristes.

Tout autour, des panneaux explicatifs concernant la construction du mikvé, mais aussi la chronologie de la vie juive et les grandes heures de la communauté de Spire, ainsi que sa renaissance contemporaine.
En sortant du musée SchPIRA, vous reprenez à droite sur la Kleine Pfaffengasse pour arriver 100 mètres plus loin à la Domplatz ou des située la très belle et immense cathédrale de Spire, construite à partir du 11e siècle sous Conrad II.

On peut observer sur son entrée des moments célèbres de la Bible, sculptés en fer forgé. A l’intérieur, comme dans de nombreuses cathédrales allemandes, de très beaux orgues jouent parfois, pour le plus grand bonheur des visiteurs. Tableaux et statues à l’intérieur et à l’extérieur de la cathédrale rendent hommage à la Bible et aux souverains allemands.

Et pour finir cette promenade, nous vous recommandons le très joli plat parc situé juste derrière la cathédrale, dans lequel vous verrez notamment des sculptures contemporaines et une très apaisante végétation.

Cette ville estudiantine des bords du Neckar abrite, dans la bibliothèque de l’université, une collection de manuscrits hébraïques datant des XIIe, XIIIe et XIVe siècles, notamment les chansons du troubadour juif Süsskind von Trimberg, décorées de 137 miniatures polychromes.
Un mémorial a été créé afin d’honorer la mémoire des victimes de la Shoah.

Constitution d’archives
Les « Archives centrales sur l’histoire des juifs en Allemagne », auparavant gardées en plusieurs endroits, ont été regroupées en 2021 dans les locaux d’une ancienne usine de tabac.
Mises à disposition du public en 1987, elles contiennent de précieux documents sur les communautés des différentes villes allemandes ainsi que des documents en tout genre, tels que des lettres de soldats juifs combattant sur le front pendant la Première Guerre mondiale ou des dossiers sur les survivants de la Shoah. Le ministère de l’Intérieur allemand, en coordination avec les institutions juives, participe activement à la réalisation et à la pérennisation de cette bibliothèque.
