La présence juive à Chypre date probablement du 3e siècle avant Jésus-Christ, pendant la conquête romaine de l’île.

Il semble y avoir eu à l’époque au moins trois synagogues à Chypre. Dans les localités de Lapethos, Golgoi et Constantia-Galamine. Les juifs participèrent à la révolte contre Rome menée par Artemion en 117 et furent chassés de l’île par les Romains en guise de punition.
Les juifs s’y réinstallèrent avec le temps, comme l’attesta le grand voyageur Benjamin de Tudèle au 12e siècle. Une stabilisation de la présence juive qui se poursuivit jusqu’à l’avènement de l’Empire ottoman.

À partir de la fin du 19e siècle, suite à la conquête britannique et à la renaissance du sionisme, des dizaines de familles juives s’installèrent sur l’île. Certaines ayant l’espoir de pouvoir rejoindre la Palestine alors sous mandat britannique, mais limitant l’accès. En 1901, l’île comptait 120 juifs, la plupart habitant à Nicosie.
Suite à la montée du nazisme en Allemagne, des centaines de juifs trouvèrent refuge à Chypre. À la fin de la guerre, l’île fut utilisée par l’Angleterre comme camp de détention pour plus de 53 000 juifs qui souhaitaient rejoindre Israël.
Des conditions de vie très difficiles, un peu allégées par l’aide d’organisations internationales comme le JDC et l’aide de milliers de Chypriotes courageux. Une grande partie des prisonniers durent y attendre jusqu’à l’indépendance d’Israël en 1948.
En 1951, seuls 165 juifs vivent à Chypre Un chiffre qui tombe à 25 en 1970.

En 2005, la Maison Chabad ouvrit ses portes à Larnaca, le premier lieu de culte juif officiel depuis des siècles. Quelques centaines de juifs habitèrent alors à Chypre. Arieh Zeev Raskin en devint le premier rabbin.
En dehors de la Maison Chabad de Larnaca, il y a également quatre autres lieux similaires sur l’île. À Nicosie , à Paphos , à Limassol et à Ayia Napa .
En 2020, ce chiffre avoisine les 3500. Sans compter le tourisme d’Israéliens en constante augmentation depuis une vingtaine d’années, les deux pays entretenant des liens économiques, culturels et sécuritaires forts. Le pays accueille aussi de nombreux mariages civils d’Israéliens, mais aussi de Libanais, qui ne souhaitent pas dépendre des autorités religieuses de leurs pays respectifs.
Un musée juif est actuellement en construction à Larnaca afin de présenter les apports de la culture juive sur l’île, mais aussi les actes courageux des Chypriotes pendant la guerre pour aider les réfugiés. On y présentera aussi des rouleaux de la Torah datant du 19e siècle.

Il semblerait que la présence juive sur l’île de Malte date de plus de 3 000 ans ! Des marins descendants des tribus de Zevouloun et Asher accompagnaient des marins phéniciens. Une union ancienne entre Juifs et Phéniciens, qui prospéra et se renforça au fil des siècles.
Des traces de lien se trouvent notamment sur l’île de Gozo, au nord-ouest de Malte, où débarquèrent les marins à l’époque. Des traces similaires sont également présentes dans les catacombes juives des époques grecques et romaines. Certaines des catacombes présentes encore aujourd’hui permettent de voir des symboles juifs, notamment des menoroth. Les plus célèbres étant les catacombes de Saint-Paul à Rabat.

Suite aux conquêtes arabes et normandes, les juifs de l’île restèrent intégrés à Malte et participaient à la société civile. En 1240, 25 familles juives habitèrent sur l’île principale de Malte et 8 à Gozo.
Il y avait durant le Moyen Âge des communautés juives à Mdina, Birgu, La Valette et Zejtun. Ainsi, on retrouve à Mdina un « Marché de soie juif », à Birgu une rue Juive et à Zejtun une place de la Judéité. Il y a également des « Portes des Juifs » dans plusieurs villes, seuls lieux où les juifs avaient le droit d’entrer dans la ville.
Parmi les personnages de l’époque, il y avait l’auteur mystique Avraham Abulafia qui résida à Comino entre 1285 et sa mort quelques années plus tard. Il y écrivit son « Sefer ha Ot » et le « Imrei Shefer ».

Les juifs venaient principalement de Sardaigne, Sicile, Espagne et d’Afrique du Nord. Et leurs conditions de vie étaient relativement moins difficiles que dans la plupart des régions méditerranéennes de l’époque. Occupant parfois des postes de prestige comme celui de médecin en chef. Poste occupé notamment par deux membres de la famille Safaradi, Bracone et Abraham.
La population juive augmenta sous le règne espagnol. Au début du 15e siècle, l’évêque de Malte ainsi que des autorités civiles ôtèrent des discriminations dont les juifs étaient victimes. Xilorun, un juif de Gozo fut même nommé ambassadeur de Malte en Sicile. Néanmoins, l’Inquisition de 1492 mena à la confiscation de leurs biens et à leur expulsion. Certains fuirent et d’autres se convertirent. On retrouve d’ailleurs encore aujourd’hui de nombreux Maltais ayant des noms de famille d’origine juive.

Pendant le règne des Chevaliers de l’Ordre de St. Jean qui dura jusqu’à la défaite face à la France en 1798, la population fut assujettie à la politique martiale. Sans distinction, toutes sortes de populations se retrouvaient victimes de raids militaires sur mer et terre, susceptibles d’être capturées et réduites à l’esclavage. Ce fut donc notamment le cas des juifs, obligés également de porter des signes distinctifs. De nombreux récits évoquent les pillages, meurtres et ventes d’esclaves pendant ces siècles.
Sur la route de l’Égypte, Napoléon conquit Malte en 1798 et y appliqua donc le droit français, à savoir entre autres l’abolition de l’esclavage et l’égalité entre tous les citoyens. Cette liberté acquise fut maintenue par les conquérants britanniques peu de temps après. En 1846, la communauté avait son premier rabbin officiel depuis le temps de l’Inquisition : Josef Tajar.

Durant la Seconde Guerre mondiale, les juifs fuyant le nazisme ne devaient pas avoir de visa pour arriver à Malte, ce qui permit à des milliers d’entre eux de s’y réfugier. De nombreux juifs maltais s’engagèrent dans l’armée britannique à l’époque.
Le pays obtint son indépendance en 1964. Suite à des projets de rénovation de quartier, l’ancienne synagogue de Malte fut détruite en 1979. En 2013, une Maison Chabad s’établit également sur l’île.
La petite et très ancienne communauté juive maltaise est composée de 200 personnes en 2025. La plupart des juifs maltais habitant à La Valette.
Il y a trois cimetières juifs à Malte. Le cimetière de Kalkara , le plus ancien, date du 18e siècle. Dans la banlieue de Marsa se trouve le deuxième, qui date de la moitié du 20e siècle. Le troisième se situe à Tal Braxia et est abandonné.
La présence juive à Gibraltar semble remonter au 14e siècle. Un document historique de 1356 fait référence à une tentative de la communauté juive de libérer des prisonniers retenus par des pirates.

Lors de l’Inquisition de 1492, de nombreux juifs fuient vers l’Afrique du Nord en traversant Gibraltar. Lorsque, suite au traité d’Utrecht de 1713, l’île passa sous domination britannique, les juifs furent autorisés à s’y réinstaller. Au fil du 18e siècle, les juifs s’établissent à Gibraltar, notamment des marchands de Tétouan au Maroc, rejoints ensuite par des Anglais et des Hollandais.
En 1805, ils constituent la moitié des habitants de Gibraltar, créant même un journal en ladino, « Cronica Israelitica ». En 1878, l’île compte plus de 1500 juifs.
Au 20e siècle, ce chiffre déclina rapidement jusqu’au début du prochain siècle, notamment suite à l’évacuation des populations civiles pendant la Seconde Guerre mondiale et au blocus de Franco.
Une augmentation de la population juive a été constatée au début du 21e. Il y aurait un peu moins de 800 personnes aujourd’hui rattachées à la communauté juive de Gibraltar, ce qui constitue 2 % de la population.
L’île de Gibraltar possède quatre synagogues.

David Nieto, Grand rabbin sépharade en Angleterre, eut pour fils Isaac Nieto. Celui-ci fut nommé, suite à sa formation, rabbin à la synagogue anglaise de Bevis Marks. Il dirigea ensuite la synagogue Shaar Hashamayim , construite au milieu du 18e siècle, laquelle s’inspira d’ailleurs de l’architecture de Bevis Marks. Il s’agit encore aujourd’hui de la principale synagogue si situant à Gibraltar.

La synagogue Etz Chayim a été inaugurée en 1759 dans les locaux de l’ancienne yeshiva fondée par Isaac Nieto. De rite marocain, elle a été détruite et reconstruite.
La synagogue Nefutsot Yehuda a été fondée par des marchands néerlandais en 1800. Construite dans un jardin, elle s’inspire architecturalement de la synagogue sépharade d’Amsterdam. Détruite par un feu en 1913, son style changea lors de sa reconstruction, plus inspiré par une touche italienne à l’intérieur des murs.

Suite à la mort du rabbin Solomon Abudarham en 1804, son école talmudique fut convertie en synagogue quinze ans plus tard. La synagogue Abudarham est un petit lieu de culte avec des PEWS de bois face à la bimah.

Le Jews Gate Cemetery , l’ancien cimetière juif, se situe sur Windmill Hill. Il fut utilisé entre 1746 et 1848. C’est là que furent d’ailleurs enterrés les anciens Grands rabbins de l’île. Le cimetière se trouve à proximité du monument des Piliers d’Hercule.
Le cimetière actuel se trouve sur la Devil’s Tower Road. Y sont notamment enterrés des héros de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale.

Les premiers documents qui attestent de la présence des juifs au Luxembourg datent de 1276, lorsqu’un acte mentionne la religion juive d’Henri de Luxembourg. Les juifs auraient habité à l’époque la vallée de la Pétrusse.
Des persécutions entraînant dans certains cas la mort se déroulèrent suite à des accusations d’empoisonnement des puits pendant l’épidémie de la peste de 1348. Les juifs qui survivent à ces persécutions fuient le pays, dont ils sont officiellement expulsés en 1391. Quelques familles tentent de rester à Luxembourg et Echternach, mais, en 1532, l’Edit de Charles Quint met fin à ces espoirs.
Dans l’esprit émancipateur de la Révolution française, le Luxembourg, conquis par la France, applique les directives impériales. Ainsi, le 14 juillet 1795, les taxes discriminatoires imposées aux juifs et les limitations géographiques sont abolies par décret.
Un recensement du début du 19e siècle permet d’affirmer que 75 juifs habitent au Luxembourg. Une moyenne d’âge assez jeune. Ils sont principalement issus de villages de la Moselle et de la Sarre. Des gens attirés par l’espoir de pouvoir travailler dans le domaine du commerce ou de l’artisanat et de pouvoir exercer le culte.

Deux personnages symbolisent l’enracinement des juifs sur le territoire luxembourgeois. Tout d’abord, Jean Baptiste Lacoste (1753 – 1821), avocat et ancien député du Cantal à la Convention. Il est nommé préfet au Luxembourg et en compagnie du Conseil Municipal et du Procureur impérial, ils attestent auprès du Tribunal de première instance que « la conduite civile et politique était exempte de tout reproche et que la surveillance de la police ne rencontrait aucun sujet de plainte particulière contre eux, ce qui est un témoignage constant de leur moralité ».
L’autre figure marquante est Pinhas Godchaux. Né en 1771, et issu d’une famille messine et ayant parmi ses ancêtres le Maharal de Prague, Pinhas Godchaux s’installe au Luxembourg en 1798. Graduellement il devient le dirigeant de la communauté juive, d’abord rattachée au Consistoire de Trêves puis à celui de Maastricht.
Dès 1815, les juifs, venant en grande partie d’Allemagne et de Lorraine, s’établissent successivement dans d’autres villes : Arlon (ville luxembourgeoise jusqu’en 1839), Ettelbruck, Grevenmacher, Mertert, Dalheim, Echternach, Grosbous, Erpeldange, Frisange, Schengen et Esch.
L’inauguration de la première synagogue du Luxembourg se déroule en 1823, dans la rue du Petit Séminaire. Suite à la venue d’autres familles juives d’Alsace et de Lorraine lors de la guerre de 1870, la communauté obtient le droit de construire une deuxième synagogue, inaugurée le 28 septembre 1894 par le rabbin Isaac Blumenstein et le président du Consistoire Louis Godchaux y accueillant ce jour-là les hautes autorités luxembourgeoises. Durant ce siècle, les villes d’Ettelbruck, Mondorf et Esch construiront également chacune une synagogue.

Clausen Malakoff , créé en en 1817, est le premier cimetière juif luxembourgeois. Il reste en fonction jusqu’en 1884, lorsque celui de Bellevue lui succède. Ettelbruck (1881), Grevenmacher (1900) et Esch-sur-Alzette (1905) permettent également la création de cimetières juifs.
Le Rabbin Samuel Hirsch est la grande figure juive intellectuelle de cette époque. Formé dans l’éminente communauté traditionnelle de Dessau, sa vision libérale du judaïsme, favorisant le tutoiement de l’approche philosophique juive et la pensée sociétale contemporaine, l’oblige à quitter l’institution. Bien qu’étant nommé Grand rabbin du Luxembourg de 1843 à 1866, il ne réussit pas à convaincre la communauté traditionaliste de son approche réformatrice. Il la partage ensuite à Philadelphie, inspirant profondément le courant libéral américain.
A cette époque, Samson et Guetschlick Godchaux, les neveux de Pinhas, révolutionnent le métier du tissage et la condition des travailleurs au 19e siècle. Une aventure économique qui démarre en 1823 par deux métiers à tisser dans une remise rue Philippe II. Déménageant à Schleifmuhl, l’entreprise développe son activité. Associée à la fin du siècle au fabricant Conrot, la famille emploie plus de 2 000 ouvriers, dont la majorité à Schleifmuhl. L’évolution de la condition sociale se caractérise par la construction d’un village ouvrier avec des petites maisons à Hamm. Loin d’être une cité dortoir, ce village a sa propre chorale, une crèche et une école maternelle, un club de Kayak. Il organise des manifestations culturelles et surtout une société entraide et de secours mutuel, sorte de sécurité sociale avant l’heure. Le déclin s’amorcera après la Première Guerre mondiale. Les usines fermeront en 1939. Emile Godchaux, descendant de la famille et dernier directeur de l’entreprise, est déporté et mort à Theresienstadt en 1942.

Dans l’entre-deux-guerres, de nombreux juifs d’Europe de l’Est fuyant la pauvreté et l’antisémitisme s’installent dans le grand-duché, encouragés par les appels d’offre dans les bassins miniers de la sidérurgie. Une immigration qui se poursuit avec la venue de juifs d’Allemagne et d’Autriche entre 1935 et 1940, suite à l’application des lois de Nuremberg.
Le 10 mai 1940, le Luxembourg est envahi pas l’armée allemande. Ses 4 000 juifs subissent les persécutions du chef nazi de l’administration civile envoyé par Berlin. Les synagogues de Luxembourg et Esch sur Alzette sont détruites.
Une période marquée aussi par le courage d’une poignée d’hommes qui réussissent à organiser l’évasion des juifs du Luxembourg. Le Grand Rabbin Serebrenik est aidé par un officier de la Wehrmacht responsable du bureau des passeports, Franz von Hoiningen Huene (François Heisbourg raconte cette période dans le livre « Cet étrange nazi qui sauva mon père »), le chargé d’affaires américain George Platt Waller et par l’ex-président du Consistoire, Albert Nussbaum. Ce dernier organise un réseau complexe à partir de Lisbonne, financé par l’organisation américaine JDC. Laquelle permet à de nombreux juifs luxembourgeois, mais aussi belges, allemands et européens de l’Est d’embarquer pour les Etats-Unis, le Brésil et d’autres destinations d’Amérique latine comme Cuba, la Jamaïque ou le Venezuela.

Victor Bodson, ancien ministre de la Justice, sauve des juifs en les aidant à fuir le pays. Notamment par la rivière Sauer à côté de laquelle il habite et qui marque la frontière entre l’Allemagne et le Luxembourg. Pour son courage, il sera ensuite nommé Juste parmi les Nations.
Suite à la Libération le 9 septembre 1944, les 1 500 juifs luxembourgeois qui survécurent reconstruisent la communauté, grâce notamment à l’aide du gouvernement. Les architectes Victor Engels et René Maillet construisent un bâtiment qui sert à la fois de lieu de culte et de centre communautaire. L’inauguration se déroule le 28 juin 1953, en présence de SAR le grand-duc héritier Jean, des hautes autorités de la Ville et de l’Etat et de nombreux rabbins parmi lesquels le Grand Rabbin de France Jacob Kaplan. Le Grand Rabbin Lehrmann consacre la synagogue , au cours d’une cérémonie solennelle présidée par le Président du Consistoire, Edmond Marx.
Un an plus tard, Esch-sur-Alzette accueille une synagogue également. De courant libéral depuis 2008, elle se trouve sur la rue du Canal. Un immeuble construit dans le même style que la synagogue de la ville construite en 1899 et détruite pendant la guerre. On y remarque tout particulièrement ses grands vitraux. La synagogue libérale d’Esch célébra ses 70 ans en 2024.
On peut également visiter l’ancienne synagogue de Mondorf-les-Bains qui est aujourd’hui un centre culturel.
La synagogue d’Ettelbruck, cédée par le Consistoire de Luxembourg à la ville d’Ettelbruck, qui en a fait un Centre de Culture et de Rencontre, abritera bientôt un musée du Judaïsme luxembourgeois.
Le Docteur Emmanuel Bulz marque fortement la période contemporaine du judaïsme luxembourgeois. Grand rabbin de 1958 à 1990, il oeuvre sans cesse pour un rapprochement avec le monde non juif et plus particulièrement la société civile luxembourgeoise. Cela, en partageant une connaissance du judaïsme et une démythification de certaines idées reçues. Joseph Sayag lui succède, puis Alain Nacache, Grand rabbin depuis 2011.

Le travail d’historiens tels Serge Hoffmann, Paul Dostert et Denis Scuto, ainsi que l’action politique du député Ben Fayot permirent une étude précise de l’histoire des juifs luxembourgeois pendant la Shoah. Ce qui déboucha le 10 février 2015, sur la présentation par Vincent Artuso de son rapport « La question juive au Luxembourg, 1933-1941.L’Etat luxembourgeois face aux persécutions antisémites nazies ».
Le 11 mai 2015, la décision est prise d’ériger un monument destiné à commémorer les victimes de la Shoah. Un mémorial qui se trouve en un lieu central de la ville, à l’ombre de la cathédrale et de la première synagogue, tout près de la Gölle Fraa. Il est inauguré la 17 juin 2018 en présence du Grand-Duc Henri, de la Grande Duchesse Maria Teresa et des autorités politiques nationales et municipales. Une oeuvre sculptée dans le granit rose par l’artiste et rescapé Shelomo Selinger, proche de la Gëlle Fra, symbole de la liberté et de la résistance du peuple luxembourgeois.

La Fondation Luxembourgeoise pour la Mémoire de la Shoah (FLMS) est créée en 2018. Une structure qui se donne pour mission de perpétuer la mémoire de la Shoah mais aussi de tous les autres crimes contre l’Humanité. Elle lutte aussi de manière préventive par l’organisation de programmes contre le racisme, le révisionnisme et le négationnisme. Revanche historique, puisque le lieu se situe à l’emplacement de l’ancien Quartier général de la Gestapo.
Autre lieu intéressant à visiter, le Musée national de la Résistance situé à Esch. Il retrace cette histoire au Luxembourg pendant la guerre. Des photos, objets et œuvres d’art sont présentés au public. Des rénovations s’y déroulèrent de 2018 à 2023. Depuis 2024, il dispose d’une superficie bien plus grande.
Rencontre avec Claude Marx, ancien président du Consistoire israélite de Luxembourg.

Jguideeurope : L’Association Memoshoah a consacré une exposition au sauvetage des juifs luxembourgeois vers le Portugal et la traversée atlantique. Comment s’organisa ce sauvetage de manière logistique ?
Claude Marx : Le 10 mai 1940, lors de l’invasion du Grand-Duché de Luxembourg par l’armée allemande, la Communauté juive était composée de 1 000 Luxembourgeois et d’environ 3 000 juifs étrangers, essentiellement des réfugiés allemands et autrichiens. 45 000 personnes fuient le pays dont 1 500 environ appartiennent à la communauté juive. Beaucoup de ces immigrés allemands, autrichiens et apatrides qui n’ont pu fuir vont chercher par tous les moyens à gagner des cieux plus cléments.
Un projet d’évacuation fut imaginé en juillet par l’association de plusieurs personnes : le Grand-rabbin Robert Serebrenik, Albert Nussbaum, un commerçant juif et Président du Consistoire et le baron Franz von Hoiningen Huene, un officier allemand, antinazi notoire et responsable du bureau des passeports, put être concrétisé le 8 août 1940.
Entre août et octobre, de vrais et de faux visas achetés très chers par le Consistoire permettent, grâce à des laisser-passer délivrés par von Hoiningen, à plusieurs centaines de réfugiés de traverser la France, puis l’Espagne, et d’aboutir enfin au Portugal d’où ils auront la possibilité d’embarquer vers l’Amérique du sud, la république dominicaine ou les Etats-Unis.
Un convoi parti le 7 novembre 1940 avec 293 juifs fut arrêté à Vilar Formoso, ville frontière entre l’Espagne et le Portugal, les garde-frontières portugais ayant découvert à bord des SS en uniforme et armés. Le convoi dut rebrousser chemin vers le France après 10 jours passés à l’arrêt sur une voie de garage avec interdiction pour les passagers d’en descendre.
En dépit de cet incident, 7 convois furent encore organisés permettant à plusieurs centaines de réfugiés d’échapper à la mort. Le 20 mai 1941, le Grand-rabbin Serebrenik fut informé par von Hoiningen qu’il était désigné « for liquidation » ainsi qu’il le formule sobrement dans son mémorandum. Il accompagna le 26 mai 1941 un convoi à destination de Lisbonne et put embarquer pour New-York. Le 15 octobre 1941, un dernier convoi de 132 personnes quittait Luxembourg. Il était temps : le 16 novembre 1941, le premier transport allemand en direction de l’Est emportait 323 juifs déportés vers Litzmannstadt.

Estimez-vous qu’il y a eu une évolution importante au Luxembourg dans l’approche de l’histoire des juifs ?
Ce n’est qu’à partir de la conquête et de l’annexion par la France en 1795 du Duché, qui devient alors le département des forêts, que la nouvelle législation accordant la citoyenneté aux juifs permet à quelques familles de s’installer au Luxembourg. Un personnage venu de Lorraine, Pinhas Godchaux, intelligent et cultivé, a la confiance, l’estime et la considération tant des autorités que de la communauté juive. Son charisme et ses relations vont permettre une rapide amélioration des conditions économiques de la Communauté juive. Quant aux observations portées sur la moralité des personnes, elles sont particulièrement flatteuses (« vit de son commerce en honnête homme », « mérite la confiance publique », etc). Grand rabbin de Luxembourg au 19ème siècle, Samuel Hirsch, promoteur d’une ligne de réforme radicale du judaïsme et qui appartient à une loge maçonnique luxembourgeoise, inaugure une période nouvelle qui va permettre à certains intellectuels, industriels et financiers de nouer au travers de la maçonnerie, des liens constructifs à travers l’Europe. A la même époque, la famille Godchaux va construire à Luxembourg un empire industriel inaugurant des lois sociales favorables aux ouvriers, ce qui va considérablement favoriser l’attitude de la société luxembourgeoise à l’égard des juifs.
Les rabbins qui se sont succédés après la guerre ont contribué de manière importante aux bonnes relations entre Société civile luxembourgeoise et Communauté juive. Il faut citer plus particulièrement Charles Lehrmann, docteur en philosophie et licencié-es lettres, convaincu de la nécessité de faire connaitre à ses contemporains non-juifs ce qu’est le judaïsme, et qui a permis par ses causeries radiophoniques d’apporter un autre regard sur la Communauté juive. A partir de 1958, c’est au Grand Rabbin Emmanuel Bulz qu’incombe la charge pastorale à la tête de la Communauté juive de Luxembourg. Prodigieusement cultivé, grand résistant durant la guerre, Emmanuel Bulz concentre ses efforts sur le dialogue judéo-chrétien. Ses discours, ses conférences et ses émissions radiophoniques sur des sujets très divers lui valent le respect et l’admiration de larges couches de la population luxembourgeoise. L’engagement du Dr Bulz en faveur d’une plus grande fraternité, son travail pour le dialogue inter-religieux sont encore très présents dans la mémoire luxembourgeoise et rejaillissent sur la communauté juive.

Comment fut prise la décision de reconstruire les synagogues de Luxembourg et d’Esch ?
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Communauté juive de Luxembourg est exsangue : un tiers de sa population au 10 mai 1940 a disparu dans la tourmente. Pour ceux qui, cachés quelque part en Europe ont survécu, pour d’autres ayant émigré au-delà des mers et qui reviennent au pays, la préoccupation essentielle, dans un pays dévasté par la guerre où se règlent les comptes entre patriotes et collaborateurs du régime nazi, est de reconstruire une vie familiale et professionnelle, de retrouver ses marques.
Les synagogues de Luxembourg et d’Esch ayant été détruites par les nazis, un Consistoire rapidement constitué avec à sa tête M. Edmond Marx, vice-Président du Consistoire d’avant-guerre, s’attelle à la tâche de retrouver un Centre religieux. L’Etat est prêt à apporter son aide, mais au vu des destructions l’on est dans l’urgence et le projet religieux n’est pas prioritaire. Les négociations portant sur un nouvel emplacement, l’établissement des plans et le financement vont durer 8 ans. Durant cette période transitoire, une salle permettant d’exercer le culte avait été louée dans le bâtiment de la Bourse. La synagogue, résolument moderne et conçue pour servir également de Centre Administratif fut inaugurée le 28 juin 1953.
A Esch-sur-Alzette, c’est également dans un style très moderne, ornée de superbes vitraux, qu’avec l’aide financière de l’Etat, de la commune et de l’Office des dommages de guerre a été reconstruite la synagogue inaugurée le 17 octobre 1954.
Pouvez-vous nous parler de votre projet concernant le patrimoine culturel juif en association avec le Ministère de la Culture luxembourgeois dans la zone UNESCO ?
Depuis 1994 déjà, la forteresse de la Ville de Luxembourg et ses vieux quartiers font partie du patrimoine culturel de l’UNESCO. En collaboration avec le Consistoire israélite, un projet d’itinéraire du patrimoine juif devrait prochainement mettre en valeur le passé historique de la communauté juive, parler des entreprises juives, et de l’impact social de cette communauté. Le but visé de la promenade sera de montrer que l’histoire de la communauté juive fait partie intégrante de celle du pays et représente un élément important du patrimoine mondial de l’UNESCO. Les visites se proposent de rappeler à quel point la présence juive représente un enrichissement culturel et entrepreneurial pour la société.
Des personnalités célèbres issues de la Communauté juive, des magasins, des monuments, des lieux commémoratifs seront évoqués lors de cette visite guidée par l’application Izi travel en français, allemand, néerlandais, anglais et luxembourgeois. Le monument « Kaddish » réalisé par l’artiste franco-israélien Shelomo Selinger, constituera l’un des points forts de cette visite.

Si les juifs ont vécu en Albanie pendant des siècles, il reste peu de traces physique de leur présence à Berat, Sarande, Tirana et Vlore. Une bonne raison de visiter l’Albanie serait peut-être cependant de rendre un hommage au besa, le code de l’honneur et de l’hospitalité albanais. Grâce à cette pratique, musulmans et chrétiens ont risqué leur vie pendant la Seconde Guerre mondiale pour sauver la population juive locale, ainsi que des centaines de réfugiés venus de pays voisins.
Les juifs des Balkans étaient liés par des attaches familiales et commerciales. Ainsi, les juifs albanais étaient particulièrement proches des communauté de Corfou et de Ioannina.
Selon l’historien albanais Apostol Kotani, les juifs seraient arrivés en Albanie vers 70 de notre ère. Des sources mentionnent des navires romains avec à leurs bords des prisonniers juifs qui auraient échoués en Albanie après le naufrage de leurs bateaux. Les descendants de ces captifs sont peut-être ceux qui ont construit une synagogue dans la ville portuaire de Sarande, au sud du pays, au Ve siècle.
D’autres témoignages signalent un petit groupe de marchands juifs vivant dans la ville de Durrës, point important de la route commerciale entre Rome et Istanbul.
Développement des communautés juives d’Albanie
Aux XVe et XVIe siècles, la communauté juive représente un tiers de la population de Vlore, alors capitale administrative et commerciale du pays.Les juifs de Vlore venaient de France, de Corfou, d’Espagne, ou encore de Naples. Ils exportaient du textile et du cuir.
Au XVIIe siècle, Vlore perd de son importance au profit de Berat où des fidèles de Sabbatai Zeevi s’installèrent.
Enfin, au XIXe siècle, une importante communauté venue de Grèce s’installe en Albanie. Le même phénomène se reproduit après que le pays devient une monarchie en 1928. Le recensement de 1930 mentionne 204 juifs.
Notons qu’en 1935, la tolérance et tranquillité du pays en font un candidat potentiel pour l’établissement d’un foyer juif.
Sauvetage des juifs pendant la Shoah
Après l’arrivée de Hitler au pouvoir, des juifs d’Allemagne, d’Autriche, de Tchécoslovaquie, ou encore de Pologne trouvent refuge en Albanie. L’ambassade albanaise à Berlin délivra des visas à tous les juifs qui en faisait la demande, quand plus aucun pays ne s’y risquait -rappelons qu’Albert Einstein a fui l’Allemagne en 1935 avec des papiers albanais. Ainsi commença un remarquable sauvetage, tant au niveau de l’État -sur ordre du roi Zog- qui refusa de donner aux autorités allemandes ses liste de recensement ; qu’au niveau de sa population à majorité musulmane qui cacha la communauté juive au péril de sa vie. Seule une famille fut déportée. L’Albanie a donc non seulement sauvée 200 juifs locaux, mais également 2000 juifs étrangers réfugiés. L’Albanie est ainsi le seul pays à avoir décuplé sa population juive entre 1939 et 1945. À ce jour, 69 albanais ont été élevés au rang de Justes parmi les Nations.
Pour en savoir plus sur cette aspect peu connu de la Seconde Guerre mondiale, il est recommandé de visionner le documentaire américain Besa la Promesse donc vous trouverez ici la bande-annonce en anglais.
Après la fin de la guerre, 180 juifs vivaient en Albanie. Quand les frontières s’ouvrirent en 1991, la majorité quitta le pays pour Israël. Il y aurait en 2021 entre 50 et 200 juifs présents en Albanie.
A cheval entre l’Europe et l’Asie, la Géorgie, située entre les rives orientales de la mer Noire et les hautes montagnes du Caucase est un pays de cocagne, riche d’une nature exceptionnelle et d’un patrimoine historique abondant et très bien conservé, vanté aussi bien par Pouchkine qu’Alexandre Dumas, ou Lermontov.

La nation géorgienne, dont la genèse remonterait au royaume de Colchide, évoqué dans les mythes de la Toison d’Or et de Prométhée, connait un premier mouvement d’unification lorsqu’au IVème siècle, elle prend pour religion, comme l’Arménie voisine, le christianisme.
Fédéré au XIème siècle sous le règne du roi Bagrat III d’Abkhazie, le royaume de Géorgie rentre alors dans une longue période d’instabilité autant liée aux divisions intérieures qu’aux pressions des voisins et envahisseurs byzantins, mongols, arabes, perses et ottomans.
Annexée à la Perse par l’Empire russe au début du dix-neuvième siècle, dans le contexte de l’avancée de Saint-Pétersbourg dans le Caucase, la République de Géorgie connaitra une éphémère indépendance entre 1918-1921, avant d’être intégrée à l’Union soviétique, comme les deux autres pays du Caucase du sud.

Tbilissi retrouve son indépendance en 1991. Après une décennie 1990 particulièrement sombre, notamment marquée par la guerre civile, la Géorgie s’est engagée depuis le début des années 2000 dans une dynamique d’ouverture internationale et de modernisation, devenant ainsi l’un des pays les plus accueillants de la région.
L’histoire des Juifs géorgiens est au moins aussi ancienne que l’histoire de la Géorgie elle-même. Leur présence dans la zone fait écho à plusieurs récits bibliques. Selon le premier, les Juifs géorgiens auraient pour ancêtres les membres des 10 tribus perdues d’Israël, exilées depuis Jérusalem dans d’autres régions d’Assyrie par le roi Salmanasar aux environs du huitième siècle avant Jésus-Christ.

Selon la seconde version de cette histoire, ils seraient des descendants des habitants du royaume de Judas, qui furent exilés par Nabuchodonosor II à suite de la prise de Jérusalem en 597. Cette version expliquerait d’ailleurs pourquoi les Juifs géorgiens se nomment « guriyim », un terme qui signifie lionceau en hébreu, soit l’emblème de la tribu de Judas, descendante de Jacob.
Enfin, la région du Caucase, et notamment le territoire de l’actuelle Géorgie, aurait également accueilli des populations juives exilées de Jérusalem après la seconde destruction du Temple par les Romains en l’an 70.Parallèlement aux récits bibliques, la présence de Juifs dans le territoire de l’actuelle Géorgie est mentionnée dans la première histoire de l’Arménie, écrite par Moise de Khorène aux alentours du cinquième siècle de notre ère. Selon l’historien, plusieurs rois de Géorgie et d’Arménie, notamment ceux issus de la famille Bagrat, étaient d’origine juive, voir descendraient du roi David. Pour leur part, les Chroniques géorgiennes, écrites entre le neuvième et le quatorzième siècle, relatent que le peuple géorgien vénérait déjà le peuple d’Israël lors de la traversée de la mer Rouge par Moïse.

Développant au cours des siècles leur propre dialecte, le kivrouli, les Juifs géorgiens exercent essentiellement des activités agricoles, ce qui explique notamment la présence de foyers de peuplement sur l’ensemble du territoire, et non seulement dans les grands centres urbains. L’histoire du judaïsme en Géorgie connait un important tournant au début du dix-neuvième siècle, lorsque selon les termes du traité du Golestan, signé en 1813 entre Saint-Pétersbourg et Téhéran, la Géorgie est intégrée à l’Empire russe. Parallèlement aux Juifs orientaux, autochtones, un certain nombre d’ashkénazes venus d’autres endroits de l’Empire russe vont progressivement s’installer en Géorgie : cette région de l’Empire russe compte environ 20 000 Juifs dans les années 1860.
Ceci explique pourquoi, encore aujourd’hui, une distinction est établie entre les synagogues de rite géorgien et celles de rite ashkénaze. C’est l’essor du mouvement sioniste en Russie qui permettra, à la fin du dix-neuvième siècle, le développement des contacts, jusque-là limités, entre les deux communautés. La Géorgie est intégrée à l’Union soviétique naissante en 1921 et comme dans le reste de l’URSS, les citoyens juifs y bénéficient d’une certaine liberté de culte jusqu’au tournant des années 1930, à partir duquel une importante répression dans la sphère religieuse est entamée. On soulignera que pour un ensemble de raisons, cette répression se fit moins sentir en Géorgie, où les Juifs purent maintenir un certain nombre d’activités religieuses.

Dans l’ensemble moins assimilés que la plupart des autres Juifs d’Union soviétique, les Juifs géorgiens bénéficieront en priorité des autorisations à émigrer en Israël : leur alyah commence au début des années 1970, après qu’un groupe de Juifs géorgiens a envoyé, en 1969, une demande d’assistance à l’ONU, qui eut alors un retentissement international. Cette émigration fait notamment l’objet d’une scène culte du film soviétique géorgien Mimino (1977), où le personnage principal cherche à appeler la ville géorgienne de Telavi, mais est mis, à la suite d’une erreur de l’opératrice, en relation avec Tel-Aviv. Par hasard, un juif géorgien, lui répond. Il s’ensuit un long dialogue entrecoupé de chansons traditionnelles géorgiennes entre les deux personnages. Cette scène restera pendant longtemps la seule évocation, sur une note comique, de l’émigration des Juifs soviétiques en Israël.

Aujourd’hui, la communauté juive de Géorgie, qui s’élève à environ 5 000 personnes, est essentiellement concentrée à Tbilissi, Kutaïssi, ainsi qu’à Batoumi, sur les rives de la mer Noire. Dynamique, cette communauté profite également du succès de la Géorgie auprès des touristes israéliens, dont l’afflux grandissant, environ 60 000 par an, contribue depuis plusieurs années à un véritable renouveau de la vie juive locale.
Enclavée entre la Roumanie et l’Ukraine, la Moldavie a connu une histoire mouvementée au cours des deux derniers siècles. Suite au traité de Bucarest de 1812 mettant fin au conflit qui l’opposait à Constantinople, Saint-Pétersbourg annexe la partie orientale de la principauté de Moldavie, sous suzeraineté ottomane, et la nomme Bessarabie.

La Bessarabie, alors très majoritairement composée de Moldaves roumanophones, devient ainsi un territoire de l’Empire russe qui demeure à l’écart du processus de création de la Roumanie moderne, consacré en 1859 par l’union des principautés de Valachie et de Moldavie. En 1917, dans le contexte de l’effondrement de l’Empire russe et de la Révolution soviétique, Bucarest revendique ses droits sur les provinces roumanophones de Bucovine et de Bessarabie, qui sont ainsi rattachées à la Grande Roumanie en 1918.
En 1939, suite au pacte Molotov-Ribbentrop, l’Union soviétique, qui n’avait jamais accepté la perte de la Bessarabie, récupère ce territoire qu’elle conserve jusqu’au déclenchement de l’opération Barbarossa et l’arrivée des troupes roumaines dans la région. En 1944, l’URSS reprend le contrôle de la Bessarabie. La partie de cette région ayant accès au littoral de la mer Noire est transférée à la République socialiste soviétique d’Ukraine, et le reste de la Bessarabie devient la République socialiste soviétique de Moldavie, l’une des 15 républiques composant l’Union soviétique. En 1991, la Moldavie soviétique prend son indépendance et devient la République de Moldavie actuelle. Petit pays de collines résolument hors des sentiers battus, la Moldavie dispose d’une riche histoire juive, celle du judaïsme bessarabien, dont Meir Dizengoff, Dina Vierny ou encore Robert Badinter figurent parmi les enfants les plus illustres.

Les premières traces de peuplement juif remonteraient au 1er siècle après J.-C., au moment de la conquête par l’Empire romain de la Dacie, région historique correspondant aux territoires actuels de la Roumanie et de la Moldavie. Toutefois, c’est surtout à partir du 15ème et du 16ème siècle que la présence juive va se constituer de manière plus structurante dans la région. Elle sert effectivement de point de passage entre Constantinople et la ville de Lvov, alors en Pologne, et des commerçants juifs de la Sublime Porte installent progressivement des comptoirs en Bessarabie, développant ainsi les premières communautés dans la région.
Le judaïsme de Bessarabie est marqué par d’importants développements après l’annexion de cette région par la Russie en 1812. A cette date, la Bessarabie abrite une communauté juive d’environ 20 000 personnes, soit environ 5% du total de la population, et cette proportion connait une croissance très rapide au cours du 19ème siècle. Tout d’abord, la Bessarabie est incluse dans la « Zone de résidence », ce territoire établi par Catherine II en 1792 à l’ouest de l’Empire russe et dans lequel les Juifs avaient droit de cité. En second lieu, Saint-Pétersbourg mène une politique visant à favoriser le peuplement de la Bessarabie par des colons venus du reste de l’Empire russe, afin de favoriser son intégration à ce dernier et de faciliter son développement économique. Des mesures incitatives sont mises en œuvre : exemption de taxes, d’impôts et de service militaire pour les nouveaux arrivants, absence de servage, aides à la création de communautés agricoles. De plus, la Bessarabie, située aux confins de l’Empire russe, demeure encore au 19ème siècle relativement épargnée par les vagues d’antisémitisme frappant déjà l’empire des Tsars.
C’est dans ce contexte qu’un certain nombre de Juifs venus d’autres régions de la Zone de résidence s’installent en Bessarabie. Dans un mouvement plus général de migration des Juifs du Nord de la Russie (Lituanie, Ukraine, Russie Blanche) vers le Sud récemment conquis (en plus de la Bessarabie, région d’Odessa, et plus à l’ouest de Nikolaïev et de Kherson). La population juive de Bessarabie représente ainsi 80 000 personnes au cours des années 1850 puis plus de 230 000 au début du 20ème siècle, pour une population globale qui a elle aussi augmenté, puisqu’elle atteint les 1 500 000 en 1897. Outre l’attractivité économique d’une région à développer, la situation des Juifs y était comparativement meilleure que dans le reste de l’Empire russe.

Jusqu’aux années 1840, par exemple, aucune restriction ne frappait la communauté juive en termes de droit foncier, de possibilité de tenir des débits de boissons ou encore de s’installer dans des zones situées à proximité des frontières de l’Empire. Ceci explique l’émergence de l’un des particularismes du judaïsme bessarabien : sa forte dimension rurale, attestée par l’existence d’une vingtaine de colonies agricoles juives en Bessarabie au milieu du 19ème siècle.
L’adoption d’un décret impérial en 1882 interdisant aux Juifs de tout l’Empire d’exercer une activité rurale entraîne un reflux de la population juive de Bessarabie vers les centres urbains, Akkermann, Orhei, et surtout Kishinev, la capitale de la province, dont plus d’un habitant sur deux est, au début du 20ème siècle, de confession juive. Vivant jusque-là en bonne entente avec les autres peuples de Bessarabie, Moldaves, Russes, Ukrainiens, Arméniens, Gitans, Allemands, la communauté juive de Bessarabie fera l’amère expérience de son premier pogrom en avril 1903. Le pogrom de Kishinev, déclenché suite à la découverte du corps d’un jeune garçon russe qui aurait été, selon les thèses antisémites de crimes rituels, « assassiné par des Juifs cherchant à récupérer son sang pour préparer des matzot », occasionne une cinquantaine de morts et plusieurs centaines de blessés. Le poète Haim Bialik, mandaté par la Commission historique de la communauté juive d’Odessa, sa ville natale, pour enquêter sur le drame, tirera de son passage à Kishinev un long poème, « La ville du massacre » dont voici ici quelques-uns un des vers les plus émouvants :
Tu cours ? Tu fuis vers l’air et la lumière ?
Tu peux fuir, tu peux fuir, le ciel se rit de toi
Et les dards du soleil te crèveront les yeux,
Les acacias fraîchement parés de verdure
Par la senteur des floraisons et du sang t’envenimeront
Et feront pleuvoir sur ton front des plumes et des fleurs,
Dans la rue des débris de verre aux milliers de miroitements
Devant toi danseront leur horrible merveille,
Car de ses douces mains Dieu te fit ce double présent :
Un massacre avec un printemps.
Haim Bialik,« La ville du massacre », traduction de Rachel Ertel, Anthologie de la poésie yiddish, Gallimard, 2000.
La portée du pogrom de Kishinev fut considérable et c’est ce drame qui permit pour la première fois d’attirer l’attention internationale sur la situation des Juifs de Russie. En France, Jean Jaurès prendra l’exemple du pogrom de Kishinev pour critiquer la politique de rapprochement avec Saint-Petersbourg alors mise en œuvre par le gouvernement Combes. Les évènements de Kishinev jouèrent également un rôle crucial dans le développement de certains courants du mouvement sioniste, notamment celui structuré autour de Vladimir Jabotinsky, dont la traduction en russe du poème de Bialik eut un immense succès. Le pogrom de Kishinev joua également un rôle majeur dans la prise de conscience des communautés juives d’Europe de la nécessité de se défendre, en témoigne le développement de nombreuses ligues de défense juive après ce massacre. Il suscita, dès 1904, une importante vague de départ vers Eretz Israel, connue dans l’histoire du sionisme comme la seconde aliya.

Avec l’intégration de la Bessarabie à la Grande Roumanie en 1918, les Juifs, comme l’ensemble des habitants de la région, deviennent citoyens roumains mais sont globalement considérés comme suspects aux yeux des autorités de Bucarest. Lesquelles voient chez eux, comme chez les autres minorités de Bessarabie, des « agents potentiels de Moscou », en tout cas des citoyens dont la fidélité à leur nouvelle patrie serait douteuse. Cette tendance se dégrade avec le développement de l’antisémitisme d’État en Roumanie au cours des années 1930, qui atteint son apogée avec l’arrivée au pouvoir du maréchal Antonescu en 1940. C’est dès le déclenchement de l’opération Barbarossa que la Shoah commence pour les Juifs de Bessarabie. Après une phase initiale – au cours de l’été 1941 – de violences extrêmes, exécutions massives par balles, noyades, famines imposées, au cours de laquelle plus de 100 000 personnes perdent la vie, la plupart des Juifs demeurés en Bessarabie furent parqués dans les ghettos de Transnistrie, région d’Ukraine située entre les fleuves Dniestr et Bug et occupée par les Roumains jusqu’en 1944 avec des coreligionnaires venus de Bucovine et du reste de la Roumanie. On estime à environ 380 000 le nombre de victimes roumaines de la Shoah, dont une majorité vivait en Bucovine et en Bessarabie.
Au sortir de la guerre, cette région redevient soviétique et la plupart des Juifs qui l’avaient fuie pendant la guerre s’y réinstallent. Au cours des années 1970, la communauté juive de Moldavie soviétique représente environ 100 000 personnes. Lorsque les Juifs soviétiques commencent à être autorisés d’émigrer en Israël, plusieurs dizaines de milliers d’entre eux font leur alya, l’un des plus célèbres étant Avidgor Liebermann, né en 1958 à Chisinau. L’alya des Juifs de Moldavie s’accélère après l’indépendance de 1991, essentiellement pour des raisons économiques.
La communauté juive de Moldavie représente actuellement, dans son acception la plus large, environ 10 000 personnes, vivant pour la plupart à Chisinau. Après deux décennies difficiles, un renouveau juif est actuellement à l’œuvre en Moldavie, structuré, sur le plan spirituel, par la communauté Habad et sur le plan culturel par le centre communautaire de Chisinau. En outre, des sites historiques, jusque-là négligés par les autorités, semblent désormais faire l’objet d’un certain regain d’intérêt.
Si les juifs écossais n’ont pas subi le même sort que les juifs anglais avec l’expulsion de 1290, c’est principalement car il n’y avait quasiment aucun juif avant cette date dans le pays. Des documents administratifs permettent de noter la présence de juifs à Édimbourg à la fin du 17e siècle.
Édimbourg, puis Glasgow, furent les premières communautés juives écossaises. Principalement par l’accès aux universités, lorsque des étudiants obtinrent le droit à la fin du 18e siècle d’y étudier. Ces étudiants s’installèrent ensuite de manière pérenne dans les villes.

La première synagogue fut construite à Glasgow en 1823. Elle fut installée dans un appartement de manière transitoire. À la fin du 19e siècle, la synagogue de Garneth Hill fut construite.
L’arrivée de juifs d’Europe de l’Est à l’époque des pogroms qui se déroulaient dans leurs pays d’origine, favorisa plus Glasgow qu’Édimbourg. Cette dernière fut marquée à l’époque par le représentant de la communauté juive Salis Daiches, issu d’une grande lignée de rabbins originaires de Lituanie. Il réunifia la communauté et fut son porte-parole dans la période compliquée de l’entre-deux-guerres. La synagogue construite en 1932 sur Salisbury Road a été créée en son hommage.

En 1971, on recensa la présence de 15 000 juifs écossais. L’immense majorité habita à Glasgow (13 400 personnes) et le reste à Édimbourg (1 400), Dundee (84), Ayr (68), Aberdeen (40) et Inverness (12). Quarante ans plus tard, le nombre de juifs écossais chuta drastiquement : 5 887, ce qui représente moins d’un pour cent de la population. Parmi eux, 4224 habitaient Glasgow, 763 à Édimbourg, 30 à Aberdeen et 22 à Dundee.
Jusqu’en 1066, on ne trouve pas trace de communautés juives organisées dans les îles britanniques. C’est le roi normand Guillaume le Conquérant qui, lors de son invasion de l’Angleterre, encourage les juifs (marchands et artisans principalement) à le suivre. Ceux-ci, venant surtout de France (Rouen), mais aussi d’Allemagne, d’Italie et d’Espagne, s’installent à Londres ainsi qu’à York, Bristol et Canterbury. Bien considérés par les rois normands, leur fonction réside avant tout dans les affaires d’argent: usuriers, ils tiennent les finances du royaume et, lourdement imposés, ils représentent une source de revenus non négligeable.

La situation difficile des juifs au Moyen-Age
Les sentiments antisémites s’expriment dès 1144, avec la première accusation de sacrifices humains, et connaissent un point culminant avec le massacre de York en 1190 avant de franchir une nouvelle étape : en 1217, les juifs sont contraints de porter un signe jaune distinctif. Le processus aboutit logiquement au décret d’expulsion d’Edouard Ier en 1290. Mais, si l’Angleterre est le premier pays à avoir expulsé les juifs, ils n’en furent jamais totalement absents. En effet, il existait à Londres une domus conversorum, une « maison des juifs convertis », située sur le site de l’actuelle Chancery Lane Library, et les juifs, des marranes pour la plupart, pratiquaient leur religion en secret.

Retour des juifs sous Cromwell
La république de Cromwell, en 1649, dresse les fondations d’un véritable retour grâce à l’entremise d’un rabbin d’origine portugaise : Menasseh ben Israel, qui appartenait à la communauté d’Amsterdam. Sous Guillaume d’Orange (1650-1702), arrivent de nombreux descendants des victimes de l’expulsion de la péninsule Ibérique par les Rois Catholiques. Et, à la fin du XVIIe siècle, la pratique du judaïsme est légalisée par l’Act for Supressing Blasphemy (« Acte de suppression du blasphème »). Conséquence de cette légalisation, on construit à Londres la synagogue de Bevis Marks, l’un des joyaux du patrimoine juif de la ville, encore en service aujourd’hui.

À partir de 1750, les immigrants viennent en majorité d’Europe centrale et ils s’implantent plus au nord que leurs prédécesseurs méridionaux, vers Birmingham, Manchester et Liverpool, avec les industries naissantes du coton et de la laine.
Une nouvelle vague d’immigrants juifs débarque sur les rives britanniques à partir de 1881, chassés cette fois par l’antisémitisme russe. En 1882, 46 000 juifs vivent déjà en Angleterre.
Développement du judaïsme anglais au 19e siècle
On citera, pour illustration : l’anoblissement de Moses Montefiore (1784-1885) par la reine Victoria dès la première année de son règne en 1837 ; la fondation du Jewish Chronicle en 1841, qui demeure aujourd’hui encore l’un des journaux juifs les plus vivaces; et surtout Benjamin Disraeli qui occupe à deux reprises le poste de premier Ministre (1867-1868 et 1874-1880). On peut en conclure qu’en 1890 l’émancipation est totale, ce qui explique aussi une forte attirance des juifs pour ce pays. Pas moins de 120 000 personnes émigrent ainsi entre 1880 et 1914 et la communauté compte, à la veille du premier conflit mondial, près de 250 000 personnes.

Mais la Grande Guerre donne naissance à un sentiment antisémite provoquant un net ralentissement de l’immigration. Cette dernière reprendra dans les années 1930, avec l’arrivée d’environ 100 000 juifs allemands et centre-européens qui apportent un savoir économique et culturel. Le gouvernement britannique se déclare favorable à « l’établissement en Palestine d’un foyer national pour le peuple juif » (Déclaration Balfour du 2 novembre 1917). Sous mandat anglais à partir de 1922, la Palestine aura à souffrir de nombreux heurts entre populations autochtones et juifs.
Ainsi, pour préserver les relations avec les États arabes, en 1939, alors même que le nazisme s’abat sur l’Europe, la Grande-Bretagne publie un White Paper limitant l’immigration juive en Palestine à 15 000 personnes par an pendant les cinq ans à venir. La situation ne fait que se compliquer lorsqu’en 1945, les rescapés du nazisme, en route pour la Terre promise, se retrouvent à nouveau parqués dans les camps de Chypre, anglais cette fois. Toutefois, la Grande-Bretagne n’ayant pas connu l’occupation des puissances de l’Axe, on ne compte guère de déportations.

La communauté juive connaît son apogée vers la fin des années 1960, avec plus de 400 000 représentants sur le territoire. Ils ne sont plus aujourd’hui que 350 000 – dont les deux tiers résident à Londres – formant tout de même l’une des plus importantes communautés du monde.
Terre slave sous influence germanique des siècles durant, la Slovénie est indépendante depuis 1991. Le sort des juifs y fut longtemps dépendant du bon vouloir des princes.

Pourtant, leur présence est attestée depuis l’Antiquité. Des fouilles archéologiques ont mis au jour une tombe gravée d’une menorah, sur le site de Skocjan, qui date probablement du Ve siècle de notre ère. On perd ensuite leur trace sur le territoire, jusqu’au XIIe siècle, pour lequel on dispose de documents signalant l’arrivée d’immigrants en provenance d’Europe centrale et d’Italie. On sait aussi qu’une communauté prospéra en Styrie, où des juifs possédaient des vignes et des moulins. Dans une dizaine de villes ou de localités, dont Maribor, Piran et Ljubljana, l’actuelle capitale, vivaient à cette époque des minorités juives, habitant dans des ghettos où elles menaient une vie communautaire et religieuse organisée.
À la fin du XVe siècle, toutefois, les Habsbourg ordonnent leur départ de Styrie et de Carinthie d’abord, puis de Ljubljana, confinant les juifs en milieu rural, avant que l’empereur Charles VI ne décide une expulsion complète en 1718. À la fin du XVIIIe siècle, de petites communautés se sont cependant installées dans l’extrême nord-est du pays, alors sous domination hongroise : elles connurent un certain épanouissement dans les localités de Murska Sobota, Beltinci et Lendava.
Le bref intermède des provinces illyriennes sous domination napoléonienne, de 1808 à 1814, ne suffit pas à décider un grand nombre de juifs à revenir. D’ailleurs, en 1817, les Habsbourg interdisent de nouveau leur installation en Carniole, la partie centrale de la Slovénie actuelle. L’émancipation complète des juifs de l’Empire austro-hongrois, en 1867, n’a pas de conséquence en Slovénie, tant la région connaît un antisémitisme virulent, qui dissuade tout retour massif.
En 1940, la Slovénie actuelle comptait une communauté de 1 500 personnes. L’Allemagne annexa la région directement au Reich, et fit périr plus de 90 % de ses juifs, une minorité seulement parvenant à fuir en territoire italien ou dans les maquis de la Résistance. Aujourd’hui, la communauté juive de Slovénie compte moins de 100 personnes.

Le Rabbin Ariel Haddad, habitant à Trieste, la ville italienne proche de la frontière slovène, effectue chaque semaine, depuis 2002, une tournée dans le pays pour aider à la reconstruction de la vie juive slovène qui ne compte que quelques centaines de membre au sein de ses communautés sur une totalité de deux millions d’habitants dans le pays. Un nombre qui ne fut d’ailleurs jamais très élevé, atteignant un peu moins de 1 000 juifs slovènes en 1921.
Le 6 août 2018, le pays organisa une cérémonie marquant le retour officiel de la vie juive en Slovénie. La pose de 23 pierres du souvenir commémorant les victimes de la Shoah. L’artiste allemand Gunter Demnig, à l’origine du projet des pierres du souvenir débuté en 1992 fut présent à la cérémonie. Signe de l’importance de l’événement au niveau national, la cérémonie fut menée par le président Borut Pahor et le chef du Parlement Matej Tonin qui déposèrent les deux premières pierres. 587 juifs slovènes périrent pendant la Shoah. Le président rappela les horreurs de la Shoah et mit en garde contre la résurgence des haines antisémites.
En Yougoslavie, l’entreprise d’extermination des juifs commence dès 1941, c’est-à-dire quelques semaines avant l’attaque par Hitler de l’Union soviétique. Les forces en présence jouant sur les nombreuses divisions régionales, culturelles et religieuses depuis les guerres des Balkans et la Première Guerre mondiale et leurs répercussions.

Dans les zones directement administrées par l’armée allemande, il faut moins de quatre mois aux Einsatzgruppen SS, assistés par des bandes de Volksdeutschen locaux (« Allemands de souche ») pour arrêter les 4 000 juifs du Banat (région au nord de Belgrade), et les déporter à Belgrade ; les hommes dans un camp de concentration, les femmes et les enfants dans les logements de la communauté juive de la ville.
Tandis que les hommes sont fusillés par groupe de 50 à 200 dès septembre 1941, les femmes et les enfants du Banat sont, quelques mois plus tard, gazés dans des camions aménagés pour asphyxier leur cargaison humaine avec les gaz d’échappement.

Dans le reste de la Serbie, les juifs connaissent un sort identique dès la fin 1941. Au cours de l’été 1942, un officier SS rapporte à ses supérieurs que la Serbie et le Banat sont désormais judenreinen (« purifiés de toute présence juive »).
C’est, hélas, vrai en grande partie. Sur les 17 000 Juifs habitant la région avant la guerre, à peine plus de 10 % ont survécu.

Dans la Backa et la Baranja, régions à majorité magyarophone de la Voïvodine, rattachées à la Yougoslavie après la Première Guerre mondiale mais annexées en 1941 par la Hongrie alliée de l’Allemagne, les troupes hongroises se « contentent » d’abord de mettre en place tout un cortège de mesures d’exclusion à l’encontre de la minorité juive, forte de 16 000 personnes environ avant la guerre : expropriations, travail forcé, rançons…
On ne peut pourtant pas parler d’extermination systématique, hormis à titre de représailles après des actions de la Résistance. Début 1944, cependant, l’Allemagne envahit la Hongrie et déporta massivement la population juive. Seulement 3 000 reviendront des camps.
Il faut attendre la mort de la très catholique et très antisémite impératrice Marie-Thérèse d’Autriche, et l’avènement de son fils Joseph II, nettement plus tolérant, pour que les juifs soient autorisés à s’installer en Croatie du nord, territoire des Habsbourg depuis alors près de trois siècles.

Auparavant, hormis l’existence probable d’une synagogue à Osijek (ancienne Mursa), et quelques rares mentions dans des documents du XIIe-XVe siècle, la présence de juifs dans la région est assez exceptionnelle. Avant l’édit de tolérance de Joseph II (1781), plusieurs villes, comme Krizevsci, Koprivinica, Bjelovar et Osijek, permettent cependant aux marchands juifs de séjourner pendant les foires, pour trois jours au plus, et moyennant une substantielle taxe de séjour. En 1688 encore, l’armée autrichienne séporte à Osijek, comme esclaves, un demi-millier de juifs de Belgrade, qui vient d’être reprise aux Turcs. Quelques décennies plus tard, les juifs sont autorisés à s’installer de façon temporaire dans certaines villes afin d’assurer un bon approvisionnement des garnisons.

Ce n’est qu’après leur émancipation complète dans l’empire austro-hongrois, en 1867, que la communauté se développe en Hongrie, dont la Croatie du Nord est alors partie intégrante. La Croatie compte ainsi 13 500 juifs dès 1880, puis 20 000, très majoritairement ashkénazes, en 1900. Aux pères qui se sont investis dans les activités industrielles et commerciales, succèdent des fils avocats, médecins et journalistes, dont le croate devient rapidement la langue maternelle pour le plus grand nombre.

Après la Première Guerre mondiale, qui voit le pays entrer dans le giron du royaume de Serbie, l’assimilation se fait plus difficile face à une poussée antisémite, nourrie par l’extrême droite nationaliste locale. Les sionistes prennent le contrôle des principales institutions communautaires, tandis qu’une partie de la jeunesse juive est attirée par le mouvement communiste clandestin.
Lorsque l’Allemagne envahit la Yougoslavie en avril 1941, elle installe à Zagreb un État indépendant, fantoche, sous la présidence du nationaliste fasciste Ante Pavelić. Les Oustachis, supplétifs de l’armée allemande sur l’ensemble du territoire yougoslave, s’attaquent aussitôt à la communauté juive : expropriations, exécutions sommaires et internement dans des camps de concentration (en particulier celui de Jasenovac) se succèdent avant la Solution finale. Au printemps 1943, les camps de concentration croates sont vidés de leurs prisonniers juifs, bientôt exterminés à Auschwitz. L’Église catholique romaine parvient à épargner quelques centaines de juifs mariés à des chrétiens ; d’autres fuient en zone d’occupation italienne, et des centaines d’autres rejoignent les rangs de la Résistance. À la Libération, sur les 25 000 Juifs que comptait la Croatie en 1941, plus des quatre cinquièmes sont morts, la moitié des survivants émigrent en Israël. La communauté juive du pays, toujours active, compte moins de 2 000 personnes, dont la moitié réside à Zagreb.
En 2020, le musée de Yad Vashem a mis en ligne une exposition honorant les efforts individuels de sauvetage des juifs croates.
Sur une miniature médiévale, la tsarine bulgare Sarah figure aux côtés de son époux, le tsar Alexandre, et de ses deux enfants, Shishman et Tamara. Reine juive, Sarah de Trnovo doit se faire chrétienne et adopte le nom de Théodora. Au XIVe siècle, une telle union ne choquait pas à Constantinople – elle eût été inconcevable à Rome.

Des juifs, il en arrive alors sur les bords du Danube depuis plus de 1000 ans, bien avant les Slaves ou les Huns. Datant de l’époque romaine, une stèle, frappée d’une menorah et gravée d’inscriptions latines, a été retrouvée à Nikopol, dans le nord du pays.
La diaspora juive trouve asile dans cette terre de passage et de brassage qu’est la Bulgarie. Chassées du cœur de l’Empire byzantin, des colonies juives y font souche pendant des siècles dans une relative tolérance.
Dans les premiers temps, une compétition s’engage avec le christianisme pour la conversion des Bulgares, encore athées. Le christianisme l’emporte, même si la foi des premiers Bulgares chrétiens est passablement syncrétique, tant du fait de ses emprunts au judaïsme que de la survivance de rites païens.

Vers 860, des émissaires bulgares demandent encore au pape Nicolas Ier s’il faut retenir le samedi ou bien le dimanche comme jour de repos. Les prénoms des premiers princes bulgares, David, Moïse, Aaron ou Samuel, dénotent également une influence juive sur la vie du pays.
Déjà engagés dans des relations commerciales avec des coreligionnaires d’Italie et de Raguse (Dubrovnik), les juifs locaux, encore majoritairement de rite romaniote (byzantin), bénéficient de privilèges royaux, dont celui de détenir la fonction de tortionnaire !
Le rabbin Yaakov ben Eliyahu raconte en 1264 à son cousin apostat, l’Espagnol Pau Christiani, que le bon roi bulgare Ivan Asen II a ordonné à deux juifs de crever les yeux du gouverneur de Salonique, Théodore Ier Angelus, et de venger leur peuple, puisque celui qui est appelé le « diable grec » s’est distingué par sa haine contre les juifs. Mais pris de pitié, les deux commis à l’énucléation refusent. Ivan Asen II les fait alors précipiter du haut d’une montagne.

Fuyant les persécutions d’Europe occidentale, des juifs affluent également par vagues successives au XVe siècle, d’abord de Hongrie, de Bavière, et plus encore d’Espagne, après leur expulsion en 1492 par les rois catholiques Ferdinand et Isabelle.
Passée sous domination turque, la Bulgarie, comme la Grèce voisine, est des plus accueillantes pour les séfarades, les juifs espagnols qui prennent rapidement le pas sur les autres communautés. Plus nombreux, plus cultivés, plus prospères aussi, ils transmettent progressivement au reste de la communauté leur culture, dont l’usage du judezmo. Après le XVe siècle, on n’entend plus parler le yiddish dans les rues de Sofia, résume l’historienne du judaïsme bulgare, Vicki Tamir. Quatre cents ans plus tard, la culture hispanique est toujours vivante chez les juifs de Bulgarie, qui parlent le vieux castillan et cuisinent des plats espagnols qui ornaient la table de Cervantès, au milieu de la mosaïque des autres minorités, Grecs, Turcs, Albanais, Arméniens ou Tziganes.
Un souvenir de Canetti
« Les premières chansons enfantines que j’entendis furent chantées en espagnol, j’ai été bercé par ces anciennes romances ibériques, mais ce qui m’a le plus marqué, ce qui ne pouvait manquer d’impressionner profondément l’enfant, c’est, si je puis dire, une certaine mentalité espagnole. Les autres juifs, on les regardait avec un sentiment de naïve supériorité. »
Elias Canetti, La Langue sauvée, Histoire d’une jeunesse (Vol. 1), Paris, Albin Michel, 1980.
Un rabbi éminent, Ephraïm Caro, exilé de Tolède, s’établit à Nikopol. Son fils Joseph, auteur du Choulkhan Aroukh (1567), un des plus grands traités de codification de la loi juive, prit le chemin de Safed, en Palestine. Dans le vaste Empire ottoman, où ils n’ont guère à souffrir de persécutions, soumis cependant à de lourdes taxations, les juifs se livraient à toutes sortes d’activités commerciales en liaison avec les autres communautés disséminées sur la côte dalmate, dans les Balkans et au Levant.

Le XIXe siècle voit surgir les nationalismes sur la scène balkanique. Les élites juives sont saisies par l’esprit des Lumières et les revendications égalitaires. Quand éclate la guerre russo-turque de 1877-1878, qui débouche sur l’indépendance de la Bulgarie, de nombreux juifs se joignent ainsi au mouvement de libération nationale largement contrôlé par les Russes.
Mais, paradoxalement, l’émergence du nationalisme bulgare est concomitante du développement dans ce pays d’un antisémitisme peu répandu jusqu’alors, le juif étant assimilé à un suppôt de l’ex-occupant turc.
Des massacres et des pillages ont lieu, de la part aussi bien de la soldatesque bulgaro-russe que des bachi-bouzouks turcs : les communautés de Nikopol, Kazanlák, Svishtov, Stara Zaroga et Vidin, dont la toute nouvelle synagogue est détruite par l’artillerie russe, fuient en masse. Des milliers de juifs bulgares se réfugient dans les régions épargnées, ou plus loin encore à Andrinopole et Constantinople.

C’est dans ce contexte que le traité de Berlin de 1878, sanctionnant la défaite turque, fait obligation aux royaumes en formation dans les Balkans, dont la Bulgarie, d’accorder l’égalité complète des droits à leur minorité juive. Cependant, si les juifs sont soumis, comme le reste de leurs concitoyens, à la conscription, ils ne sont pas admis à l’Académie militaire, pas plus que dans le reste de la haute fonction publique.
Les difficultés économiques de la Bulgarie, sortie vaincue de la Première Guerre mondiale (elle a pris le parti des puissances centrales), nourrissent l’antisémitisme local, quand bien même elles touchent aussi les minorités juives.
C’est l’époque où le grand reporter Albert Londres tient en haleine ses lecteurs français avec le récit des exactions des comitadjis, une pègre volontiers antisémite sous couvert de reconquête de l’indépendance de la Macédoine.
Aussi, n’observe-t-on pas en Bulgarie, au cours de cette période, de tendance aussi forte à l’assimilation que dans d’autres pays (Autriche, Allemagne, Hongrie…) où l’antisémitisme a pourtant des racines autrement plus anciennes.

Cela n’empêche pas les jeunes générations d’abandonner le judezmo, au profit du bulgare. Le premier journal juif du pays, Chelovecheski prava, est publié en bulgare, et un autre périodique de la communauté, publié initialement en judezmo, La Alborada (« L’Aurore ») passe lui aussi à la langue nationale. Pourtant, ce n’est sans doute pas un hasard si c’est en Bulgarie que le mouvement sioniste connaît l’un de ses principaux succès, dominant dans l’entre-deux-guerres l’ensemble des institutions communautaires, consistoire compris. Plus de 7 000 juifs bulgares émigrent vers la Palestine avant 1948.
Allié de l’Allemagne nazie, le royaume de Boris III de Bulgarie adopte, dès 1940, une législation antisémite très sévère, privant rapidement les juifs de tout moyen d’existence, par une succession d’interdictions, d’expropriations, et de décrets les obligeant au travail forcé. Cependant, lorsque les services d’Adolf Eichmann exigent la liquidation finale, en 1943, le sort des armes a commencé de s’inverser pour les puissances de l’Axe. La bataille de Stalingrad a marqué un tournant dans la guerre, les alliés sont en Afrique du Nord et la question de l’ouverture d’un front dans les Balkans est posée.

La Bulgarie livre tout de même sans sourciller les 12 000 juifs de ses territoires annexés (Macédoine, Thrace, Pirot en Yougoslavie), mais pas ses propres nationaux, grâce à l’intervention d’une partie de l’intelligentsia et aux hésitations nées au sein de l’appareil d’État, sensible aux avertissements que lui adressent les puissances alliées. Les 50 000 juifs du pays échappent à l’extermination.
Quelques années plus tard, les juifs bulgares, auxquels le nouveau régime n’a pas restitué leurs biens expropriés pendant la guerre, forment l’un des plus gros contingents d’émigrants vers Israël, où plus de 90 % de la communauté s’installe. Depuis 1990, Shalom, la nouvelle organisation des juifs bulgares (ils ne sont plus que 3 500 environ), s’attache à reprendre possession des biens juifs « nationalisés » et à redonner vie à une communauté qui ne dispose plus que d’un seul rabbin.
Au tournant des années 2020, la communauté juive bulgare s’est développée et serait composée de quelques milliers de personnes. La plupart vivant à Sofia et quelques petites communautés à Plovdiv, Varna, Burgas et Ruse.
Shalom est également très actif dans la perpétuation de la mémoire, l’entretien des lieux, la vie associative et culturelle. Il publie le journal Evreiski Vesti, ainsi que des livres et des brochures.
Les deux seules synagogues actives aujourd’hui sont à Sofia et Plovdiv, accueillant les fidèles le shabbath et les jours de fêtes.
À Sarajevo, où vécut la majorité des juifs de Bosnie, les premiers réfugiés de la péninsule ibérique arrivent à partir de 1565, en provenance d’Italie, de Grèce, de Bulgarie et d’autres régions sous domination turque. Faisant partie de la rayah (terme utilisé par les Turcs pour désigner les populations non musulmanes sous leur domination), ils ont à ce titre un statut équivalent à celui des autres non-musulmans de l’Empire ottoman. Une certaine autonomie de gestion pour les affaires religieuses et communautaires se combine avec une série d’exigences et de contraintes, assorties d’exactions répétées de la part des pachas locaux.

Un juif doit, par exemple, céder le pas à tout musulman qu’il croise dans la rue, il n’a pas le droit de monter à cheval ni de porter des armes, sauf à l’occasion de voyages. Tout juif de plus de neuf ans paye une taxe d’habitation et, pendant les dernières décennies de gouvernement turc, c’est-à-dire jusqu’en 1878, les juifs doivent acquitter un impôt spécifique, la bedelija, pour échapper à la conscription. Les juifs sont, en outre, tenus de fournir des chevaux pour les travaux d’entretien des routes et pour l’armée turque quand elle part en campagne.
Les Turcs imposent également des contraintes en matière vestimentaire. En Bosnie, conquise en 1463, le juif a le droit de porter un turban, à condition qu’il ne soit pas trop important et, surtout, qu’il soit jaune, à l’exclusion de toute autre couleur. S’il coiffe le fez, comme ses ancêtres ont pris l’habitude dans l’Espagne arabe, et comme ses descendants continueront de le faire longtemps après le départ des Turcs, il doit impérativement être bleu foncé. De même, l’usage du vert est strictement interdit à tous les non-musulmans, et seules les chaussures de couleur noire sont autorisées.

Cela entraîne, chez les femmes séfarades de la région, le développement d’une culture vestimentaire spécifique, fortement identitaire, dont les musées juifs de l’ex-Yougoslavie conservent la mémoire. Jusqu’au début du XXe siècle, les femmes juives de Bosnie continuent, par exemple, de porter de longues robes brodées, les anteriyas, et surtout le tokado, un petit chapeau orné d’une rangée de ducats, appelé, en judéo-espagnol, la frontera, les jeunes filles se contentent généralement de ne porter qu’un seul ducat au front.
Pour le reste, la vie des juifs de Bosnie sous le règne ottoman a été quelque peu semblable à celle des autres habitants de cette région pauvre et montagneuse de l’Empire, loin des grands axes routiers et commerciaux de l’époque. Si la communauté compte de nombreux médecins et savants, comme le rabbin Judah ben Solomon Hai Alkalai, précurseur du sionisme dès le milieu du XIXe siècle, elle est majoritairement composée de gens de condition modeste, ne vivant pas mieux que les autres populations de la province. Une association caritative, la Benevolencija, est ainsi créée pour venir en aide aux plus démunis, qui sera encore active pendant la récente guerre interethnique de 1992-1995, au bénéfice de toutes les populations du pays.
Loin du pays
C’est le prix Nobel de littérature Ivo Andric qui campe la scène, dans sa Chronique de Travnik (Paris, Belfond, 1997), une petite ville de la Bosnie occidentale, élevée temporairement, au début du XIXe siècle, au rang de capitale de cette province turque.
Par une chaude matinée du mois de mai 1814, Salomon Atijas, le patriarche de la petite communauté juive de la ville, empestant l’ail et la peau de mouton non tannée, vient offrir vingt-cinq ducats au consul de France, qui a reçu l’ordre de fermer la représentation à Travnik, mais n’a pas de quoi financer son voyage de retour. Il le fait, parce que le diplomate, au cours des sept années qu’il vient de passer dans la ville, a su faire preuve à l’égard des juifs d’une humanité et d’une attention « comme ne l’avaient fait ni les Turcs, ni aucun autre étranger ». « Où que nous eussions été hors d’Espagne, nous aurions souffert, car nous aurions toujours eu deux patries, cela je le sais, mais ici, la vie a été trop cruelle et trop humiliante (…). Nous vivons entre les Turcs et la rayah bosniaque, entre la rayah misérable et les Turcs terribles. Complètement coupés des nôtres et de ceux qui nous sont proches, nous nous efforçons de conserver tout ce que nous avons d’espagnol, les chansons, la nourriture et les coutumes, mais nous sentons que tout cela change en nous, se corrompt et tombe dans l’oubli » déclare le vieil Atijas au voyageur qui met cap à l’ouest. De fait, s’ils savent gré à la Turquie de les avoir accueillis après l’expulsion d’Espagne, les juifs arrivés en Bosnie ont, plus que d’autres séfarades, souffert du déracinement, et ils cultiveront au fil des siècles la nostalgie de leur « Andalousie incomparable ».
L’Autriche-Hongrie occupe la Bosnie-Herzégovine en 1878, et l’annexe en 1908. la région va connaître au cours de cette période un développement économique accéléré, notamment sous l’impulsion d’arrivants ashkénazes, qui investissent l’industrie, les professions libérales et intellectuelles. Les séfarades restent dans le commerce et l’artisanat, mais leur niveau culturel s’élève lui aussi considérablement. On raconte ainsi qu’au tournant du siècle, tous les médecins de Sarajevo étaient juifs.
Après la Première Guerre mondiale, à l’issue de laquelle la Bosnie-Herzégovine est intégrée au nouveau royaume de Yougoslavie, la jeunesse juive de Sarajevo et de la province se distingue notamment par son engagement politique. Alors que le mouvement sioniste gagne en influence un peu partout en Yougoslavie, à Sarajevo, c’est une organisation plus radicalement marxiste, la Matatja, qui attire la jeunesse juive locale. Créée en 1923, cette association culturelle et politique possède rapidement un millier de membres.

À la veille de la Seconde Guerre mondiale, la Bosnie-Herzégovine compte 14 000 juifs, dont 8 000 à Sarajevo. Lorsque l’Allemagne envahit la Yougoslavie en avril 1941, elle octroie la Bosnie-Herzégovine à l’État fantoche créé à Zagreb. Comme en Croatie, les juifs de Bosnie-Herzégovine sont pourchassés par les Oustachis, avec le renfort de bandes musulmanes formées par le mufti de Jérusalem, le Palestinien Hadj Amine el Husseini. Cet admirateur de Hitler appuie la formation d’une division SS composée de musulmans, l’Ansar, dont la férocité à l’encontre des Serbes et des juifs n’a rien à envier à celle des Oustachis. Un millier de juifs bosniaques parviennent cependant à gagner les rangs de la Résistance, dont le tiers tombe les armes à la main. Dans les années qui suivent la Libération, la moitié des 2 200 survivants de la région font aliyah en Israël.
C’est pourquoi, avant même la guerre de 1992-1995, la communauté juive de Bosnie-Herzégovine ne comptait déjà plus que 500 personnes environ. Ce nombre s’est encore réduit avec les combats et les transferts de réfugiés. Il y aurait en 2025 un peu moins d’un millier de juifs bosniaques.
Dans la belle synagogue Ahrida, aujourd’hui la plus ancienne d’Istanbul, la tévah a la forme d’une caravelle symbolisant l’arche de Noé mais évoquant aussi ces navires qui, en 1492, transportent sur les terres ottomanes les juifs chassés d’Espagne. Un édit royal, promulgué à Grenade à peine reprise aux Arabes, ne leur donne d’autre choix que la conversion au catholicisme ou le départ. Cinq ans plus tard, les souverains portugais suivent l’exemple de leurs homologues madrilènes. Un millénaire de présence juive dans la péninsule Ibérique est ainsi balayé. Sefarad, le judaïsme espagnol, devenu par sa splendeur le principal centre de gravité de cette culture de la fin du Moyen Âge, est dispersé sur le pourtour du bassin méditerranéen ou plus au nord jusque dans les Provinces-Unies.

Beaucoup de juifs choisissent d’accepter l’hospitalité du sultan Bajazet II, qui « entendit parler de tous les maux que le souverain espagnol faisait subir aux juifs et qui apprit que ceux-ci étaient à la recherche d’un refuge et d’un havre ». Il aurait aussi déclaré : « Pouvez-vous appeler sage et intelligent un tel souverain ? Il appauvrit son pays et enrichit le mien ». Les récits apologétiques de l’historiographie juive, comme la chronique du rabbin Elijah Capsali (XVIe siècle), ne sont pas corroborés par des sources ottomanes. Ils témoignent en tout cas de l’immense reconnaissance des juifs envers la Porte. Ils prospèrent longtemps sous sa protection et restent ses très loyaux sujets jusqu’à la fin de l’Empire.
« À la différence de leurs homologues d’Occident ou d’Afrique du Nord, les séfarades des Balkans submergèrent les communautés autochtones. Ils les judéo-hispanisèrent et, dans des villes comme Istanbul, Andrinolope, Smyrne, Salonique et Sarajevo, une Sefarad (Espagne) transplantée se reconstitua », lit-on dans Juifs des Balkans, espaces judéo-ibériques du XIVe au XXe siècle, important ouvrage sur le judaïsme ottoman.
Cependant, l’actuelle Turquie recèle des traces d’une présence juive antérieure à l’arrivée des expulsés d’Espagne. Les restes d’une antique synagogue, datant du IIIe siècle de notre ère, ont été découverts dans les ruines de Sardes, près d’Izmir. Une colonne de bronze trouvée à Ankara énumère les droits conférés par l’empereur Auguste à des communautés juives d’Asie Mineure. Ces communautés de culture hellénistique, dites romaniotes, étaient notamment implantées dans les grandes villes du littoral égéen.

Elles subsistent sous Byzance malgré de nombreuses persécutions. L’empereur y dispose à la fois de l’autorité politique et de l’autorité religieuse et les discriminations contre les juifs sont rapidement plus fortes que dans le monde occidental. Humiliés, cantonnés à certaines activités , contraints d’habiter dans des quartiers réservés, les juifs n’ont ainsi plus le droit, sous Justinien (527-565), de prononcer dans leurs prières « notre Dieu est le seul Dieu » considéré comme une offense à la sainte Trinité.
En 422, ils ont d’ailleurs été expulsés de la ville par Theodosius II. Apparement, ils ne reviennent dans la capitale qu’au IXe siècle, s’installant sur la rive sud de la Corne d’Or, près de la mer de Marmara et des murs d’enceintes de la cité. L’antisémitisme des autorités byzantines ne s’atténuera jamais. Au début du XIVe siècle, le patriarche Athanasius Ier se lamente encore auprès de l’empereur Andronicus II paléologue de la présence d’une synagogue dans la capitale : « Non seulement les masses sont autorisées à continuer à vivre dans l’ignorance, mais elles sont contaminées par la présence de juifs ».
Toutefois, l’inexorable avancée des Ottomans en Anatolie dès le XIVe siècle, puis dans les Balkans, est accueillie avec enthousiasme par les communautés juives romaniotes. « Elles signifient une libération immédiate non seulement de la sujétion, de la persécution et de l’humiliation, mais même de l’esclavage », écrit Stanford J. Shaw, qui souligne que de nombreux juifs de Bursa, en 1324, aident le sultan Ohran à prendre cette grande ville du Nord-Ouest anatolien qui devient la première capitale ottomane. La réelle tolérance des Ottomans est dictée dès le début par des raisons d’intérêts.
Cette société de guerriers et de paysans, cette machine étatique en formation, laisse les autres secteurs d’activités, notamment le commerce, aux chrétiens ou aux juifs. Comme dans les autres terres d’Islam, ils ont le statut de dhimmi, de protégés, prévu dans le Coran comme la sunna (la « tradition ») pour les représentants des peuples du Livre qui ne peuvent être convertis par la contrainte. La sécurité de leur personne et de leurs biens est garantie, mais ils doivent s’acquitter d’un impôt particulier, la capitation. Ces communautés peuvent s’administrer elles-mêmes pour les affaires intérieures, sous l’autorité de leurs chefs religieux. Ce statut fait cependant des non-musulmans des citoyens de seconde zone, soumis à un certain nombre de discriminations, notamment d’ordre symbolique ; dans le vêtement ou l’architecture des maisons, dans l’interdiction de porter des armes ou de monter des animaux nobles destinés à symboliser la supériorité des vrais croyants.
La dhimma peut être appliquée de façon plus ou moins humiliante. Les sultans ottomans se montrent plutôt ouverts et pragmatiques. De nombreux juifs européens commencent à affluer dès le XIVe siècle, expulsés de Hongrie en 1376 ou de France en 1394. D’autres arrivent de Sicile au début du XVe siècle. La plupart s’installent à Andrinopole, l’actuelle Erdine, alors capitale de l’Empire. « Je vous le dis, la Turquie est un pays d’abondance où si vous le voulez vous trouverez le repos », écrit le rabbin Isaac Zarfati dans une célèbre lettre envoyée à ses coreligionnaires vivant encore dans les terres chrétiennes.

Les autorités ottomanes n’hésitent pas à déplacer par la force les juifs des petites communautés romaniotes pour repeupler en artisans et en commerçants les villes conquises et, en premier lieu, Istanbul après 1453. Les surgün, les déportés, se différencient ainsi des kendi gelen, les gens venus de leur propre volonté, c’est-à-dire les exilés arrivés d’Occident. Cette dernière dénomination reste longtemps en vigueur.
L’arrivée des juifs d’Espagne s’étale sur plusieurs décennies. Certains débarquent directement ; d’autres arrivent sur les terres ottomanes après de longs périples, notamment un passage en Italie. Mais le processus est lancé. Les recensements effectués par les autorités ottomanes en 1520-1530 dénombrent 1647 foyers juifs à Istanbul, soit 10 % de la population de la ville, et 2645 foyers juifs à Salonique sur un total de 4863. Trente ans plus tôt, il n’y avait pas de juifs dans ce grand port des Balkans qui restera jusqu’à la fin de l’Empire la capitale du monde judéo-espagnol.
À Istanbul, les juifs venus de la péninsule ibérique ne deviennent réellement majoritaire dans la communauté locale qu’à partir du XVIIe siècle, mais il y jouent déjà un rôle majeur, forts de leur dynamisme et de leur prestige. Ils peuvent aussi compter sur la bienveillance intéressée des autorités ottomanes. « Du point de vue turc, les juifs, notamment ceux qui venaient d’Europe, présentaient de nombreux avantages (…). Au fait des affaires européennes, mais relativement dégagés des intérêts européens, ils pouvaient se révéler des conseillers efficaces dans les relations que l’Empire ottoman entretenait avec les puissances occidentales. (…) Enfin et surtout, les Ottomans n’avaient a priori aucune raison de les suspecter de trahison ou de coupables sympathies à l’égard de leur principal ennemi, l’Occident chrétien », souligne l’historien Bernard Lewis.
Les juifs ouvrent les premières imprimeries à Istanbul et à Salonique dès le XVe siècle mais les autorités leur interdisent d’utiliser les caractères arabes pour éviter leur profanation et ne pas priver de travail scribes et calligraphes. Ils introduisent le théâtre jusque là totalement ignoré dans l’Empire. Ils apportent des capitaux et de nouvelles techniques pour la navigation ou l’armurerie. Néanmoins, c’est dans le secteur économique que leur contribution s’avère la plus importante. De nombreux juifs jouent un rôle clef dans l’administration des douanes, les finances de l’Empire, la naissance d’une industrie textile ou encore la banque.
Le riche marrane d’origine portugaise Joseph Nassi apporte au sultan son immense fortune et ses talents de gestionnaire. À la fin du règne de Soliman le Magnifique, il s’illustre aussi dans les relations diplomatiques avec la Pologne, l’Italie ou l’Espagne.
Après sa mort en 1579, aucun juif n’occupera plus une charge aussi élevée. Mais deux catégories réussiront à conserver encore une influence importante sur la vie de l’Empire : les médecins juifs de personnages politiques en vue et surtout les intendantes des harems. Pourvoyeuses de bijoux, de vêtements ou de parfums, Esther Handali ou Esperanza Malchi nouent d’étroits liens d’amitié avec les favorites des sultans ou leur toute puissante mère.
Piliers de l’Empire
Au XVIe siècle, les juifs sont un des éléments clés de l’Empire ottoman à son apogée, comme le remarquent, en général pour s’en lamenter, de nombreux chroniqueurs occidentaux, comme ce Michel Febure, cité par Robert Mantran : « Ils sont si adroits et industrieux qu’ils se rendent nécessaires à tout le monde. Il ne se trouvera pas une famille considérable entre les Turcs et les marchands étrangers où il n’y ait un juif à son service soit pour estimer les marchandises et en connaître la bonté, soit pour servir d’interprète ou donner avis sur tout ce qui se passe. Ils savent dire à point nommé et en détail tout ce qu’il y a dans la ville, chez qui chaque chose se trouve, sa qualité et quantité (…). Les autres nationalités orientales comme les Grecs, les Arméniens, etc., n’ont pas ce talent et ne sauraient arriver à leur adresse : ce qui oblige les négociants à se servir d’eux, quelque aversion qu’on leur porte.
Robert Mantran, Istanbul au Temps de Soliman le Magnifique, Paris, Hachette, 1994
La décadence du judaïsme ottoman, dès le XVIIe siècle, accompagne et anticipe celle de l’Empire. L’une des causes de ce phénomène est l’arrêt de l’immigration des juifs européens, qui offraient à l’administration ottomane des contacts avec les monde occidental. Des minoritaires chrétiens, en premier lieu les Grecs et les Arméniens, commencent dès lors à occuper ces fonctions d’intermédiaires entre les deux mondes. La marginalisation et le repli communautaire des juifs sont encore accélérés par la grande crise du faux messie Sabbataï Zevi, qui ébranle profondément le judaïsme de l’Empire ottoman.
Sabbataï Zevi (1626-1678) et les Deunmés
Né à Smyrne (l’actuelle Izmir) en 1626, dans une famille de drapiers originaires du Péloponnèse, kabbaliste exalté, Sabbataï Zevi, convaincu d’être le Messie, entraîna dans la tourmente les communautés juives de l’Empire ottoman. Pour son exégète moderne le plus pénétrant, Gershom Scholem, ce mouvement religieux et insurrectionnel s’est développé sur fond de mysticisme cabalistique, forme dominante de la piété juive de l’époque. Dès l’expulsion d’Espagne, des penseurs juifs s’étaient interrogés sur la signification d’une telle catastrophe, la rapprochant des destructions du Temple de Jérusalem. « Je pense que ces épreuves, dira un rabbin à Rhodes en 1495, sont les douleurs de l’enfantement du Messie. » Ainsi peut-on comprendre l’enthousiasme et les espérances qui suscita le fulgurants mouvement messianique du smyrniote, en dépit de son excommunication par les rabbins de Jérusalem.
En 1665, Sabbataï Zevi décide de partir à Istanbul. Arrêté par les autorités ottomanes, contraint de choisir entre le martyre et la conversion à l’islam, le prétendu Messie choisit de se plier. Certains de ses partisans considèrent cette apostasie comme une étape indispensable à la réalisation de sa mission et se convertissent eux aussi à l’islam, tout en conservant leur foi juive et en pratiquant les rites en secret. Cette communauté des deunmés (« ceux qui se sont tournés ») se replia vers la Turquie, à la fin de l’Empire. Certaines grandes familles deunmées jouent, aujourd’hui encore, un rôle important dans l’édition ou l’industrie. Longtemps cachés, restés discrets durant les soixante-dix premières années de la République laïque fondée par Mustapha Kemal, les deunmés turcs commencent à revendiquer ouvertement leur identité et leur histoire.
Dans les communautés traumatisées et désespérées, les rabbins prennent un énorme pouvoir, obstacle à toute évolution libérale future. Les autorités ottomanes, quant à elles, regardent avec une suspicion croissante cette minorité qui, jusque là, quand l’Empire ottoman entame sa modernisation sous la pression des puissances occidentales, les juifs du Levant sont une minorité appauvrie, souvent méprisée, vivant dans l’obscurantisme, loin des grands débats comme la Haskalah, le réformisme religieux, le sionisme ou la renaissance de l’hébreu. Les voyageurs occidentaux qui parcourent les quartiers juifs d’Istanbul de part et d’autre de la Corne d’Or décrivent une réalité misérable, totalement à l’opposé de ce que pouvait narrer leurs homologues encore deux siècles plus tôt. Les juifs turcs vivent repliés sur eux-mêmes, pour la plupart gagnant leur pain comme boutiquiers, artisans ou employés subalternes. Pire, un antisémitisme, nourri par les minorités chrétiennes, notamment les Grecs, commence à se développer : à Damas, en 1840, surgissent les premières accusations de meurtre rituel.
Des parias
« Je n’ai jamais vu la malédiction prononcée contre les enfants d’Israël peser aussi lourdement sur eux qu’au Levant (…) où on les tient davantage pour une espèce intermédiaire entre les animaux et les êtres humains que pour des hommes dotés des mêmes attributs, réchauffés par le même soleil, rafraîchis par les mêmes brises (…) éprouvant les mêmes joies et les mêmes peines que le reste de l’humanité. Leur expression a quelque chose de soumis et d’éteint qu’un Européen peut difficilement imaginer tant qu’il ne l’a pas vue. Il est impossible de décrire le mépris et la haine dont font preuve les Osmanlis à l’égard du peuple juif. À peine sait-il marcher que le marmot turc qui rencontre un membre de cette nation déchue a sa part d’insultes à ajouter aux malheurs de cette race errante de parias », écrit en 1836, Julia Pardoe dans The City of the Sultan. »
Bernard Lewis, Juifs en Terre d’Islam, Paris, Flammarion, 1999
Le salut vient de l’extérieur. Les capitales occidentales multiplient les pressions sur la Porte pour accélérer des réformes libérales destinées à garantir l’intégrité de l’Empire en même temps que leurs propres intérêts économiques. Les 150 000 juifs qui vivent, au milieu du XIXe siècle, sur le territoire ottoman en sont les bénéficiaires comme les autres minoritaires. En 1856 puis en 1869, des décrets précisant et amplifiant les premières réformes de 1839 garantissent l’égalité de tous les citoyens devant la loi. L’activisme des communautés juives occidentales, atterrées par le sort de leurs coreligionnaires du Levant, contraint peu à peu le judaïsme turc à sortir de sa torpeur. Une petite partie des élites juives joue un rôle essentiel de relais, prenant fait et cause avec les francos, ces juifs d’origine étrangère qui bénéficient des privilèges accordés par les sultans aux ressortissants occidentaux.

Le conflit entre les rabbins conservateurs et la petite élite moderniste se cristallise d’abord sur la nouvelle école ouverte en 1858 sous le parrainage du banquier Abraham de Camondo, « le Rothschild de l’Orient ». Deux ans plus tard un sympathisant des réformateurs, Jacop Avigdor, est élu grand rabbin de l’Empire. Les conservateurs passent à la contre-offensive avec le soutien d’une bonne partie du petit peuple. Des heurts contraignent les autorités à intervenir en 1862. Les traditionalistes reprennent le pouvoir et Abraham de Camondo est excommunié.
Trois ans plus tard, l’administration ottomane fait volte-face, imposant aux communautés juives un statut plus libéral qui limite le pouvoir des rabbins. Mais les résistances demeurent et les francos décident de fonder leur propre communauté dite « italienne ». Cette dernière s’active pour introduire les écoles de l’Alliance israélite universelle, basée à Paris, dans les terres du Levant. Les premières ouvrent à Istanbul en 1870. Le français remplace le judéo-espagnol, d’abord au sein des élites puis, peu à peu, dans le plus grande partie de la population juive de l’Empire. En 1912, toute communauté judéo-espagnole d’au moins 1000 personnes est dotée d’une école de l’Alliance. Cette dernière prend progressivement la place d’institutions communautaires anémiées. Dès 1908, un « allianciste », Haim Nahum, est à la tête du judaïsme d’un empire où triomphe la révolution des Jeunes Turcs qui instaure une monarchie constitutionnelle.
L’un des centres du mouvement est Salonique, la grande ville juive. Les juifs n’y jouent pourtant qu’un rôle marginal. Dans la première assemblée ottomane élue en 1908, il n’y a que quatre juifs. Les guerres balkaniques de 1912-1913 et la conquête de Salonique par la Grèce, puis la Première Guerre mondiale et l’effondrement de l’Empire marquent la fin de ce judaïsme ottoman, désormais éclaté entre plusieurs États-nations hostiles sinon rivaux. La guerre mondiale et la guerre d’indépendance ont décimé les autres minorités. Les Arméniens sont massacrés en masse, notamment en 1915, et les Grecs, chassés dans le cadre du grand transfert de populations qui suit le traité de Lausanne en 1923.
Dans les frontières de la République turque proclamée par Mustapha Kemal, vivent 81 872 juifs (d’après le recensement de 1927), pour la plupart concentrés à Istanbul et à Izmir. Traumatisés par la défaite de 1918 et l’effondrement de l’Empire, les Turcs tentent de se forger une identité nationale spécifique et se méfient des derniers minoritaires. Le nouveau système politique républicain, directement inspiré du modèle jacobin, modifie considérablement les conditions de vie de la communauté juive. La nouvelle République est en outre déterminée à encourager la formation d’une classe moyenne nationale. Les écoles de l’Alliance doivent rompre leurs liens avec « l’étranger ». L’enseignement se fait désormais en turc. La laïcité militante des institutions kémalistes étouffe les dernières écoles communautaires. On rappelle aux juifs qu’ils sont des « invités » et qu’il leur incombe de montrer leur reconnaissance en s’intégrant le plus rapidement possible.
Égaux en droit, ils ne le sont pas dans la réalité. Les charges publiques d’un certain niveau leur restèrent de fait interdites jusqu’aux années 1945-1950. « Cet État-nation autoritaire et non libéral laissa la communauté juive privée d’institutions propres sans pour autant lui permettre une intégration dans les sphères sociales et publiques », remarquent Esther Benbassa et Aron Rodrigue. Cette politique de laminage des minorités culmine pendant la Seconde Guerre mondiale. Certes la Turquie kémaliste accueille, après 1933, un certain nombre d’universitaires juifs allemands chassés par le nazisme. Elle laisse aussi transiter par son territoire les réfugiés munis de visa d’entrée pour la Palestine.
Restée neutre pendant le conflit, elle instaure en 1942 un « impôt exceptionnel » qui, de fait, est conçu pour ruiner la position économique des minoritaires. La population est divisée en quatre groupes (étrangers résidents, non-musulmans, musulmans, deunmés), taxés de façon différente. Les estimations des biens sont le plus souvent totalement arbitraires. En moyenne, cet impôt est de 5 % pour les musulmans et de 150 à 200% pour les Grecs, les Arméniens et les juifs. Beaucoup n’ont pas les moyens de payer, même en bradant leurs avoirs. Ils sont alors condamnés à des travaux obligatoires, enfermés dans des camps au fin fond de l’Anatolie. Cet impôt est finalement aboli en mars 1944. Parmi les juifs turcs, le traumatisme est terrible et prépare le terrain a une massive émigration vers Israël, dès 1948, pour continuer tout au long des années 1950-1960, accentuée à chaque poussée nationaliste, malgré l’instauration du multipartisme et la démocratisation des institutions républicaines.
Il reste aujourd’hui 26 000 juifs en Turquie, pour la plupart à Istanbul. Les bonnes relations entre Ankara et Jérusalem, les deux seules démocraties de la région et toutes les deux fidèles alliées de Washington, permettent à cette communauté, la seule importante encore installée dans un pays musulman, de vivre sans problèmes majeurs. La Turquie pro-occidentale, laïque, musulmane mais non arabe, entourée de voisins hostiles, a d’évidents intérêts stratégiques commun avec l’État d’Israël. Les deux pays ont passé un accord militaire en 1998. Les autorités d’Ankara revendiquent volontiers cet héritage ottoman de l’hospitalité accordée aux juifs. Elles ont célébré en grande pompe le 500e anniversaire de l’accueil des caravelles arrivant d’Espagne. Les derniers juifs de Turquie n’en restent pas moins préoccupés par la montée de l’islamiste radical dans le pays, et craignent d’être la cible d’attentats terroristes comme celui du 6 septembre 1986 à la synagogue Neve Shalom d’Istanbul, qui fit vingt-trois morts.
L’histoire des juifs de la Slovaquie, passée au XVIe siècle sous la tutelle des Habsbourg, recoupe celle de leurs coreligionnaires hongrois et des pays tchèques. Ils connaissent les mêmes vicissitudes -mesures discriminatoires, expulsions puis, au XVIIe siècle, l’obtention de quelques droits civiques. Depuis la Moravie voisine, de nombreux juifs affluent à Bratislava et dans les villes proches.

Cette région, considérée à l’époque comme le nord de la Hongrie, est appelée « magyar juif ». Juste après l’instauration de la double monarchie austro-hongroise en 1867, le Parlement hongrois vote une loi d’émancipation accordant aux juifs des droits civiques égaux à ceux des autres citoyens. Leur « magyarisation » s’accélère, notamment dans les villes de l’Ouest. La grande majorité des juifs slovaques vivent en revanche à l’Est, au sein de petites communautés repliées sur elles-mêmes, à l’instar du shtetl de Galicie ou d’Ukraine.
L’antisémitisme y est cependant plus virulent que dans les pays tchèques. Là-bas, les nationalistes reprochent aux juifs d’être de culture allemande. En Slovaquie, ils dénoncent leur assimilation à la culture hongroise. Le judaïsme slovaque est lui-même traversé par une lutte entre les réformistes et les orthodoxes.
Avec la naissance de la Tchécoslovaquie, après la Première Guerre mondiale et le traité de Versailles, les juifs obtiennent aussi le droit d’être reconnus comme une nationalité spécifique. La vie culturelle juive s’épanouit dans le nouvel État démocratique où les juifs jouent un rôle économique majeur, notamment en Bohême-Moravie. Plus du tiers des investissements industriels leur appartiennent. En Slovaquie, en revanche, 65 % des juifs vivent toujours dans les campagnes en 1930.

Les accords de Munich, en 1938, et la capitulation de Londres et de Paris face aux exigences de Hitler vont entraîner le démantèlement de la Tchécoslovaquie. Le territoire tchèque est amputé de la région des Sudètes. La Slovaquie, elle, perd au profit de la Hongrie des territoires à l’est et au sud où vivent 40 000 juifs ; elle devient une région autonome. Moins d’un an plus tard, en mars 1939, elle proclame son indépendance, sous la protection de l’Allemagne nazie. Elle se donne pour président le père Josef Tiso, et comme Premier ministre Andrej Hlinka, leader du Parti slovaque du peuple, clérical et d’extrême droite, devenu parti unique. Dès les premiers mois, des mesures discriminatoires sont prises contre les 135 000 juifs du pays ; elles seront encore durcies en septembre 1941, avec la promulgation d’une législation antijuive en 270 articles, imposant notamment le port de l’étoile jaune et institutionnalisant le travail forcé.
Les déportations vers les camps de la mort, principalement Auschwitz, commencent peu après. À la fin de l’année 1942, plus des trois quarts des juifs de Slovaquie ont été exterminés. Les déportations et les massacres reprennent en avril 1944, pendant la répression du soulèvement de la résistance slovaque, auquel participent de nombreux juifs. À la fin de la guerre, il ne reste plus que 5 000 juifs qui ont pu se cacher avec des faux-papiers. À peine 20 000 Juifs slovaques ont survécu au nazisme.
Bratislava fut un grand centre de la culture juive et de florissantes communautés vivaient dans des petites villes comme Kosice ou Presov, mais la plupart des juifs du territoire de l’actuelle Slovaquie, notamment dans la partie orientale du pays, résidaient dans des villages. Il reste encore aujourd’hui les vestiges de près de 200 synagogues et de 630 cimetières à l’intérieur des frontières de ce nouveau pays né le 1ᵉʳ janvier 1993 d’une séparation à l’amiable d’avec la République tchèque. La plupart sont enfouis sous des constructions modernes ou réduits à l’état de ruines. Ce sont les ultimes traces d’un monde disparu. Avant la guerre, 135 000 juifs (4,5 % de la population) vivaient sur le territoire de la Slovaquie actuelle. Aujourd’hui, il n’en reste que 4 000, pour la plupart très âgés, dont un millier à Bratislava.
Sous le clocheton de l’Hôtel de Ville juif de Prague, deux cadrans sont superposés, l’un orné de chiffres romain, l’autre de lettres hébraïques. Les aiguilles du premier tournent normalement de gauche à droite ; celles du second vont de droite à gauche, comme on lit l’hébreu. De telles horloges sont très rares, et celle-ci est la seule qui orne la façade d’un bâtiment public.

Apollinaire et Cendrars, comme de nombreux poètes et écrivains, furent fascinés par cette pendule évoquant « un temps qui semble éperdument tourner à rebours ». Juste en face, se dresse le grand triangle dentelé de la façade de la synagogue vieille-nouvelle, construite au XIIIe siècle. À quelques pas de là, s’ouvre l’entrée de l’ancien cimetière avec son amoncellement de 12 000 tombes. Certes, il ne reste plus que 1 200 juifs dans la capitale tchèque, alors qu’ils étaient 32 000 avant guerre.
Les quelques 700 communautés qui vivaient dans les villes et villages de Bohême et de Moravie ont été presque entièrement rayées de la carte par la Shoah. Mais synagogues et cimetières ont échappé, pour la plupart, aux destructions des nazis qui concentrèrent à Prague une grande partie du patrimoine pillé, afin d’y constituer un « musée de la race disparue », une fois achevée son extermination. La République tchèque, avec les vestiges du zidovske mesto, l’ancien quartier juif de la capitale, et les nombreux petits ghettos de province, n’en représente pas moins encore le plus riche et fascinant ensemble de lieux de mémoire juifs en Europe.
Les premières mentions d’une présence juive dans les pays tchèques datent des IXe et Xe siècles. Le marchand et voyageur juif arabe Ibrahim ibn Jacob décrit la ville de Prague, en 965, comme une grande cité commerciale : « Les Russes et les Slaves y viennent de leurs villes royales avec des biens. Et les musulmans, les juifs et les Turcs y arrivent aussi depuis le pays des Turcs avec des marchandises et des monnaies. » D’après ce texte célèbre, une partie des premiers juifs de Prague serait donc venue d’Orient, se mêlant à ceux qui étaient arrivés des pays allemands ou italiens.
La vie juive se concentre alors sur la rive gauche de la Vltava, au pied de la colline où s’élèvera plus tard le château. Des massacres et des baptêmes forcés sont mentionnés dès 1096, lors de la première croisade, mais ces tragédies demeurent isolées. Les juifs disposent des mêmes droits et privilèges que les autres marchands étrangers, et cette charte est confirmée à nouveau en 1174 par le prince Sobeslav II. Elle leur garantit la liberté de mouvement de d’installation sur les grandes routes commerciales. Ils s’activent dans le négoce et dans l’importation de produits de luxe depuis l’Orient. Certains savants fréquentent même la cour. Leur florissante communauté s’administre en toute autonomie. C’est à cette époque qu’elle s’établit sur sur la rive droite de la Vltava dans une enclave au nord de la vieille ville, qui deviendra plus tard le quartier juif. Dès cette époque, Prague représente l’un des hauts lieux de la culture juive en Europe, avec des talmudistes reconnus dont Isaac ben Jacob ou son disciple Abraham ben Azriel.

Les sort des juifs des pays tchèques change, comme ailleurs en Europe, après le IVe concile du Latran (1215) qui leur interdit de posséder de la terre et même de faire du commerce, et les oblige à habiter dans des quartiers séparés ; il leur laisse la possibilité de pratiquer l’usure. Quelques années plus tard, leur vie s’améliore à nouveau quand le roi Premysl Otakar II, suivant l’exemple du pape Innocent IV à Rome, instaure en 1254 une législation plus favorable, qui place les juifs sous la protection directe de la couronne. C’est à cette époque qu’est construite la Nouvelle Synagogue, appelée ensuite Stare-nova (« vieille-nouvelle ») -elle est le plus ancien bâtiment de culte de la République tchèque.
Au cours des décennies suivantes, malgré la réaffirmation par Charles IV de ces garanties, les persécutions et les massacres s’amplifient. Le plus terrible est le le pogrom de Pâques de 1389 qui coïncide cette année-là avec les deux derniers jours de Pessah. Des milliers de juifs sont massacrés par une foule fanatisée qui les accuse, encouragée par des prêtres, d’avoir profané des hosties. « Beaucoup ont été tué et les nommer tous est impossible, des jeunes et des femmes, des vieillards et des bébés. Ô toi, Dieu de toutes les âmes, point n’est besoin de te les remémorer, tu jugeras tout et tu sauras tout… », écrivit le rabbin Avigdor Kara qui, enfant, fut témoin du carnage où mourut son père. Cette élégie est toujours lue le jour de Yom Kippour dans la synagogue de Stare-Nova.
Entre 1417 et 1439, les guerres hussites ravagent les pays tchèques et ne simplifient guère la vie des juifs. La doctrine de Jan Hus se réfère au christianisme des origine contre les abus de l’Église. « Les catholiques considéraient les hussites comme une secte judaïsante, et les hussites eux-mêmes, notamment les plus radicaux du mont Tabór, se voyaient comme une extension de l’Israël biblique », notre l’historien Arno Parik, conservateur du Musée juif de Prague, soulignant que ce mouvement de révolte antiféodal a montré une certaine bienveillance vis-à-vis des juifs locaux malgré quelques dérapages.
Le développement de l’économie monétaire marginalise peu à peu les juifs. Ils sont expulsés de nombreuses villes de Bohême et de Moravie par une bourgeoisie qui s’affirme et ne veut pas de concurrents pour des activités de banque et de prêt. Les choses s’aggravent même pour les juifs de la capitale, pourtant protégés dans les premières décennies du XVIe siècle par les rois Vladislsav Jagiello, Ludwig Jagiello et par l’empereur Ferdinand Ie de Habsbourg au début de son règne. En 1541, la diète vote l’expulsion de tous les juifs de la ville avec l’accord du souverain. Seules une quinzaine de familles échappent, contre espèces sonnantes et trébuchantes, au bannissement. Peu à peu, en payant le prix fort, les juifs commencent à revenir en ville. En 1551, Ferdinand Ie oblige tous les juifs de Bohême « à porter un signe distinctif qui permettra de les distinguer des chrétiens », et il leur impose de vivre derrière les murs des ghettos.

Les juifs de la capitale sont à nouveau menacés d’expulsion en 1558 et doivent payer pour y demeurer. Cette situation précaire dure encore neuf ans jusqu’au décret du nouvel empereur Maximilien II, qui autorise les juifs déjà présents à Prague et dans les autres villes de Bohême à rester là où ils sont. Le souverain leur restitue la liberté de circulation et de commerce. Ces mesures sont encore accentuées par son successeur, le flamboyant Rodolphe II (1552-1612), ce « bouffon sage et poète fou », grand protecteur de savants, d’astrologues et d’artistes, qui s’installe à Prague avec toute sa cour après six ans de règne.
C’est à cette époque que la communauté juive praguoise connaît son apogée, dans l’effervescence baroque d’une cité devenue le coeur de la vie intellectuelle du continent, telle que la décrivit magistralement le grand slaviste italien Angelo Mario Ripelino, dans son ouvrage Praga magica (Paris, Plon, 1993). Des personnalités juives un rôle de premier plan, comme le mathématicien et astronome David Gans, ou le très saint savant et chroniqueur rabbi Yehuda Loew ben Betsalel qui, selon une légende tardive, façonna le Golem, créature d’argile et homme artificiel qui échappa à son démiurge. Le fameux rabbi, dont la tombe est toujours honorée, aurait même été reçu en audience le 16 février 1592 par l’empereur Rodolphe II, curieux des rites de la kabbale. Une autre grande figure est le financier et philanthrope Marcus Mordechaï ben Samuel Meisl, maire du quartier juif qui agrandit le cimetière et construisit l’hôtel de ville et de nouvelles synagogues.
La splendeur de la Prague juive continue au début du XVIIe siècle sous Ferdinand II, alors que la révolte des pays tchèques gagnés par la Réforme est écrasée en 1620 à la bataille de la Montagne blanche. Jacob Bashevi, un aventurier et grand financier arrivé d’Italie, est même anobli comme « von Treuenburg », grâce à son protecteur, le redoutable condottiere Albrecht de Wallenstein. Le banquier juif se voit ainsi récompensé pour être resté fidèle à l’empereur, comme la plupart des membres de sa communauté. La contre-Réforme triomphe dans tout l’empire des Habsbourg. Les juifs de Prague échappent aux mesure d’expulsion qui frappent les communautés de province, mais une épidémie de peste en 1680, puis un grand incendie en 1689, dévastent le ghetto. Certains pensent alors le transférer dans un autre quartier. Il est finalement reconstruit sur les décombres. La situation demeure très précaire avec des explosions d’antijudaïsme, notamment en 1694 avec l’affaire Simon Abeles (un adolescent de 12 ans, voulant se convertir au catholicisme, aurait été tué par son père et un ami de ce dernier).
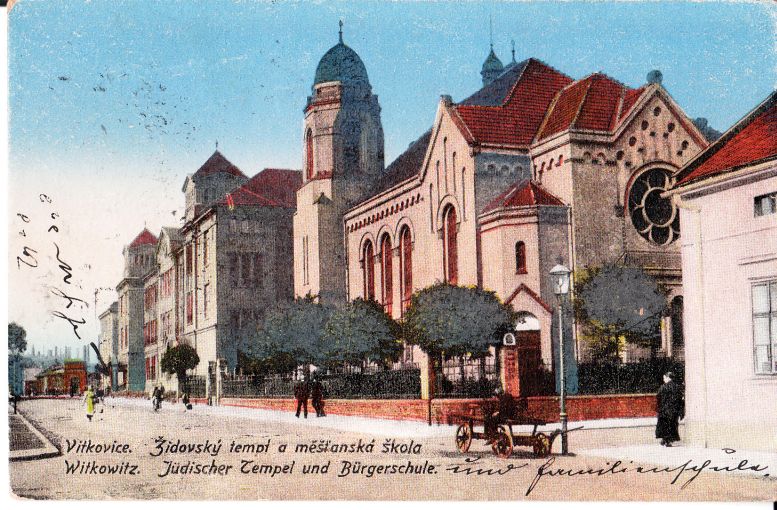
Au début du XVIIIe siècle, environ 12 000 juifs résident à Prague, devenue la plus grande ville juive sous la chrétienté. Mais leur vie devient très difficile sous l’empereur Charles VI (1711-1740), décidé à limiter de manière drastique leur nombre. En 1726, il organise un recensement et instaure une loi fixant un plafond au nombre des familles juives vivant dans les pays tchèques (8 541 en Bohême et 5 160 en Moravie). Un seul fils par famille -en général l’aîné- a le droit de se marier et de fonder un foyer ; les autres enfants mâles désireux de convoler doivent émigrer ou attendre des départs ou des extinctions d’autres noyaux familiaux. L’arrivée sur le trône de Marie-Thérèse (1740-1780) aggrave encore le sort des juifs tchèques et, en premier lieu, ceux de Prague.
Pour les punir de leur prétendue « déloyauté » pendant la guerre de Silésie contre les prussiens, la très bigote impératrice publie en 1744 un décret chassant sous un an tous les juifs de la capitale. La mesure suscite de nombreuses protestations en Europe, mais Marie-Thérèse demeure inflexible, et 13000 juifs quittent la ville en mars de l’année suivante tout en restant aux alentours. L’impératrice exige alors aussi leur départ des pays tchèques. Finalement, elle se laissera fléchir. Après le paiement de très lourdes amendes, équivalentes à dix fois leurs impôts en une année, ils juifs reviennent à Prague en 1748-1749. Ils vivotent sous la menace de nouvelles expulsions, dans un ghetto toujours plus insalubre et surpeuplé, avec une moyenne de 1822 habitants par hectare, soit trois fois plus que dans le reste de la ville. Les incendies sont redoutables ; celui de 1754 rase une grande partie du quartier dont six synagogues. C’est seulement à la fin du siècle, avec l’empereur Joseph II (1780-1790), que les juifs commencent à voir leur sort s’améliorer.
Le vieux quartier juif de Prague s’appelle toujours Josefov, en l’honneur de ce souverain éclairé qui abolit une partie des discriminations avec « l’édit de tolérance » (Toleranzpatent) de 1781 : sont accordés aux juifs et aux protestants une liberté religieuse limitée, ainsi que la plupart des droits dont disposent les autres citoyens de l’Empire. Il faudra toutefois encore attendre soixante-dix ans pour que la pleine égalité devienne réalité. Les réformes modernisatrices de Joseph II qui instaure, entre autres, le service militaire et la germanisation de l’enseignement, ont profondément marqué l’Empire comme le quotidien des juifs qui y vivaient. Ces derniers peuvent désormais accéder à l’enseignement secondaire et même supérieur, mais les communautés de Bohême et de Moravie doivent aussi instaurer des écoles primaires où l’instruction sera dispensée en allemand. Les traditionalistes, dont le rabbin Ezekiel Landau, adversaire résolu de la Haskalah (les Lumières et l’émancipation juive) qui parcoure déjà les communautés allemandes, dénoncent les risques de l’assimilation. Ils doivent néanmoins s’incliner. La première école germano-juive de Prague ouvre le 2 mai 1782. Une élite juive moderniste naît, s’affirme et commence à quitter le ghetto, même si ses murs ne tomberont officiellement qu’au milieu du siècle suivant.
Dans la population, l’antisémitisme est assez virulent, comme en témoignent les émeutes de 1844 où des ouvriers du textile en colère détruisent les ateliers des usines tenues par des juifs. En 1848, alors qu’une grande vague révolutionnaire balaye l’Europe et les pays tchèques, l’armée doit intervenir à Prague pour protéger les biens juifs. Mais, cette même année, avec la première constitution autrichienne, les juifs de l’Empire deviennent finalement des citoyens à part entière, et les lois familiales sont abolies -les juifs devront patienter encore une décennie pour avoir le droit d’acquérir officiellement de la terre ou des maisons hors des anciens ghettos.
La population juive augmente considérablement dès le milieu du siècle. En 1890, 94 599 juifs vievent en Bohême, et 45 324 en Moravie. Les juifs des villages et des bourgades affluent toujours plus nombreux vers Prague et les centres industriels. Une bourgeoisie juive s’affirme, mais l’intégration est d’autant plus difficile qu’il lui faut choisir entre le monde germanique, celui de sa culture, et un sentiment national tchèque toujours plus ouvertement germanophobe et anti-impérial. « Pour les jeunes nationaliste tchèques, les juifs étaient des Allemands. Pour les Allemands, les juifs étaient des juifs », souligne Ernst Pawel dans sa biographie de Kafka qui vécut directement ce déchirement (Franz Kafka ou le cauchemar de la raison, Paris, Seuil, 1996).
La haine des juifs représente le seul point d’accord entre les plus radicaux des nationalistes allemands et tchèques. Rien d’étonnant donc si bon nombre des premiers militants sionistes viennent des pays tchèques. Lors du premier recensement linguistique de 1880, véritable déclaration de foi pour l’une ou l’autre de ces deux identités, à peine un tiers des juifs tchèques déclarent le tchèque comme leur langue principale. Dis ans plus tard, 55% choisissent le tchèque. Dans les faits, la quasi-totalité des juifs parlent plutôt l’allemand mais, soumis à la pression ambiante, ils montrent ainsi leur attachement à une nation tchèque encore en gestation.
Le jeune mouvement national tchèque dérape volontiers dans l’antisémitisme : lors des émeutes de décembre 1897, après s’en être pris aux établissements culturels et commerciaux allemands les plus connus, la foule attaque pendant trois jours les magasins juifs et les synagogues, rossant quiconque à l’air « youpin ». La haine deviendra encore plus virulente deux ans plus tard avec l’affaire Hilsner, équivalent pour l’Europe orientale de l’affaire Dreyfus en France. « Telle était l’atmosphère remplie de haine du monde de Kafka. mais il n’en avait jamais connu d’autre et il lui fallut du temps pour comprendre pourquoi il lui était si difficile de respirer », souligne Ernst Pawel.
L’affaire Hilsner

Une jeune fille est trouvée assassinée le 1e avril 1899, la veille de Pâques, près de son hameau de Polna. Pour les villageois, il s’agit clairement d’un meurtre rituel juif. Un petit journal antisémite de Prague reprend la nouvelle, amplifie la campagne d’opinion et accuse Leopold Hilsner, un cordonnier juif du village. Il est arrêté, jugé et condamné à mort sans preuve, alors que la propagande antijuive se déchaîne dans tout l’Empire. Tomás Masaryk, le futur premier président de la Tchécoslovaquie, qui est le seul homme politique à avoir le courage d’aller à contre-courant : dans une petite brochure, il démonte minutieusement toutes les incohérences de l’enquête. Des étudiants manifestent alors afin qu’il soit chassé de l’université. Le livre est interdit, et on le considère comme un traître. Néanmoins, la gauche est ébranlée, ainsi qu’une partie de l’intelligentsia. Un nouveau procès a lieu s’achevant sur le même verdict, mais la peine est commuée. Le cordonnier est finalement gracié en 1918.
Au même moment commence la destruction du vieux ghetto, qui s’inscrit dans un vaste programme d’assainissement des quartiers les plus anciens de la ville. Les nouvelles élites juives, comme dans beaucoup d’autres villes d’Europe, ne tiennent guère à conserver ces maisons et ces ruelles sordides qui témoignent d’un passé encore récent. L’opération d’urbanisme dure jusqu’en 1905. Les démolisseurs, outre les taudis et vieilles masures, détruisent aussi de petites synagogues. Avant la Première Guerre mondiale, puis après 1918 dans une Tchécoslovaquie devenue indépendante, l’intelligentsia juive praguoise, de langue allemande, joue un rôle de tout premier plan, notamment dans le domaine littéraire, avec le « cercle de Prague » (Franz Kafka, Max Brod, Franz Werfel, Leo Perutz…).
Dans cette ville que le poète Paul Kornfeld présente comme « un asile d’aliénés métaphysiques », les trois cultures, allemande, juive et tchèque, s’entremêlent faisant de Prague l’une des grandes capitales culturelles de l’Europe. Des juifs jouent un rôle clé dans l’industrie du nouveau pays, mais aussi de la politique -Adolf Stransky publie notamment depuis 1893 le plus prestigieux quotidien tchèque, Lidové Noviny. Le président Tomás Masaryk se rend même en 1927 en Palestine sous mandat britannique pour visiter Jérusalem et les colonies juives. Mais la République démocratique et humaniste qu’il a réussi à créer ne durera que vingt ans.

En septembre 1938, les accords de Munich imposés par Hitler à une Tchécoslovaquie abandonnée par Londres et Paris amputent le nouveau pays des Sudètes à l’ouest, que fuient des milliers de juifs et de Tchèques. Peu après, une partie du sud de la Slovaquie est cédée à la Hongrie pro-nazie, puis les troupes allemandes s’installent dans le reste de la Slovaquie, qui se proclame État indépendant allié du Reich. En mars 1939, l’armée occupe ce qui reste de la Bohême-Moravie, placée sous la directe administration du Reich. Quelque 118 000 juifs vivent à l’époque sur ce territoire. Les lois raciales nazies sont aussitôt appliquées. Les juifs sont chassés de tous les emplois publics et les médecins juifs ne peuvent plus soigner que des juifs. Les entreprises juives sont confisquées. Les juifs doivent enregistrer tous leurs biens, et leurs capitaux et devises sont saisies. Un an plus tard, ils sont tous contraints de porter l’étoile jaune.
La Solution finale commence dans les pays tchèques en octobre 1941, avec le départ d’un premier convoi de 1 000 personnes vers des ghettos est créé dans la petite ville de Terezín (au nord de la Bohême), vidée de tous ses habitants. Les juifs tchèques sont entassés là, quelques semaines ou quelques mois avant de partir pour les camps d’extermination en Pologne. Environ 89 000 juifs de Bohême et de Moravie ont été déportés, et 80 000 sont morts. Après la guerre, des réfugiés juifs de l’Est, notamment de la Ruthénie, affluent vers Prague, et environ 19 000 juifs émigrent vers Israël. Une autre vague de 15 000 départs suit en 1968 l’écrasement du printemps de Prague par les chars soviétiques. il ne reste aujourd’hui que 6 000 juifs dans la République tchèque.
Partir ?
Des après-midi entières, je suis maintenant dans la rue et je baigne dans la haine antisémite. J’ai une fois entendu qualifier les juifs de race galeuse. Cela ne va-t-il pas de soi que l’on quitte les lieux où l’on est tant haï ? Nul besoin d’invoquer le sionisme ou le sentiment d’appartenance à un peuple. L’héroïsme qui consiste à rester malgré tout est celui des cafards qu’on arrive pas à exterminer dans la salle de bain. Je viens juste de regarder par la fenêtre : police montée, gendarmes baïonnette au fusil, foule qui se disperse en criant ; et ici en haut à la fenêtre, la honte odieuse de continuer à vivre sous protection. »
Franz Kafka, Lettres à Miléna, Paris, Gallimard, 1988.
La richesse du patrimoine juif de la capitale tchèque éclipse celle du pays, trop souvent négligée par les institutions juives comme les touristes. Dans les petites villes de Bohême-Moravie, il vous sera encore possible de voir d’extraordinaires cimetières juif, comme à Kolín, ou des ghettos qui ont gardé leur aspect extérieur de jadis, comme à Trebic. Les nazis ont éliminé presque totalement les petites communautés juives des pays tchèques. Un demi-siècle d’incurie sous le communisme a détruit une bonne partie de ce qui restait de ce patrimoine. Beaucoup de synagogues ont été transformées en magasins, en entrepôts ou en salles municipales. Des immeubles ont été construits sur d’anciens cimetières…Cependant, il reste encore de très nombreux vestiges de la présence des quelque 118 000 juifs vivant en Bohême-Moravie avant 1939, recensés grâce au patient travail d’historiens et de conservateurs.
Jiri Fiedler : Archéologue de la mémoire
Cet historien, né à Olomoc en Moravie, a longtemps travaillé, presque seul malgré l’indifférence, voire l’hostilité des autorités communistes, dressant la liste des derniers vestiges témoignant de la présence pluriséculaire de quelque 700 communautés juives dans les pays tchèques.
« Il y a aujourd’hui 200 synagogues dans le pays. Il y en avait encore 300 après la guerre », souligne cet historien. Son livre, Jewish Sights of Bohemia and Moravia (Prague, éd. Sefer, 1991) est un guide incontournable, qui recense de façon complète un patrimoine toujours en péril. Nombre de petites synagogues de village, transformées depuis des décennies en magasins ou dépôts ont été détruites par l’État ou par leurs propriétaires. Les petits cimetières juifs e campagne qui parsèment le territoire tchèque sont menacés par le vandalisme ou par des pilleurs, convaincus qu’il y a de l’or dans les tombes juives.
La terrifiante guerre menée contre l’Ukraine change, bien entendu, la fonction de ces pages consacrées au patrimoine culturel juif de ce pays. Une grande partie des lieux mentionnés ont été rasés par les bombes. Si ces pages ukrainiennes n’ont pas actuellement de vocation touristique, elles pourront peut-être servir à des chercheurs et étudiants comme références historiques. Références à tant d’histoires douloureuses lors des pogroms et de la Shoah, mais aussi heureuses du judaïsme ukrainien, dans ses dimensions culturelle, cultuelle et sioniste. En souhaitant au peuple ukrainien une fin rapide à ces atrocités dont il est victime.

L’Ukraine, la plus importante des républiques ex-soviétiques, est, avec la Biélorussie et la Lituanie, l’héritière de l’ancienne « zone de résidence », cordon sanitaire destiné à refouler les juifs aux marges occidentales de l’Empire russe. Malgré les pertes considérables dues à la Shoah puis à l’émigration, elle possède toujours une importante communauté juive (environ 500 000 membres, soit 1 % de la population), concentrée principalement dans les grandes villes (Kiev, Odessa, Dniepropetrovsk, Kharkov, Donetsk) et dans certains anciens shtetelekh du Sud. La vie culturelle juive, en pleine renaissance depuis l’indépendance du pays en 1991, reste cependant limitée du fait de la pesanteur des soixante-dix ans d’assimilation et de persécutions du régime soviétique, et du fait de la recrudescence de l’émigration.
L’histoire des communautés juives de l’Ukraine d’aujourd’hui doit être replacée dans le contexte de la réalité historique complexe de l’Ukraine elle-même, qui n’a jamais eu de véritable identité étatique, sauf à l’époque de la puissante principauté de Kiev (Kievskaïa Rus’), aux XIe-XIIIe siècles, berceau commun de la Russie et de l’Ukraine.
Une géographie mouvante
Pendant des siècles, l’histoire des juifs d’Ukraine se confond avec celle des juifs de Pologne. À partir du partage de la Pologne jusqu’à la Première Guerre mondiale, elle se confond avec celle des juifs de Russie, sauf pour la Galicie qui fait partie de l’Empire austro-hongrois. Depuis la révolution de 1917, c’est celle des juifs soviétiques, sauf pour la Galicie et la Volhynie qui font partie de la Pologne jusqu’en 1939.

Quand les juifs sont chassés de la France (en 1394), puis d’Espagne et du Portugal (en 1492), la Pologne, alors en pleine expansion économique et militaire, apparaît comme un pays d’accueil où règne la tolérance religieuse, pour qui se soumet à l’autorité et à la primauté du catholicisme.
Les rois de Pologne, notamment Sigismond Ier et Sigismond II au XVIe siècle, ont une politique de tolérance envers les juifs, leur accordant certaines franchises et suscitant la création d’institutions communautaires chargées de collecter les impôts. L’expansion de la communauté juive dans le royaume de Pologne au XVIe siècle se remarque dans presque toutes les villes, notamment du centre et de l’Est (Galicie, Volhynie, Podolie, Lituanie, Ukraine), où affluent artisans et commerçants juifs.
Massacres des populations juives
Cette expansion est brutalement interrompue en 1648-1649, lors de la première grande catastrophe vécue par ces communautés : les révoltes des Cosaques de Khmelnitsky contre la noblesse polonaise et les massacres des populations juives qui accompagnent la prise de chaque ville, pogroms d’une incroyable cruauté dont sont victimes environ 100 000 juifs dans toute l’Ukraine.
Les communautés juives de certaines villes (Ostrog, Sokal, Vladimir-Volynski, Ouman, Proskourov, etc.) sont entièrement anéanties. Elles ne se reconstituent que plus tard, dans les localités qui jouissent de la protection d’un noble ou du souverain lui-même.
Naissance du hassidisme
Il faut un siècle entier après les massacres pour que les communautés juives d’Ukraine prennent un nouvel essor, notamment à partir du renouveau religieux marqué par le hassidisme, mouvement fondé en Podolie par Israël ben Eliezer (1700-1760), dit le Baal Shem Tov de Medzyborz, qui a un succès considérable et essaime en Lituanie, en Pologne et dans toute l’Ukraine, grâce à de nombreux maggidim ou prêcheurs itinérants et aux disciples, comme le Maggid de Doubno (Jacob Kranz), proche des mitnaggedim, adversaires du hassidisme, Dov Baer de Mezeritch puis Nahman de Bratzlav et d’autres tsaddikim.

À la fin du XVIIIe siècle, avec les partages successifs de la Pologne (1772, 1793 et 1795) et l’absorption de l’Ukraine par la Russie, la situation des juifs change considérablement. La Russie, qui a interdit toute résidence aux juifs sur son territoire, se trouve soudain à administrer la population juive la plus importante du monde. Le gouvernement tsariste fixe donc les limites d’une « zone de résidence » dans laquelle les juifs ont le droit de s’établir, qui coïncide approximativement aux zones prises à la Pologne (Lituanie, Biélorussie, Ukraine jusqu’au Dniepr, Royaume de Pologne), auxquelles on ajoute les terres vierges à peupler de la Nouvelle Russie (Kherson, Nicolaïev, Odessa, la Crimée), puis la rive gauche du Dniepr (Poltava, Iekaterinoslav).
Développement de la littérature yiddish
Au cours du XIXe siècle, la politique répressive de l’Empire russe perdure. En 1827, est promulguée l’expulsion des juifs de Kiev. Après une période de réformes libérales sous Alexandre II, l’oppression des juifs se poursuit avec Alexandre III, sous le règne duquel ont lieu de nombreux pogroms contre la population juive, qui incitent celle-ci à émigrer de plus en plus massivement vers l’Europe et surtout les États-Unis. Simultanément, se développe la littérature classique en langue yiddish, avec notamment Scholem Aleïkhem et Mendel Moïkher Sforim.

Après la Première Guerre mondiale, la révolution et la guerre civile se propagent en Ukraine de 1917 à 1921, au cours de laquelle de terribles pogroms sont perpétrés par les bandes nationalistes de Simon Petlioura, qui massacrent dans le pays environ 100 000 juifs : à Zitomir, Proskourov, Rovno, Belaïa, Tserkov, Kiev, Vinnitsa, etc. Le pouvoir soviétique abolit la « zone de résidence » et les restrictions contre les communautés juives, mais mène simultanément une campagne contre la religion qui conduit à fermer de nombreuses synagogues.
Exterminations pendant la Shoah
Le traumatisme le plus grand pour la communauté juive d’Ukraine fut celui de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah. Les Allemands envahissent l’Union soviétique le 21 juin 1941 et organisent aussitôt l’extermination de la communauté, forcée à résider dans des ghettos qui sont « liquidés » un à un, le plus souvent au cours d’exécutions de masse à ciel ouvert, dans des fosses communes creusées par les victimes elles-mêmes.
Dans presque toutes les villes d’Ukraine, on peut trouver dans un bois, à l’extérieur de la ville, le lieu de ces exécutions, marqué en général par une stèle « Aux victimes du fascisme ». Le recensement de tous ces lieux prendrait à lui seul un autre site Internet.
Renaissance de la vie culturelle juive
Après la Seconde Guerre mondiale, certaines communautés juives se reconstituent grâce au retour de ceux qui ont pu être évacués (vers le centre de la Russie) à temps, mais la politique officielle antireligieuse et antisémite se poursuit avec le soi-disant complot des « blouses blanches » : de nombreuses synagogues et institutions communautaires sont fermées. Ce n’est que depuis la perestroïka (1985) et l’indépendance de l’Ukraine (1991) que l’on assiste à une renaissance de la vie culturelle juive, mais aussi à un accroissement de l’émigration, surtout des plus jeunes, qui produit le vieillissement, l’appauvrissement et la fragilisation de cette communauté.
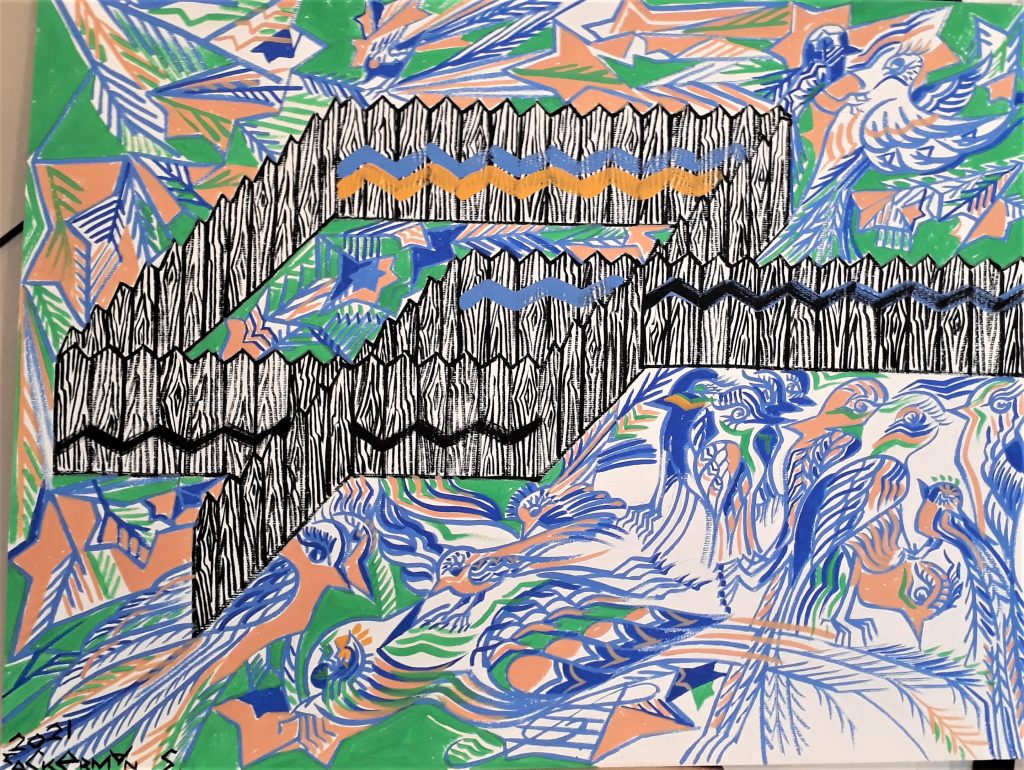
Jusqu’au début du XXe siècle, l’histoire des juifs de Russie concernait principalement des territoires (Ukraine, Biélorussie, Bessarabie, Lituanie) qui, aujourd’hui, ne font plus partie de l’actuelle Fédération de Russie.
À quelques rares exceptions près, l’établissement des juifs à Moscou, à Saint-Pétersbourg et dans les villes de Russie centrale n’était pas autorisé. Certes, des colonies juives existaient dès l’Antiquité sur les bords de la mer Noire, en Crimée, puis dans le royaume Khazar qui prit le judaïsme comme religion à la fin du VIIIe siècle et au IXe siècle, avant de péricliter et d’être supplanté par la principauté de Kiev (Xe-XIIIe siècles), premier berceau de l’État russe. Après le déclin de la Russie kiévienne, absorbée par la Lituanie et la Pologne, le centre de la Russie s’est déplacé vers le Nord -Moscou, Pskov, Novgorod-, où les juifs n’avaient pas le droit de cité. Ce n’est donc qu’en conquérant des territoires sur la Pologne que la Russie a hérité de communautés juives, donc d’un « problème juif » qu’elle ne connaissait pas auparavant.

Déjà en 1654, en absorbant l’Ukraine de la rive gauche du Dniepr, la Russie s’appropriait des territoires où vivaient les juifs, mais, d’un part ceux-ci avaient été largement massacrés à Khmelnitsky et, d’autre part, Pierre Ier édicta, en 1721, un oukase les chassant de Petite Russie, confirmé en 1742 par l’impératrice Elisabeth Petrovna qui refoula les juifs hors des frontières de l’Empire russe.
C’est donc principalement lors des trois partages successifs de la Pologne (1772, 1793 et 1795) que la Russie s’appropria des terres où vivaient de fortes communautés juives, « acquisition énigmatique de la Russie » selon l’expression de l’historien John Klier. En l’espace de quelques décennies, ce pays autrefois sans juifs dut administrer la plus grande communauté juive du monde, forte d’environ 700 000 ou 800 000 âmes. Dès 1791, Catherine II prit des mesures visant à restreindre leur liberté de mouvement et à les empêcher de s’établir dans d’autres régions de l’Empire. Ces mesures, complétées par les souverains successifs entre 1804 et 1825, donneront naissance à ce qu’on a appelé la « zone de résidence » où les juifs étaient contraints de demeurer, qui s’étendait sur tout l’Ouest de l’Empire, de la mer Baltique à la mer Noire, dans ce qui est aujourd’hui la Lituanie, la Pologne, la Biélorussie, l’Ukraine.

À partir de 1859, quelques allègements furent apportés et des autorisations de vivre hors de la « zone de résidence accordées aux « marchands de la première guilde », en 1861 aux titulaires d’un grade universitaire, en 1865 à certains artisans, en 1867 à d’anciens militaires et en 1879 à tous ceux qui avaient une formation élevée. Du fait de ces allègements en faveur des plus cultivés et de l’attraction des deux capitales, dès la fin du XIXe siècle, les meilleurs représentants de l’intelligentsia juive quittèrent les shtetlekh et s’installèrent à Saint-Pétersbourg et à Moscou.
La « zone de résidence »
Pour pouvoir habiter à Pétersbourg, il faut non seulement de l’argent, mais une autorisation particulière. Je suis israélite. Or, le tsar a fixé une certaine zone de résidence dont les juifs n’ont pas le droit de sortir.
Marc Chagall, Ma Vie, Paris, Stock, 1990
Cependant, ce n’est qu’à partir de la Révolution de 1917 qui abolit la « zone de résidence », ce que mouvement prit une ampleur massive et qu’on vit se constituer de fortes communautés juives d’intellectuels et d’artistes à Petrograd et à Moscou, qui connurent un développement culturel et l’apogée de leur histoire dans les années 1920, avec le rôle moteur joué par le théâtre juif d’État (GOSET) d’Alexander Granovski et de Solomon Mikhoëls. Les bolcheviques soutinrent à l’époque le yiddish comme expression des classes populaires juives et favorisèrent le développement du théâtre à Minsk, à Kiev et à Odessa. Des écoles juives furent créées avec l’enseignement en yiddish (il en existait 1100 au début des années 1930), des sections juives s’ouvrirent dans les universités.
Le théâtre juif de Russie
Les origines du théâtre en langue yiddish en Russie remontent au XIXe siècle et se fondent principalement sur les Purimspiele, spectacles mettant en scène l’histoire d’Esther. Le père du théâtre yiddish est Abraham Goldfader (1840-1908). Ce théâtre, essentiellement ambulant, connaît son essor après la Révolution de 1905 grâce à Peretz Hirschbein qui crée à Odessa, le théâtre artistique juif où il jouait les « classiques » d’Itzhak Leybush Peretz, Scholem Aleïkhem, Schalom Asch, ainsi que ses propres pièces. Avec la Révolution de 1917 et durant les années 1920, se produit un second développement du théâtre yiddish : Alexander Granovski (1890-1937) fonde le Studio juif de Petrograd et découvre Solomon Mikhoëls, acteur culte du théâtre juif et soviétique. En 1920, la troupe de Granovski s’installe à Moscou pour devenir le GOSET (théâtre juif d’État), qui acquiert la célébrité en bénéficiant de l’apport de décorateurs tels que Chagall, Altman, Rabinovitch ou Faltz.
Le pouvoir soviétique considéra la question juive comme une simple question sociale et tenta d’obtenir l’adhésion des masses juives en leur offrant des terres, refusées par le pouvoir tsariste. C’est ainsi que se constituèrent, dans les années 1920, des kolkhozes juifs regroupés dans le sud de l’Ukraine et en Crimée, en rayons (cantons) nationaux juifs. En 1928, une région d’Extrême-Orient, le Birobidzhan fut décrétée région autonome juive avec le yiddish comme langue officielle et proposée aux juifs désireux de la coloniser. Parallèlement, les activités sionistes furent interdites, comme les organisations Halouts, Makkabi, HaShomer haTsair et le parti Poalei Tsion, ainsi que, au nom de l’athéïsme, tout ce qui avait rapport avec la religion : synagogue, yeshiva, mikveh, heder…
Au milieu des années 1930, cette politique s’aggrava : en 1937-1939, à l’apogée de la répression stalinienne, la quasi-totalité des institutions et associations juives étaient interdites et de très nombreux juifs étaient victimes des purges, des déportations et des exécutions. En 1939, plus de 3 millions de juifs vivaient en Union soviétique, nombre qui fut porté à 5 millions après l’annexion de la partie orientale de la Pologne à la suite du pacte germano-soviétique.
Le 22 juin 1941, l’Allemagne nazie déferlait sur l’URSS. Elle extermina la population juive dans le territoires occupés, qui correspondaient approximativement à l’ancienne « zone de résidence ». Entre l’été 1941 et l’été 1942, ville après ville, village après village, les juifs furent exécutés par centaines de milliers dans des fosses communes, sans attendre que fût inventée en Pologne la mort « propre » des chambres à gaz.
En 1942, fut créé le Comité antifasciste juif, sous la direction de l’acteur Solomon Mikhoëls, destiné à sensibiliser et alerter l’opinion internationale sur les massacres des juifs perpétrés par les nazis. Tous les membres de ce comité seront arrêtés et exécutés en 1952.
À partir de 1948, l’antisémitisme devient politique officielle, sous le nom de lutte contre le « cosmopolitisme ». Les synagogues qui étaient encore en activité, les théâtres juifs, les bibliothèques, les maisons d’édition en yiddish furent fermés. Les juifs qui avaient des postes importants furent licenciés, comme par exemple le photographe Khaldeï, auteur notamment de la célèbre photo du drapeau soviétique flottant sur le Reichstag. Les grands écrivains yiddish furent assassinés (Peretz Markish, Der Nister, David Bergerlson, entre autres).
Après la mort de Staline et le léger dégel khrouchtchévien, les médecins juifs accusés du complot des « blouses blanches » furent réhabilités, et une revue en langue yiddish, Sovyetich Heymland, put paraître à partir de 1961. Après la guerre des Six jours (1967), l’antisémitisme officiel se cacha sous le terme d’antisionisme et l’hostilité envers l’État d’Israël. Les juifs soviétiques qui demandèrent à émigrer essuyèrent des refus, comme Anatoli Chtcharanski, qui fut plus tard ministre israélien des Affaires étrangères.
Ce n’est qu’à partir de la perestroïka (1985) de Mikhaïl Gorbatchev que la situation s’est améliorée pour les juifs, qui ont obtenu l’autorisation d’exercer leur culte et leurs activités, ainsi que le droit d’émigrer. De nombreuses synagogues et écoles juives ont été réouverte dans toute la Russie et les autres républiques ex-Soviétiques, une centaine de journaux et de périodiques juifs (en langue russe) se sont créés, ainsi que diverses organisations, congrès juifs, communautés, etc. À Moscou et à Saint-Petersbourg se sont créées des « universités juives » et, à Kiev, un Institut de judaïstique près de l’Académie Moguila. L’émigration des juifs russes et de l’ex-URSS a été massive dans les années 1990 et continue aujourd’hui. Le yiddish n’est pratiquement plus parlé et la revue Sovyetich Heymland a dû cesser sa publication.
La Pologne représente le chapitre le plus illustre et le plus tragique de l’histoire juive européenne. Pendant des siècles, ce pays fut le plus accueillant pour les juifs fuyant l’Allemagne, l’Espagne, l’Europe du Sud ; il y naquit la communauté la plus importante, jouissant de privilèges et d’une autonomie accordés par les différents rois ; il s’y élabora l’une des cultures les plus riches…
Ce pays finit par devenir le plus grand cimetière juif d’Europe, le lieu où se concrétisa presque parfaitement le rêve nazi de « l’extinction de la race juive ». Deux chiffres suffisent à rendre compte de l’ampleur du désastre : il y avait 3 500 000 juifs en Pologne en 1939, soit 10 % de la population, il y en a 3 000 aujourd’hui. Une visite de la Pologne juive s’apparente donc à une fouille archéologique menée après un cataclysme du style de Pompéi, à la recherche des traces d’une communauté disparue, qui ne vit que dans la littérature et dans les souvenirs de ceux qui ont pu émigrer à temps ou survivre par miracle.

Les plus anciennes traces de présence juive en Pologne remontent au Xe siècle : un voyageur venu de Tolède, Ibrahim ibn Jacob, rédige en 965 le premier rapport d’importance sur la Pologne. À l’époque des croisades, en 1098, des juifs chassés de Prague s’installent en Pologne. Des communautés juives sont mentionnées en 1237 à Plock, en 1287 à Kalisz, en 1304 à Cracovie. En 1264, le roi de Pologne, Boleslas le Pieux, accorde aux juifs un privilège dit « statut de Kalisz », qui leur garantit la sécurité des personnes et des biens, et la liberté religieuse. Au XIVe siècle, sous Casimir le Grand, ces privilèges accordés aux juifs sont confirmés (en 1364 et 1367), puis encore en 1453 par Casimir Jagellon : ils régissent la position des juifs jusqu’au partage de la Pologne (fin du XVIIIe siècle). Les communautés juives ont une véritable autonomie, le droit de construire des synagogues, des écoles juives, de rendre la justice, ce qui fait de la Pologne le pays le plus tolérant d’Europe.
À partir du milieu du XIVe siècle, des émigrants juifs chassés d’Allemagne trouvent refuge en Pologne. De véritables quartiers juifs se forment à Llov (1356), à Sandomierz (1367), à Kamimierz près de Cracovie (1386), des communautés sont signalées dans quatre-vingt-cinq villes. À partir du milieu du XVIe siècle et durant toute la première moitié du XVIIe siècle, de nombreux émigrants continuent à affluer des pays allemands, d’Espagne, d’Italie et de Turquie. Les centres de la vie juive se déplacent vers l’est du pays.

En 1581, est constituée à Lublin la « Diète des quatre pays » (Sejm Czeterech Ziem, ou en hébreu Vaad arba aratsot), désormais convoquée chaque année pour statuer et régir la communauté juive de Pologne et de Lituanie, et ce jusqu’en 1764. Le Sejm ou Vaad se charge de collecter l’impôt et de protéger la communauté. C’est le Vaad qui prend la décision de construire les synagogues fortifiées de Brody, Buczacz, Lesko, Lublin, Schargorod, Stryj, Szczebrzeszyn, Zamosc, Zolkiew, et d’autres encore. E, 1646, on estime la population juive à 500 000 habitants, soit déjà 5% de la population totale.
Un cinquième d’entre eux sont massacrés par les cosaques de Khmelnitsky. Le fait que ce soit précisément en Pologne et en Ukraine que naît et s’épanouit le mouvement hassidique de revitalisation religieuse est une conséquence lointaine de ces massacres et de la paupérisation qui s’ensuit. Il faut attendre le XVIIIe siècle pour que les communautés se reforment et s’accroissent. En 1790, après le premier partage de la Pologne, leur nombre atteignait 900 000, soit 10 % de la population.
De 1785 à 1918, la Pologne est rayée de la carte, partagée entre ses trois puissants voisins (Russie, Autriche, Prusse), à l’exception des années 1807-1815, pendant lesquelles Napoléon crée le grand-duché de Varsovie. La grande majorité de la communauté juive de Pologne se retrouve dans l’Empire russe et perd tous les privilèges dont elle jouissait à l’époque polonaise. L’auto-administration de la communauté est supprimée et le tsar relègue la population juive dans la « zone de résidence », lui imposant d’importantes restrictions. Dans la partie de la Pologne annexée par l’Autriche (la Galicie), vit également une forte proportion de juifs, qui voient tout d’abord certains de leurs privilèges abolis, mais qui bénéficient dans certaines villes d’un régime favorable. En 1867-1868, est décrétée l’égalité entre tous les sujets de la monarchie autrichienne, donc aussi pour les juifs. C’est en Galicie que l’assimilation des juifs est la plus forte, une grande partie des intellectuels juifs se tournant vers la culture allemande, comme Karl-Emil Franzos (né à Czortków) ou Joseph Roth (né à Brody), d’autres vers la culture polonaise comme Bruno Schulz (né à Drohobycz).
Après la Première Guerre mondiale, une Pologne indépendante est recréée, aux frontières très étendues vers l’est, comprenant des « confins » (kresy) en Galicie, Volhynie, Biélorussie, Lituanie, où se concentrent de nombreuses populations allogènes et où les villes sont à majorité juive.

La « question juive » se pose de manière accrue : ce n’est pas seulement une question nationale et religieuse, mais aussi sociale, eu égard aux énormes masses populaires misérables vivant dans les ghettos. Le gouvernement polonais de l’entre-deux-guerres, dominé par la « démocratie nationale », antisémite, les accable d’impôts et empêche leur ascension sociale. Les tensions montent, et lorsque viennent la « montée des périls » puis l’occupation allemande, les juifs sont graduellement lâchés par les Polonais, eux-mêmes soumis à un régime très sévère et occupés à leur propre survie.
La suite est trop connue pour être relatée en détail. Le 1ᵉʳ septembre 1939, les Allemands envahissent la Pologne et créent des ghettos dans lesquels ils rassemblent la population juive, la séparant strictement des quartiers « aryens » et lui imposant de très grosses restrictions, visant l’épuisement par le travail et le manque de nourriture.
À partir de 1941 et surtout de 1942, les ghettos sont liquidés un à un, et leur population transférée dans des « camps de la mort », à Chelmno, Belzec, Sobibór, Treblinka, spécialement destinés à l’extermination, ou dans des camps déjà existants comme Auschwitz ou Maïdanek, à la fois camps de travail et d’extermination. Toute la population juive de Pologne, presque sans exception, a disparu dans ces camps de la mort. Le camp le plus connu de tous est Auschwitz, devenu le symbole de la Shoah. C’est celui où l’industrie de la mort a été poussé le plus loin. Néanmoins, nous ne le présenterons qu’à peine dans ce guide, précisément parce qu’il est trop connu, trop visité et trop déprimant. Nous préférons nous arrêter sur des lieux très beaux, à découvrir et à visiter avec plaisir et émotion, comme Cracovie, Lesko, Zamosc, Lublin, ou encore présenter des camps moins connus mais tout aussi émouvants : Sobibór, Treblinka, Chelmno, où l’on peut se recueillir plus facilement qu’au milieu des foules de touristes.
L’histoire du judaïsme polonais de l’après-guerre a accentué encore le malentendu entre juifs et Polonais. Outre les quelques survivants des ghettos, les rares juifs restés en vie sont les soldats de la zone soviétique, engagés dans l’Armée rouge et qui ont participé à la libération de leur pays. Quand ils reviennent, ils trouvent les ghettos déserts, leurs maisons détruites, tous leurs parents exterminés. Une première vague d’émigration vers Israël se forme donc et s’amplifie à partir de 1947 après le pogrom de Kielce. Puis chaque soubresaut du nationalisme ou du national-communisme polonais provoque une nouvelle vague d’émigration des juifs, notamment en 1956 avec l’arrivée au pouvoir de Gomulka et en 1967-1968, après la guerre des Six jours. Ces vagues d’émigration vident presque totalement le pays de ses juifs : sur les 300 000 ou 400 000 qui demeuraient encore en Pologne en 1945, il n’en reste que quelques centaines aujourd’hui, à Varsovie, Cracovie, Wroclaw, Lodz, dont les synagogues ne parviennent pas toujours à réunir le minyan.
Depuis les années 2000, on peut cependant constater un regain d’intérêt pour la culture juive du pays et les travaux de recherche universitaire autour de la période de la Shoah. Des synagogues et des quartiers juifs ont été réhabilités, comme à Cracovie. Le symbole le plus évident de ce changement d’attitude de la Pologne face à son passé est le Musée juif de Varsovie, qui a ouvert ses portes en 2013.
La Biélorussie, ou République du Bélarus, est un État issu de la désintégration de l’URSS. Il est d’ailleurs resté très proche de Moscou. Historiquement, la Biélorussie a fait partie de la Lituanie au XIVe siècle, de la Pologne au XVIe, puis de l’Empire russe à la fin du XVIIIe siècle. De 1920 à 1939, sa partie occidentale (Grodno, Brest-Litovsk) a été intégrée à la Pologne, le reste à l’Union soviétique. L’histoire des communautés juives de Biélorussie est donc liée à celle de ses voisins : Lituanie, Pologne et Russie. Des communautés sont mentionnées à Brest-Litovsk en 1388, à Nowogrodek (Novogrudok) en 1445, à Minsk et Smolensk en 1489, à Pinsk en 1506, puis à Vitebsk, Mohuilev et Orsa. Après le partage de la Pologne, la Biélorussie est englobée dans la « zone de résidence » de l’Empire russe, donc assujettie à la politique de restrictions qui y est appliquée. En 1847, 225 000 juifs vivaient en Biélorussie, 725 000 en 1897 (13,6 % de la population totale).
D’un point de vue spirituel et intellectuel, le judaïsme de Biélorussie se rapproche du judaïsme lituanien, marqué par la Haskalah (le mouvement des Lumières). La majorité des communautés, surtout au Nord et à l’Ouest, sont composées de mitnaggedim, orthodoxes rationalistes opposés au hassidisme. Venu d’Ukraine, le hassidisme s’est néanmoins implanté à Vitebsk avec Menahem Mendel. Au XIXe siècle, le mouvement socialiste s’est répandu en Biélorussie, qui est devenue la patrie du Bund, parti socialiste juif qui sera absorbé plus tard par les bolchéviques. Dans les années 1920 et durant l’occupation allemande, le mouvement communiste était fortement représenté parmi les juifs de Biélorussie, qui rejoignirent pour une grande part les rangs des partisans et des soldats de l’Armée rouge. L’occupation a été particulièrement violente en Biélorussie, où les juifs furent exterminés dans les ghettos. En 1970, il restait 148 000 Juifs mais l’émigration a considérablement réduit ce nombre, aujourd’hui estimé à quelques dizaines de milliers.
Malgré ce nombre réduit, la communauté juive de Biélorussie reste la troisième d’ex-URSS -après la Russie et l’Ukraine. Sa capitale, Minsk, accueille quelque 20 000 membres. On compte aujourd’hui 19 écoles juives dans le pays et 1400 étudiants dans 13 villes différentes. Vous pouvez visiter à Minsk un centre culturel juif et le Centre de l’histoire des Juifs de Biélorussie à Vitebsk. Si vous lisez le biélorusse, vous pouvez consulter le journal de la communauté www.sb.by.
L’Union des Communautés juives Biélorusse est la plus importante organisation communautaire du pays.
Pour toute recherche liée aux anciens shetlts et à ses habitants, dont il serait impossible de dresser ici une liste exhaustive, rendez-vous sur le site Internet Belarus Holocaust Memorials Projects.
Il est difficile d’attester la présence de juifs sur les côtes de la mer Noire avant l’arrivée des légions romaines au début du IIe siècle de notre ère. Des vestiges, des pièces de monnaies et des inscriptions, conservés au musée de Bucarest, témoignent en revanche d’une présence juive dans la région tout au long du premier millénaire. Vers la fin du XIIIe siècle, le grand voyageur Benjamin de Tudela signalait déjà une présence juive au sud de la Valachie.

La Roumanie regroupe trois régions historiquement distinctes, débordant d’ailleurs en partie de ses frontières actuelles. La Valachie, située entre la partie méridionale des Carpates et le Danube, la Moldavie, enclavée entre les Carpates orientales et la rivière Pruth, la Transylvanie, voisine de l’Ukraine, de la Hongrie et, dans sa province méridionale (le Banat), de la Serbie.

Chacune de ces régions connut un destin différent au sein des trois empires défunts : ottoman, russe et austro-hongrois. Ce n’est qu’en 1859 que la Valachie et la Moldavie se réunirent au sein d’un petit royaume danubien. Après la Grande Guerre, les provinces austro-hongroises et russes, où les Roumains se trouvaient majoritaires, les rejoignirent. Parmi elles, la Bucovine et la Bessarabie, qui furent le foyer d’un judaïsme roumain aujourd’hui disparu.
La treizième tribu ?
Avant et après le retrait de l’administration romaine, en 217, sous Aurélien, les Daces romanisés subirent, au nord du fleuve, le rouleau compresseur des grandes migrations. D’où l’hypothèse audacieuse, restée jusqu’ici non vérifiée, avancée par Arthur Koestler dans son livre La Treizième Tribu : les Khazars dont l’empire s’étendait, du VIIIe siècle au Xe siècle, de la Volga aux Carpates, pourraient être les ancêtres des millions de juifs qui vivaient en Europe occidentale et centrale avant la Shoah.
En effet, sur les 800 000 juifs établis en Roumanie dans l’entre-deux-guerres -soit la troisième communauté juive par ordre d’importance après la Pologne et l’ex-URSS, il ne reste de nos jours qu’une douzaine de milliers d’entre eux. Rappelons qu’en 1940, suite au pacte germano-soviétique, l’URSS annexa la Bessarabie et la Bucovine alors que la Hongrie faisait main basse sur une bonne moitié de la Transylvanie. Environ 400 000 juifs habitaient alors ces provinces avant leur liquidation massive, soit par l’armée roumaine alliée des nazis dans la guerre contre l’URSS (en Bessarabie, Bucovine et en Transnistrie), soit à Auschwitz, livrés par les autorités hongroises installées en Transylvanie occupée. Ceux qui habitaient les territoires restés roumains, spoliés de leurs biens et marginalisés, survécurent en grande majorité à la Shoah malgré les pogroms de Bucarest, de Dorohao et de Jassy. Au cours des décennies suivantes, ils émigrèrent vers Israël, les États-Unis ou l’Europe occidentale.
En contrebas de l’acropole d’Athènes, une plaque de marbre frappée de la menorah fut dégagée dans le « fouillis » de l’Agora, près d’une statue de l’empereur Hadrien. Peut-être a-t-elle été placée dans l’une de ces synagogues antiques que saint Paul visita, sans guère plus de succès après des juifs athéniens que des philosophes grecs de l’Aréopage.

À quand remonte la présence juive en Grèce ? La question reste à ce jour sans réponse précise. Mais ne faudrait-il pas d’abord se demander quand les Grecs rentrèrent eux-mêmes en contact avec le peuple juif, au passé plus lointain ? La légende veut que la première rencontre ait été pacifique et déférente. Alexandre le Grand, en route pour la conquête de la Perse, se serait prosterné à Jérusalem devant le grand prêtre Jaddua, venu à sa rencontre.
Que juifs et Grecs se soient côtoyés avant la conquête macédonienne, y compris comme mercenaires dans les armées égyptiennes, est certain. Cependant, l’hellénisation de la Judée, consécutive à cette conquête, est une source de tensions extrêmes. Une révolte nationale et religieuse est déclenchée après qu’une statue de Zeus a été apportée dans le Temple de Jérusalem. Un tel sacrifice est pour les juifs, dit la Bible, « l’abomination de la Désolation ».

Mais la diffusion inexorable de la culture grecque, ainsi que la « dispersion » du peuple juif, bien avant la destruction du Temple, par Titus en 70, rendent vite indispensable la traduction en grec de la Torah. C’est la Bible des Septante, traduite par soixante-douze scribes à Alexandrie, le grand port hellénistique d’Égypte, où les juifs sont un million, soit le tiers de la population. Elle est, au IIe siècle, la « version officielle » du texte sacrée , la seule intelligible, pour ces juifs hellénisés ; les premiers chrétiens reçoivent l’Ancien Testament par son biais. Domination, coexistence, échanges, ruptures culturelles et philosophiques, à l’exemple de Philon ou Maïmonide, grands philosophes juifs, ont ainsi tissés une relation singulière entre les deux peuples.
Les premières communautés juives s’installent sans doute dans les Cités de la Grèce actuelle vers le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Mais, « plus que l’immigration et le rachat des captifs, c’est l’extrême force de prosélytisme dont est animée alors la religion juive qui assure le recrutement et la vitalité des colonies de la diaspora », écrit Joseph Nehama, auteur d’une monumentale histoire des Israélites de Salonique. Ce serait parmi ces convertis, les « Craignants-Dieu », que la prédication chrétienne aurait remporté ses premiers succès.
Citadins le plus souvent, les juifs vivent cependant aussi à la campagne. Dans la région de Kalamaria, en Macédoine, une pierre tombale révèle que, vers l’an 200, Abraham et Théodote, un couple juif, vivaient du travail des champs.

À partir de la conversion de Constantin au christianisme, en 312, les empereurs sont désormais chrétiens et la situation des juifs commence à se dégrader. Après le partage de l’Empire romain, ils cessent de faire partie de la nation dans la partie byzantine. Les accusations de christoktonoi ou théoktonoi (« assassins du Christ ou de Dieu ») abondent la littérature religieuse. le judaïsme est défini comme « secte porteuse de mort », et le prosélytisme juif ou les mariages mixtes sont strictement prohibés dans le code de Théodose. Celui de Justinien, au VIe siècle, renforce encore, sous couvert de l’État de droit, les lois restrictives à l’égard des juifs. Les synagogues restent cependant des lieux de culte protégés, mais en bâtir de nouvelles est interdit.
La vie des juifs hellénophones, « les Romaniotes », au Moyen Âge est mal connu. On sait qu’ils ont été confrontés avant et après l’an mil à d’incessantes invasions de Slaves, Bulgares ou Normands. Négociant et voyageur, Benjamin de Tuleda, un juif de Navarre, visite les diaspora médiévales au XIIe siècle. Dans son Livre des voyages, il mentionne des cités importantes de Grèce où vivent des juifs, comme Corinthe, Thèbes, Lépantes, Patras, Kastoria, ainsi que Salonique où, au nombre d’un demi-millier, ils détiennent le quasi-monopole de la teinture et élèvent les précieux vers à soie.

Après la chute de Constantinople, en 1453, un flux quasi-ininterrompu de juifs trouve refuge dans les nouvelles possessions de l’Empire ottoman. Avec l’édit d’expulsion des juifs d’Espagne, signé le 31 mars 1492 par Ferdinand et Isabelle, ils y sont accueillis en masse. Au carrefour de l’Occident et de l’Orient, « Thessaloniki la Byzantine » devient « Salonica la Juive ». Le premier groupe serait venu de Majorque : il était appelé Ba’alé techouva pour signifier le retour au judaïsme des marranes, ces juifs convertis en apparence au catholicisme afin d’échapper à l’Inquisition. Au fil des ans, affluent des Castillans, qui imposent leur suprématie linguistique, des Aragonais, des Catalans, des Navarrais, puis des Portugais, des Apuliens, des Vénitiens, des Marocains ou des Livournais. Ils se regroupent par synagogues : kal de Castilia, kal d’Aragon, kal de Mayor, ou simplement Gueroush-Sepharad (« expulsion d’Espagne »)…

Les recensements montrent que la métropole ottomane ne compte, en 1478, que 2 200 foyers environ de musulmans et de chrétiens ; en 1519, moins de vingt ans après l’édit de l’Alhambra, elle possède 4 000 foyers, dont 56 % sont juifs. Un siècle plus tard, ce soit 7 500 foyers, dont 68 % de juifs. Salonique, où l’on parle le judezmo, du castillan mâtiné d’hébreu est la « mère en Israël », la « Jérusalem des Balkans » pendant plus de quatre siècles. Les responsa, avis des juristes juifs de Salonique sur des questions liturgiques ou de vie pratique, sont demeurées célèbres. Samuel Moïse de Médina del Campo, qui fit adopter un rituel séfarade homogène aux diverses congrégations, rédigea au XVIe siècle un millier de consultations.
À Salonique, il n’y a pas que des exilés venus d’Espagne qui s’implantent, bousculant les communautés juives romaniotes dans leur traditions, comme à Serres, Kavala, Patras, Drama, Larissa ou Trikala et Rhodes, mais pas à Ioannina. Les principaux foyers de vie juive sont entraînés, au XVIIe siècle dans une tourmente religieuse, dans le sillage d’un faux messie, Sabbataï Zevi. Le danger passé, après la conversion à l’islam de Zevi, les rabbins enserrent les fidèles dans des rituels étouffants. Deux siècles plus tard, le déclin de l’Empire ottoman replonge les communautés juives des Balkans, plutôt bien disposées à l’égard d’un pouvoir tolérant , dans l’incertitude et souvent le désarroi.

Un épisode, ou plutôt une légende aux conséquences dramatiques illustre la difficile situation éprouvée par les juifs lors de la longue guerre d’indépendance grecque. Cette guerre commence par une révolte, en 1821, tout au sud du pays. En représailles, le patriarche grec oecuménique de Constantinople, Grégoire V, est pendu à la porte du Phanar. Des Grecs prétendent que son corps aurait été jeté dans le Bosphore par trois juifs, sur ordre du grand vizir. En tout cas, c’est la raison invoquée par les insurgés grecs pour massacrer des milliers de juifs lors de la prise de la grande ville de Tripolis, au centre du Péloponnèse. À chaque fois, des flambées antisémites, à Ioannina (1872), à Kastoria (1879), à Corfou (1891), à Larissa (1898), à Trikala (1898), en Crête (1898) ou à Salonique (1912 et 1931) ponctuent la libération de « terres grecques ». Des accusations de crimes rituels -meurtres d’enfants chrétiens par des juifs- dégénèrent en pogroms. Ces événements provoquent une émigration massive de juifs vers Marseille au début du XXe siècle, à l’exemple de la famille du romancier Albert Cohen.
La lecture des rapports de l’Alliance israélite universelle, à la fin du XIXe siècle, est édifiante sur ce point. Que ces agissements n’eussent été le fait que d’une minorité, fanatisée par une presse nationaliste et une frange du bas clergé orthodoxe, semble évident. À ces bouffées d’antijudaïsme, qui reste vivace en Grèce, il faut aussi opposer les dispositions libérales prises, dès 1832, par l’État grec en faveur de l’égalité des droits civiques et de la tolérance religieuse.

Avec l’intégration de Salonique dans les frontières grecques, après les guerres balkaniques, les relations entre Grecs et juifs se font plus tendues. En pénétrant les premiers, en 1912, dans le plus grand port des Balkans, les soldats grecs prennent, de facto, possession d’une ville cosmopolite, à majorité juive. Convoitée par les Serbes, par les Bulgares et bien sûr par les Grecs, Salonique était devenue un foyer politique de l’Empire ottoman. David ben Gourion, père fondateur d’Israël, vient y étudier le turc en 1910 pour plaider la cause sioniste auprès de la Porte. La révolution des Jeunes Turcs y éclate, et le dernier sultan, Abdul Hamid, y est relégué. Confirmés après la Première Guerre mondiale dans leurs droits sur Salonique, les Grecs se donnent pour objectif d’assimiler, dans le cadre d’un État-nation, une population juive plus que rétive. En quelques étapes, dont le grand incendie de 1917 qui réduit en cendres la ville juive historique, ainsi que ses trente-deux synagogues, l’hellénisation s’accélère. De très nombreuses familles juives, éduquées en français par l’Alliance israélite universelle, émigrent -à Paris en particulier.
La donne démographique est définitivement bouleversée par l’afflux de 150 000 Grecs d’Asie mineure dans le cadre du dramatique transfert de populations inclus dans le traité de Lausanne de 1923. « Les tensions augmentèrent entre Grecs et juifs dans la ville et, plus généralement, en Grèce du Nord, sous l’effet d’une lutte économique exacerbée pour contrôler la vie économique », souligne l’historien George Mavrogordatos dans Stillborn Republic. Un pogrom éclate en 1931 dans le faubourg populaire de Campbell, suivi d’autres poussées de violence. Des dockers du port de Salonique partent en masse vers Haïfa. Le calme ne revient qu’avec l’instauration de régime fasciste du général Jean Metaxas en 1936 qui, paradoxalement, manifeste publiquement son philosémitisme.

Cet apaisement est de courte durée. Décrire la disparition de communauté entières, l’arrachement par les nazis d’un sol où elles vécurent des siècles, et pour les plus anciennes depuis 2000 ans, n’a jamais été fait pleinement -et ne peut l’être ici. Face au désespoir qui étreint toujours les rares rescapés et leurs descendants, les chiffres traduisent mal l’immensité du drame qui a frappé les 80 000 juifs de Grèce, dont 80 % furent victimes de la Shoah. Des 60 000 juifs de Salonique, il n’en restait plus que 1950 au lendemain de la guerre.
À partir de 1941, les Allemands commencent à appliquer des mesures antijuives. En 1942, la grande nécropole israélite, la plus ancienne et la plus vaste de toit l’Orient séfarade, est rasée avec la participation active des autorités locales et d’une partie de la populace. Sous la férule SS de Dieter Wisliceny, un lieutenant d’Eichmann, et d’Aloïs Brunner, en exil à Damas, la Solution finale est mise en oeuvre en 1943. Après avoir été parqués dans des ghettos, les juifs de Salonique sont déportés, en seize convois, à Auschwitz-Birkenau. Les Italiens et, dans une moindre mesure, les Espagnols déploient des trésors d’efforts pour sauver des vies juives.

illeurs qu’à Salonique, où l’indifférence et l’hostilité sont manifestes, les juifs trouvent dans une grande partie de la population, parmi la Résistance et au sein des autorités, des alliés courageux. L’archevêque orthodoxe d’Athènes, Mgr Damaskinos, intervient constamment en leur faveur et prend l’initiative de transmettre en 1943 aux Allemands des protestations signées par une trentaine de personnalités et responsables d’association. En Thessalie et en « vieille Grèce », sont Athènes, des centaines de juifs sont sauvés. Aucune loi antisémite n’est promulguée par le Parlement athénien pendant la guerre et le chef de la police de la capitale, Anghelos Evert, fornit de faux papiers à des juifs.
Volontaire dans l’armée britannique, le père de Shimon Peres, Yitzhka Persky, est parachuté en 1942 dans les montagnes de l’Attique. Capturé par les Allemands, il parvient à s’échapper et est hébergé pendant des mois dans le monastère de Hassia. À Zante, les 300 juifs sont tous protégés par le maire et l’archevêque, mais les autres communautés d’Épire et des îles ne peuvent échapper à la destruction. Sur les 2 000 juifs de Corfou, 120 échappent aux camps de la mort. En Thrace, 2 700 juifs sur 2 800 sont remis par les occupants bulgares aux Allemands.
Un demi-siècle s’est écoulé depuis la Shoah. Parmi les survivants, une grande partie a émigré en Israël ou aux États-Unis. Sur les 5 000 juifs grecs, 4 000 désormais vivent dans la capitale, et un millier est réparti entre Salonique et une poignée de villes. Un monument officiel a été érigé à Salonique en 2000 en mémoire des victimes de la Shoah.
Rencontre avec Zanet Battinou, Directrice du Musée juif de Grèce, au sujet du projet Hannah, luttant contre l’antisémitisme par l’éducation et le savoir.
Jguideeurope : Pouvez-vous npus présenter le projet Hannah ?
Zanet Battinou : Nous avons organisé une conférence nationale récemment, dans le cadre du projet « CHallenging And DebuNkiNg Antisemitic MytHs HANNAH, qui se concentre sur l’histoire, la culture et la vie juives, le phénomène de l’antisémitisme et les différentes approches pour le combattre dans cinq villes européennes : Athènes, Dresde, Hambourg, Cracovie et Novi Sad.

Y a-t-il des projets éducatifs proposés par le MJG et comment la ville d’Athènes participe-t-elle au partage de la culture juive ?
La ville d’Athènes organise habituellement des événements en octobre, date de la libération de la ville, qui comprennent des expositions ou des conférences basées sur des témoignages juifs. En outre, le 27 janvier, journée internationale de commémoration de l’Holocauste, de nombreux événements commémoratifs ont lieu. Cette année, le bâtiment du Parlement a présenté pour la première fois sur sa façade une diapositive lumineuse commémorant l’Holocauste.
Quels sont les aspects de la culture juive de la Grèce qui intéressent le plus les touristes d’été ?
En fait, nous avons remarqué qu’ils sont intéressés par la visite de tous les sites juifs dans les régions qu’ils visitent – à Athènes, le MJG est l’un de leurs principaux centres d’intérêt, ainsi que la synagogue.

Pourriez-vous partager avec nous une rencontre avec un chercheur ou un historien qui vous a particulièrement marqué ?
À la lumière de la prochaine présidence grecque de l’IHRA, l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste, une alliance internationale de 34 pays membres, qui vise à unir les gouvernements et les experts pour renforcer, faire progresser et promouvoir l’éducation, la mémoire et la recherche sur l’Holocauste dans le monde entier et respecter l’engagement d’un monde qui se souvient de l’Holocauste, d’un monde sans génocide, je voudrais évoquer ma rencontre avec le professeur Yehuda Bauer, historien de l’Holocauste et conseiller académique de l’IHRA.
J’ai eu l’honneur de participer aux réunions semestrielles de l’IHRA depuis la toute première à Stockholm en 2000, en tant que membre de la délégation nationale grecque, siégeant au groupe de travail sur les musées et les monuments commémoratifs de l’organisation et assumant le poste de président du groupe de travail en 2014, sous la présidence britannique. C’est ainsi que je suis arrivé à rencontrer le professeur Bauer et à partager sa sagesse et ses analyses perspicaces sur le terrible phénomène de l’Holocauste. Sa profonde compréhension et sa conviction de sa valeur éducative et sociale pour le monde contemporain ont été pour moi une source d’inspiration et de motivation cruciale.
Au cours des 20 dernières années, le MJG a lancé l’éducation sur l’Holocauste en Grèce et travaille en permanence avec le ministère de l’Éducation à la pointe de toutes les initiatives et actions pertinentes, en développant des programmes efficaces pour l’éducation à l’Holocauste, des séminaires de formation des enseignants et la création de nouveau contenu pour les manuels scolaires. Au cœur de cet effort important, se trouvent les paroles du professeur Bauer : « Ne soyez jamais une victime, Ne soyez jamais un agresseur, « Et ne soyez jamais, jamais, un spectateur ».
L’Autriche d’aujourd’hui, dans ses frontières actuelles, n’est plus qu’une petite partie de ce que fut l’empire autrichien, alors grande puissance continentale de la Mitteleuropa, héritier de l’Empire romain germanique, ayant contracté une alliance avec le royaume de Hongrie pour former une « double monarchie » impériale et royale (kaiserlich und königlich ou k. und k.). Nous traiterons donc ici de l’Autriche actuelle (Vienne principalement), sans perdre de vue que Vienne, jusqu’en 1918, a été la capitale d’un immense état pluriethnique qui comptait des régions (Bohême, Moravie, Hongrie, Transylvanie, Galicie, Bucovine, Balkans, etc.) où vivait une forte communauté juive, laquelle aura une influence croissante sur l’équilibre du pays et notamment en ce qui concerne la vie intellectuelle et culturelle de la capitale. Après la chute de l’empire austro-hongrois, ce sont des intellectuels juifs comme Josef Roth, né à Brody (Galicie), qui deviendront, comme l’illustrent leurs oeuvres, les nostalgiques les plus fervents de l’ancienne monarchie.

Les premières mentions écrites de la présence juive en Autriche remontent au XIIe siècle lorsque, après les premières croisades, les juifs furent chassés ou fuirent les persécutions des villes de la vallée du Rhin. A cette époque, l’empereur Frédéric II promulgua la Charte des Privilèges qui accordait une grande autonomie à la communauté juive de Vienne. À la fin du XIIIe siècle et durant tout le XIVe siècle, elle se développa et devint la plus importante de toutes les communautés germaniques, tant par sa démographie que par son rayonnement. L’influence des « Sages de Vienne » se répandit bien au-delà des limites de la cité, et ce pendant plusieurs générations. Parmi les personnalités marquantes de ce courant, on comptait Isaac ben Moses « Or Zaru’a » (appelé ainsi d’après le titre de son principal ouvrage), son fils Hayyim ben Isaac Or Zaru’a, Avigdor ben Elijah ha-Cohen et Meyer ben Baruch ha-Levi. En 1348-1349, à l’époque des persécutions consécutives à l’épidémie de peste noire, la communauté de Vienne fut épargnée et servit même de refuge aux juifs des autres régions accusés d’avoir empoisonné les fontaines.
Dès la fin du XIVe siècle, les persécutions contre les juifs se multiplièrent en Autriche. En 1406, prenant prétexte de l’incendie d’une synagogue, des citoyens s’attaquèrent aux maisons juives. Quelques années plus tard, à la suite d’un pogrom, de nombreux juifs furent massacrés, d’autres expulsés de Vienne et leurs enfants forcés à se convertir. Après ces persécutions, seuls quelques juifs demeurèrent dans une totale illégalité.

En 1512, on recensait douze familles juives à Vienne, qui se maintinrent tout au long du XVIe siècle. L’empereur Rodolphe II (1576-1612) autorisa l’établissement d’autres familles juives « de cour », de sorte qu’une communauté se constitua, avec une première synagogue (qui n’existe plus) et un cimetière, que l’on peut encore voir dans la Seegasse (9e Bezirk ou arrondissement), dont la tombe la plus ancienne remonte à 1582.
Pendant la guerre de Trente Ans (1618-1648), les juifs eurent beaucoup à souffrir de l’occupation de la ville par les soldats de l’armée impériale. En 1624, l’empereur Ferdinand II assigna la communauté juive à vivre dans un ghetto, qui se trouvait Unter Werd, dans l’actuel 2e Bezirk. Ce ghetto, qui exista jusqu’en 1670, était lié, en fait, à des privilèges accordés à la communauté juive et correspondait à une période faste de floraison et d’expansion. Parmi les rabbins éminents de cette période, on compte Yom Tov Lipman Heller, disciple du rabbi Loew de Prague, Shabetaï Sheftel Horowitz, lui-même rescapé des massacres de Khmelnitsky qui ravagèrent la Pologne en 1648. Des communautés juives se constituèrent aussi dans les provinces (Burgenland, Styrie, Basse-Autriche).
Au milieu du XVIIe siècle, une vague de haine antisémite submergea de nouveau Vienne. Les juifs les plus pauvres furent expulsés de la ville, les autres, dépossédés de leurs biens, furent finalement chassés au mois d’Av 1670. La Grande Synagogue fut transformée en église catholique. Quelques juifs se convertirent au christianisme pour échapper à l’exil forcé.

En 1693, Vienne, en déroute financière, décida de réadmettre les juifs en ses murs. Seuls les plus fortunés d’entre eux furent autorisés à résider dans la ville sous un statut de « sujets tolérés », et soumis à de fortes taxes. La pratique de la religion n’était admise que dans les maisons privées. Les fondateurs et les personnalités dominantes de la communauté étaient alors de riches « juifs de cour » tels que Samuel Oppenheimer, Samson Wertheimer et le baron Diego Aguilar. Grâce à leurs efforts, Vienne devint, au cours du XVIIIe siècle, le plus grand centre diplomatique et philanthropique juif de l’empire des Habsbourg. Et, conséquence du commerce avec les Balkans, une communauté séfarade s’établit et prospéra dans la ville dès 1737.

Sous l’impératrice Marie-Thérèse (1740-1780), les juifs souffrirent d’une législation particulièrement restrictive. Son fils Joseph II, en revanche, promulgua le Toleranzpatent (1781) qui, d’une certaine manière, ouvrit la voie à l’émancipation. En 1793, fut créée, à Vienne, une imprimerie hébraïque qui devint rapidement la plus importante d’Europe. À cette époque, les premiers signes d’assimilation en matière de vie sociale et familiale émergèrent dans la communauté.
Avec l’absorption de la Galicie, dès le premier partage de la Pologne (1772), l’Autriche héritait d’une communauté juive considérable (250 000 sujets juifs en Galicie au début du XIXe siècle, 800 000 personnes en 1900), qui constituait souvent une couche sociale intermédiaire entre l’aristocratie polonaise et la paysannerie. Avec le rattachement de la Bucovine (cédée en 1775 à l’Autriche par la Porte), les juifs vont constituer l’un des fers de lance de la germanisation de ces provinces éloignées, notamment à Czernowitz.

Le XIXe siècle est marqué par une émancipation croissante de la communauté juive qui sera scellée, en 1849, par l’égalité des droits (théorique) entre les différentes confessions. Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, la croissance de la population juive de Vienne est très rapide, en raison de l’arrivée massive de juifs d’autres régions de l’empire tells que la Hongrie, la Galicie et la Bucovine. Alors qu’en 1857 il n’y avait que 6 217 juifs à Vienne (2,16% de la population), ils étaient déjà 72 000 en 1880, soit 10 %, et plus de 100 000 au début du XXe siècle, la majorité d’entre eux s’installant dans la Leopoldstadt (2e Berzirk). Simultanément, l’antisémitisme, considéré comme une opinion politique comme les autres(dont l’un des représentants est le maire de Vienne Karl Lueger), se développe.
En 1923, la communauté juive de Vienne était devenue, par sa taille, la troisième d’Europe. Nombre de juifs commencèrent à accéder aux professions libérales. En 1926, une magnifique synagogue fut inaugurée (la première synagogue légale depuis 1671). Au tournant du siècle, existaient à Vienne quelque cinquante-neuf synagogues d’obédiences variées, ainsi que tout un réseau d’écoles juives. La ville connut alors l’apogée de son rayonnement culturel. De nombreux juifs s’illustrèrent dans tous les domaines artistiques et scientifiques. Parmi les grandes figures de cette époque, on compte les compositeurs Gustav Mahler, Arnold Schönberg, Anton Webern, les écrivains Franz Werfel, Stefan Zweig, Arthur Schnitzler, Josef Roth, Karl Krauss. Sigmund Freud découvre l’inconscient et fonde la psychanalyse, de nombreux savants juifs s’illustrent dans leurs domaines respectifs.

Vienne fut aussi le berceau du sionisme. Perets Smolenskin publia le premier journal sioniste Ha-Shahar en 1868 et Nathan Birnbaum y fonda la première association étudiante juive, Kadimah, en 1884. Theodor Herzl établit à Vienne le quartier général de l’Exécutif sioniste. Toutefois, avant 1932, les sionistes n’ont jamais été majoritaires dans la communauté. Ce n’est qu’après la première guerre mondiale que le mouvement gagne de l’influence auprès des juifs de Vienne.
Après la dislocation de l’empire en 1918, Vienne devient la capitale surdimensionnée et encore très vivant d’un minuscule État qui continue à puiser sa sève dans les anciennes provinces orientales et conserve une forte population juive.
En mars 1938, après l’Anschluss, la ville est aux mains des nazis. Les lois discriminatoires, promulguées en moins d’un an, furent relayées par une terreur dans merci et des arrestations de masse. Durant la Nuit de cristal (9-10 novembre 1938), quarante-deux synagogues furent détruites, des milliers d’appartements saccagés et pillés par les SA et les jeunesses hitlériennes, souvent dans l’indifférence des habitants. Une partie des juifs de Vienne parvint à émigrer avant la guerre mais nombre d’entre eux, trop pauvres pour émigrer à l’Ouest, retournèrent dans leurs anciennes provinces (Galicie, par exemple) où ils furent rattrapés, plus tard, par les nazis. Dès le début de la Seconde Guerre mondiale, les déportations vers la Pologne commencèrent. Les juifs furent d’abord envoyés au camp de concentration de Nisko, dans le district de Lublin (octobre 1939). Le dernier transport de masse eut lieu, en septembre 1942, à Theresienstadt (Terezín) puis à Auschwitz pour la plupart d’entre eux. En novembre 1942, la communauté juive de Vienne fut officiellement dissoute.
Immédiatement après la guerre, des camps de DP (deplaced persons) furent installés en Autriche pour les juifs rescapés des camps nazis, d’où la plupart partirent pour la Palestine et d’autres pays. Pendant longtemps, la communauté juive viennoise, proprement dite, ne s’est pas reconstituée, confrontée à l’antisémitisme larvé de la société et aux allusions mesquines de certains hommes politiques.
Depuis les années 1970, Vienne, du fait de sa situation de capitale d’un État neutre, est devenue l’une des plaques tournantes de l’émigration des juifs soviétiques puis russes, censés continuer leur route vers Israël ou les États-Unis mais dont certains finirent par rester. On les voit notamment se livrer à différents commerces près de la Mexicoplatz, non loin du Prater (2e Berzirk) et animer la nouvelle communauté juive. En l’an 2025, on estime la population juive viennoise à 10 000 personnes.
Le Portugal devient un royaume autonome avec Afonso Henriques, premier roi du Portugal (1109-1185) et fils du comte d’origine française Henri de Bourgogne. La communauté juive du nouveau royaume va alors connaître une histoire différente de celle de ses autres coreligionnaires de la péninsule Ibérique. En effet, le monarque, conscient de l’importance des communautés juives qu’il a libérées du joug musulman, leur accorde sa protection et confie à Yahia ben Yahia, qu’il nomme grand rabbin, le soin de collecter les impôts.

Jusqu’à la fin du XIVe siècle, les juifs sont relativement protégés. La rivalité, qui oppose les deux royaumes de la péninsule Ibérique à cette période, contribue à la prise de pouvoir d’une nouvelle dynastie, les Avis, ouvrant une ère de grande prospérité pour les juifs portugais, qui bénéficient de l’arrivée des juifs espagnols à partir de 1391.
Un âge d’or commence pour la communauté, parallèle à l’extension du Portugal vers l’Afrique et les Indes, en attendant les grandes découvertes. Vers 1279, le pays comptait trente et une judarias. Deux siècles plus tard, il y en a 135. Toutefois, cette période n’est pas sans connaître de tensions entre juifs et chrétiens, car la bourgeoisie marchande naissante craint beaucoup l’influence des juifs et de leurs capitaux.

Sous le règne de Jean Ier (1385-1443) sont promulguées des lois qui imposent un signe distinctif sur les vêtements et le couvre-feu de nuit dans les judarias. De loin en loin, de violentes crises explosent, comme l’attaque de la judaria de Lisbonne en 1445, qui fait beaucoup de victimes. De nombreuses conversions s’ensuivent. En 1492, avec l’édit d’expulsion des Rois Catholiques, le Portugal connait un afflux assez important de population. Le roi Jean II autorise les juifs à pénétrer au Portugal contre le paiement de huit cruzados par tête et un séjour limité à huit mois. À une population juive estimée à 30 000 personnes viennent ainsi s’ajouter 30 000 à 60 000 juifs espagnols, ce qui porte leur proportion de 6 à 10 % de la population totale.

Jusqu’en 1496, le pouvoir conserve une attitude ambigüe vis-à-vis de cette minorité, tiraillé entre la nécessité de ménager son puissant voisin et le souci de conserver, sur son territoire, une communauté toujours utile. Après des mesures très dures, comme la séparation des enfants des parents pour les élever dans la foi chrétienne et des pressions pour la conversion des adultes, le décret de décembre 1496 promulgue l’expulsion.
Le roi, devant la difficulté de trouver des navires en nombre pour assurer le départ des juifs, prend le parti de les convertir tous au catholicisme, en une cérémonie unique. En outre, en 1499, il ferme les frontières pour leur en interdire le franchissement. Il crée ainsi une société de christaos novos, qui auront un destin assez différent des conversos espagnols. Face au problème posé par cette minorité, et malgré l’union apparente des deux royaumes, les deux pays choisissent des approches très différentes.

Ces « nouveaux chrétiens» constituent un groupe homogène qui occupe des places importantes dans la société portugaise, tout en conservant ses traditions culturelles. Ce groupe en arrive à former une nation à part, d’où leur nom d’« hommes de la nation », qui deviendra « la Nation portugaise » lorsqu’ils s’installeront entre Bayonne et Bordeaux.
L’instauration de l’Inquisition, en 1547, autorise la poursuite, avec plus ou moins d’ardeur, des christaos novos qui pratiquent le judaïsme et, plus tard, des crypto-juifs.

L’union des deux royaumes, de 1580 à 1640, sous le règne de Philippe II d’Espagne, favorise les contacts entre conversos et christaos novos, liés par des réseaux familiaux ou commerciaux qui vont bien au-delà de la péninsule, pour atteindre Bayonne, Bordeaux, Londres, Amsterdam et l’Empire ottoman, où la diaspora judéo-portugaise est présente.
Au cours des grandes découvertes, le royaume s’ouvre à de nouveaux horizons. Les juifs portugais accompagnent ce mouvement. Ils s’installent aux Amériques. Ils participent aussi à cette période faste sur le plan intellectuel: le rabbin Guedella Negro est nommé physicien et astrologue du roi Don Duarte entre 1433 et 1451 ; Jafuda Cresques dit Jacques de Majorque, fils du cartographe et inventeur d’instruments de navigation Abraham Cresques, est invité par l’infant Henri le Navigateur à former les futurs pilotes; Abraham Zacuto, originaire de Castille, publie au Portugal, en 1496, un almanach perpétuel qui facilitera de nombreux voyages, dont celui de Vasco de Gama aux Indes (1497)… Par ailleurs, les imprimeries sont très florissantes; elles sont tenues par Eliezar Toledano à Lisbonne, et par Samuel Ortas à Leiria.
Rencontre avec Jean-Jacques Salomon, vice-président de l’association Hagada, en charge du projet du Musée juif Tikva de Lisbonne

Jguideeurope : On remarque ces derniers temps un intérêt croissant pour le judaïsme portugais, cela a-t-il favorisé l’évolution du projet du Musée Tikva ?
Jean-Jacques Salomon : Il ne fait pas de doute que la multiplication des recherches et publications scientifiques et historiques sur le sujet des juifs portugais associé à celui sur les Crypto-Juifs notamment en Europe et aux États-Unis, a déclenché un intérêt croissant à différents niveaux du monde culturel et éducatif portugais, mais aussi européen et américain.
Au Portugal, que ce soient les municipalités, notamment celles partie à la Red de Judarias, le Ministère de la Culture (qui a décerné à notre Association le label « d’Intérêt Culturel ») et même la Présidence de la République, chacun manifeste désormais son intérêt. L’obtention du label d’Utilité Publique pour notre projet est considéré comme une formalité. Le fort développement du tourisme culturel au Portugal, avant et après la pandémie, a également joué son rôle.
Comment Daniel Libeskind a-t-il intégré le projet et quelle est sa vision architecturale pour le Musée ?
Suite à la proposition de la Municipalité de Lisbonne en mars 2019 de nous attribuer (à l’époque nous étions simplement les représentants de l’Association des Amis du futur Musée d’Alfama), une parcelle de terrain de plus de 6000 m2 face au Tage et à la Tour de Belém, nous avons immédiatement décidé de relever nos ambitions. Faire appel à un grand architecte international en était la première étape. Une participation au Congrès de Musées Juifs Américains (CAJM) en mars 2019 nous a mis sur la voie de Daniel Libeskind. Sa venue à Lisbonne deux mois plus tard a achevé de nous convaincre, ainsi que les représentants de la Municipalité de Lisbonne, qu’il était bien l’homme de la situation.

Quelle fut la vision architecturale de Libeskind concernant le musée et comment a-t-il été accueilli par les autorités portugaises ?
En ligne avec une large part de ses créations sur le devoir de Mémoire que symbolisent, notamment les plans fracturés des Musées Juifs de Berlin, Dresde, San Francisco et Manchester, Daniel a, dès sa première visite à Lisbonne, imaginé reproduire dans le bâtiment du Musée le mot Espoir (Tikva). L’un des plus représentatifs de l’Histoire millénaire des Juifs Portugais faite d’Ombre et de Lumière. Ses premières esquisses en octobre 2019, faisant des lettres de Tikva, déclinées en hébreu les uniques murs de séparation du bâtiment, ont immédiatement conquis les représentants de la Municipalité de Lisbonne et de l’Association de droit privé Hagadá, créée pour développer le nouveau projet.
Il faut attendre le XIXe siècle pour que le judaïsme puisse à nouveau s’exprimer et se vivre librement sur la terre portugaise. Dans les années 1820-1830, des familles juives du Maroc viennent s’installer en Algarve et aux Açores. En 1860, une synagogue est élevée à Faro. En 1904, la synagogue Shaare Tikvah (« des Portes de l’Espoir ») est inaugurée à Lisbonne. Elle est toujours ouverte au culte. En 1920, le capitaine Barros Basto fonde la communauté de Porto et lance une grande opération de retour des crypto-juifs au judaïsme de leurs ancêtres. À lui seul ou presque, il accomplit une œuvre immense : synagogue, circoncisions, revue, conférences, cours, collège, etc. Il fait construire une superbe synagogue, inaugurée en 1936, qui existe encore et demeure consacrée au culte. En butte aux courants fascistes portugais de l’époque, il est poursuivi par un tribunal militaire sous de fausses accusations et dégradé. Il ne sera réhabilité qu’en 1997. À la même époque, l’ingénieur Samuel Schwartz découvre avec étonnement l’existence d’une communauté crypto-juive à Belmonte (dans la province de Guarda), que le judaïsme et l’histoire ont presque oubliée.
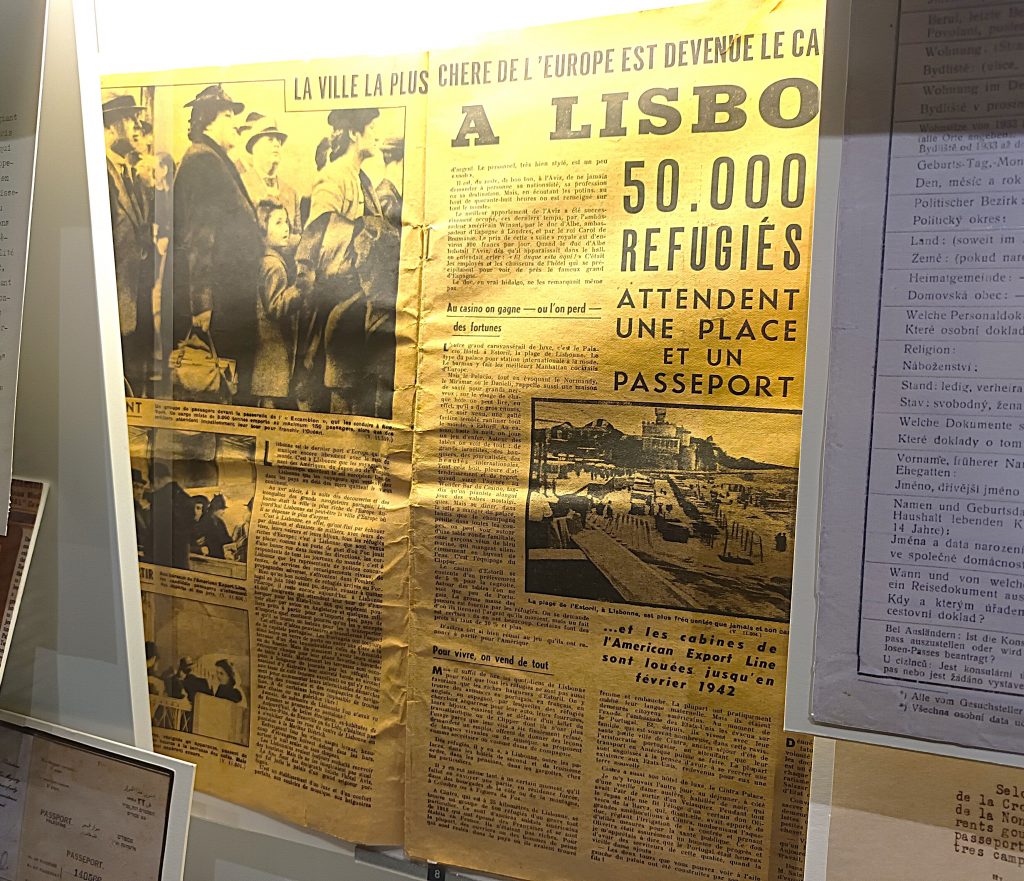
En 1940, le consul Mendes Sousa, en poste à Bordeaux, prend conscience du péril nazi et s’active pendant les quelques semaines de la débâcle pour fournir des visas, sauvant plusieurs milliers de réfugiés de la mort. Il meurt dans la misère, destitué et désavoué par les autorités officielles. Pendant la Seconde Guerre mondiale, malgré la sympathie du président Salazar pour l’Allemagne nazie, le Portugal protège les juifs portugais et apporte une aide à ceux qui parviennent à atteindre ce pays, officiellement neutre. En 1948, l’American Jewish Joint Comittee ouvre, avec l’accord du gouvernement, un centre d’accueil et de transit pour les juifs en partance pour les États-Unis.
En 1977, avec l’instauration de la démocratie, des relations diplomatiques sont établies avec Israël. En 1993, est posée la première pierre de la synagogue de Belmonte, qui sera inaugurée en 1996 à l’occasion de la commémoration de l’expulsion de décembre 1496. Aujourd’hui, quelques milliers de juifs vivent au Portugal, regroupés dans trois communautés principales : Lisbonne, Porto et Belmonte, et, sporadiquement, dans quelques autres villes.
Créées en 1992 par Anne Lima et Michel Chandeigne, les éditions Chandeigne, spécialisées notamment dans les récits de voyage et le monde lusophone, ont publié plusieurs ouvrages de références sur le patrimoine culturel juif. Parmi eux, Histoire des juifs portugais de Carsten Wilke, La Découverte des marranes de Samuel Schwarz, Sefardica de Yosef H. Yerushalmi et Consolation aux tribulations d’Israël de Samuel Usque. Rencontre avec Anne Lima.

Jguideeurope : D’où vous est venue l’idée de permettre aux lecteurs de (re)découvrir ce patrimoine culturel juif portugais ?
Anne Lima : C’est par notre travail sur l’histoire de l’expansion maritime européenne, notamment avec notre collection « Magellane », que nous nous sommes intéressés à la rencontre des trois religions du livre, ces trois cultures qui ont cohabité pendant des siècles en Espagne et au Portugal. Ce à quoi est dédiée notre collection « Péninsules », laquelle existe depuis presque 20 ans. En nous penchant sur le regard inter-religieux, il était impossible de ne pas constater l’extraordinaire richesse de la culture juive au Portugal. Non seulement certains aspects de cette histoire restent très peu connus mais elle diffère aussi de celle du pays voisin, l’Espagne. Je pense au marranisme dont l’histoire, le développement du phénomène et la mémoire démontrent une grande spécificité portugaise. Laquelle a laissé de multiples traces dans le patrimoine, notamment dans le Nord du Portugal, où ont été découvertes au début du xxe siècle de nombreuses communautés de crypto-juifs.

Le marranisme est un thème difficile à aborder et, comme vous le dites, spécifique à chaque pays. On trouve dans votre collection le Sefardica de Yosef H. Yerushalmi. En quoi représente-t-il une œuvre incontournable dans l’étude des marranes ?
Tout d’abord, on le sait bien aujourd’hui, l’apport de Yerushalmi dépasse largement les études juives, comme le dit si bien Sylvie-Anne Goldberg, se référant à la parution du livre de Yerushalmi Zakhor : « Il a amorcé un vaste examen du rôle de l’histoire dans les sociétés modernes, en s’interrogeant sur ses relations avec la mémoire collective. »
Concernant le marranisme, un des plus grands mérites de Yerushalmi, comme le souligne Yosef Kaplan (un auteur qu’on a publié dans « Péninsules ») est le décloisonnement qu’il a opéré pour contextualiser l’épopée marrane au sein de la crise de conscience européenne au début de l’époque moderne. Par exemple, dans un des articles de Sefardica, « Assimilation et antisémitisme racial : le modèle ibérique et le modèle allemand », Yerushalmi n’hésite pas à rapprocher la politique de pureté du sang espagnole et la définition nazie du Juif : « La pureté du sang en vint à se substituer à la pureté de la foi. » Enfin, selon Nathan Wachtel Yerushalmi est un pionnier lorsqu’il souligne à la fois la modernité marrane et la modernité du système inquisitorial ibérique. Dans la mesure où le système de délation, ainsi que les méthodes inquisitoriales, préfigureraient la rationalité policière des régimes totalitaires contemporains.

Quel lieux associés à ce patrimoine ont été particulièrement marquant pour vous ?
Ma découverte du monde juif et marrane au Portugal date des années 1980 et a été le fruit de mes études, d’une amitié avec Livia Parnes, à l’époque doctorante sur le marranisme au Portugal, et d’un enracinement familial dans la Beira Alta, région riche en patrimoine juif et marrane. Les trois villes ou villages qui m’ont le plus marqués et m’ont donné envie d’enrichir la collection « Péninsules », sont Belmonte, Trancoso et Guarda.
L’incroyable histoire de la découverte, en 1917, des familles marranes dans le village de Belmonte dans le nord-est du pays, par Samuel Schwarz, un ingénieur des mines polonais, a sans doute été déterminante pour ce lieu tout au long du XXe siècle et elle continue à l’être de nos jours. Les retentissements de cette découverte dépassent largement le phénomène religieux : ils touchent les rapports sociaux et politiques de la ville, changent le paysage culturel, contribuent à la recherche (nouvelles chaires universitaires dans la région), influencent le tourisme et les investissements économiques… Mais la découverte ne concernait pas seulement Belmonte. L’extraordinaire mouvement de rejudaïsation des marranes qui a suivi la découverte de Samuel Schwarz, intitulé « Œuvre du Rachat » et menée pendant plusieurs années par un homme hors du commun, le capitaine républicain, Artur Carlos de Barros Basto, qui résidait à Porto, a touché une dizaine de villes et de villages dans les régions de la Beira Alta et de Trás-os-Montes et a laissé des traces palpables notamment à Trancoso, Bragança (où l’on peut marcher dans le Rua dos Judeus), Covilhã et Porto.
L’autre lieu où le patrimoine culturel juif est particulièrement marquant est la ville de Tomar dans la région de Santarém. C’est dans cette ville des templiers que se trouve la synagogue probablement la plus ancienne du Portugal ; elle daterait du XVe siècle, avant la conversion forcée des juifs (1497). L’édifice a été découvert par Samuel Schwarz (en 1923), et c’est à nouveau grâce à lui que ce patrimoine exceptionnel a été sauvé. Puis, malgré tant de multiples péripéties, et de longues années, la synagogue a été entièrement restaurée et inaugurée solennellement cette année, en présence des représentants de la ville et de spécialistes d’études juives.

Est-ce qu’on constate des différences dans les villes sur cette curiosité et ce partage ?
Sans doute. Les secousses à Belmonte qui ont commencé déjà dans les années 1920 mais surtout, pour l’époque contemporaine, dans les années 1980, après la (re)découverte des marranes, ont donné lieu à une tentative de création d’une communauté juive, avec toutes les particularités voire la complexité qu’elle implique. En revanche, des villes comme Tomar et Castelo de vide, où l’histoire et le patrimoine juif sont très anciens, ne connaissent qu’un attrait touristique et elles sont entièrement désertées par les juifs depuis des années.

L’octroi de la nationalité aux descendants de juifs portugais et espagnols qui le demandent a-t-il changé la perception et la fréquentation de ce patrimoine culturel ?
Depuis l’entrée en vigueur de la loi, on estime à plus de 37 000 juifs séfarades le nombre des demandeurs de la nationalité portugaise. La plupart, âgés de 20 à 45 ans, viennent de Turquie et d’Israël, mais aussi du Brésil, d’Argentine et des États-Unis. À ce jour, presque 8 000 d’entre eux ont obtenu un passeport portugais par cette voie. Certes, ce passeport rend l’accès à l’Europe plus facile et, selon certaines personnes de la communauté juive à Porto et à Lisbonne, l’impact est déjà « visible » notamment par le tourisme « juif ». En effet, on peut lire assez régulièrement dans les journaux portugais des récits de visites et de visiteurs qui représentent des associations, venant « sur place » pour connaître les lieux, comme pour évaluer ce à quoi ils s’engagent (droits, impositions, etc.).
Belmonte reste un cas emblématique. Cette nouvelle forme de « tourisme » force les autorités municipales à prendre des initiatives, car le retour sur investissement peut s’avérer payant. Le problème est, aussi bien à Belmonte qu’à Tomar, qu’il n’y a pas encore suffisamment de ressources. Ainsi, on constate des opérations ponctuelles, sans une pensée globale, voire un programme structuré à long terme. Enfin, la situation à Belmonte est sans doute plus complexe, du point de vue de la direction de la communauté et des autorités religieuses. Les rabbins qui s’y installèrent bénéficiaient souvent de trop peu de temps pour comprendre au mieux les enjeux particuliers que représentent le lieu et la communauté.
L’arrivée des juifs en Espagne fait l’objet de nombreuses légendes, diffusées par les chroniqueurs juifs et chrétiens, au XVIe siècle surtout. Pour les uns, ils seraient arrivés à l’époque du roi Salomon dans le sillage des voyageurs phéniciens ; pour les autres, l’événement serait l’une des conséquences de l’exil de la population du royaume de Judée, ordonné par Nabuchodonosor.

Les historiens nous précisent, eux, que les premiers juifs arrivent d’une façon à peu près organisée après la destruction du Temple de Jérusalem, en 70 de l’ère chrétienne.
Ils s’installent d’abord sur la côte méditerranéenne, et se répandent peu à peu dans l’ensemble de la péninsule Ibérique. Le témoignage le plus ancien de la présence juive en Espagne est une inscription trilingue, en hébreu, latin et grec, sur un sarcophage d’enfant trouvé à Tarragone et datant de l’époque romaine (exposé aujourd’hui au musée Sefardí de Tolède). En outre, la mosaïque d’Elche (Ier siècle) recouvrait sans nul doute le sol d’une synagogue, ce qu’attestent les inscriptions grecques, ainsi que les dessins géométriques qui la composent. Enfin, des textes révèlent une présence juive en Espagne à la même époque : La Guerre des juifs de Flavius Josèphe (VII, 3, 3), La Michna (Baba Bathra, III, 2).
Sefarad ou l’Espagne juive
Le terme « Sefarad » apparaît dans la Bible, Obadiah, XX: « […] et les exilés de cette légion d’enfants d’Israël furent répandus depuis Canaan jusqu’à Sarepta, et les exilés répandus dans Sefarad posséderont les villes du Néguev » (traduction du Rabbinat français, Paris, Colbo, 1994). Depuis la fin du VIIIe siècle, le terme « Sefarad » désigne traditionnellement l’Espagne et les juifs espagnols. Par extension, il s’appliquera à tous les juifs des communautés du pourtour de la Méditerranée.
Jusqu’au VIIIe siècle, on sait peu de choses sur les communautés juives espagnoles. Sous les Romains, les juifs ont le même statut que dans le reste de l’Empire. Sous le règne des rois wisigoths, qui étaient aryens, les juifs sont tolérés et vivent beaucoup de l’agriculture. À partir de 586, date de la conversion au christianisme du roi Récarède, ils subissent pendant près d’un siècle des persécutions et des conversions forcées (ce qui a permis de parler de marranes avant la lettre). Le roi Egica envisage même de les réduire en esclavage.
À l’arrivée des Arabes, en 711, les juifs se mettent à leur service. Les Arabes sont peu nombreux et cherchent des alliés fidèles. Les deux communautés trouvent intérêt à s’entendre, d’autant plus que de nombreux juifs du Maghreb viennent renforcer la présence des Maures et des juifs de Sefarad. D’ailleurs, certains géographes arabes n’hésitent pas à déclarer que Grenade, Tarragone et Lucena sont des « cités juives », pour bien marquer l’importance de cette minorité. Le développement de la vie urbaine requiert commerçants et administrateurs, fonctions que les Arabes et les Berbères répugnent à exercer.
À partir de l’instauration du califat de Cordoue, en 929, commence un âge d’or du judaïsme en terre d’Islam. Abderahman III (912-971) prend pour médecin Hasday ibn Saprut, un juif originaire de Jaen, à qui il confie, en plus de sa propre santé, de nombreuses missions diplomatiques: contact avec l’abbé de Gorze, négociations avec les royaumes naissants de León et de Navarre… Hasday ibn Saprut est un courtisan très riche dont la vie sera chantée par les poètes Menahem ben Saruc et Dunas ben Labrat. Il fait traduire de nombreuses œuvres scientifiques du grec en arabe, et contribue beaucoup à l’épanouissement culturel de sa communauté. Au contact de la poésie arabe, les juifs composent de très beaux poèmes, s’investissent dans des études grammaticales; toute cette effervescence intellectuelle favorise l’éclosion d’une riche culture hébraïque.

Au XIe siècle, Grenade est la capitale du monde arabe en Espagne. Samuel haNaguid, ou le Naguid (993-1056), est le personnage clé de cette époque. Ce commerçant originaire de Malaga devient vite le dirigeant de la politique grenadine ; il n’hésite pas à conduire les troupes arabes dans leur combat contre Séville ou Almería. Également poète et rabbin très érudit, il favorise les arts et, en particulier, la poésie, tout comme son fils Yosef qui lui succédera à sa mort.
Salomon Ibn Gavirol
Ce grand poète (1022-1054), protégé du Naguid et de son fils, est l’auteur des 400 vers de La Couronne du royaume, hymne contemplatif dédié à Dieu et à sa création, qui a été intégré dans la liturgie de Yom Kippour par les communautés séfarades. Il écrit aussi en arabe La Source de vie, ouvrage philosophique où il examine les principes du néoplatonisme, que les musulmans réintroduisent alors.
On lui attribue également la prière Adon Olam, qui est récitée plusieurs fois dans les offices quotidiens de la semaine et du shabbat dans toutes les communautés juives du monde: « Maître de l’univers, qui a régné avant que rien ne fût créé. Lorsque, par Sa volonté, tout s’accomplit, Il fut proclamé roi. Et quand tout aura cessé d’être, Lui seul régnera avec gloire. Il fut, Il est, Il sera toujours avec majesté. Il est unique et sans second qu’on puisse Lui comparer ou Lui adjoindre. Sans commencement, sans fin, à Lui la force et la puissance. Il est mon Dieu, mon libérateur vivant, et le rocher de mon refuge à l’heure de l’adversité. Il est mon étendard et mon recours. Il me tend la coupe le jour où je L’invoque. En Sa main, je confie mon âme, quand je m’endors et quand je m’éveille. Et, avec mon âme, mon corps, Dieu est avec moi, je suis sans crainte. »
Cité in Dictionnaire Encyclopédique du Judaïsme, Paris, Editions du Cerf, 1993
C’est grâce à ces poètes que nous pouvons prendre la mesure du développement des communautés juives en terre d’islam et du mode de vie de ces courtisans, partagés entre l’amour des plaisirs, des belles lettres et des arts, et leur religion traditionnelle. Ils serviront plus tard de modèle à leurs coreligionnaires de Castille et d’Aragon.
Cependant, les luttes internes entre les divers royaumes arabes ainsi que la pression chrétienne qui s’accroît avec la reconquête de Tolède, en 1080, incitent les Arabes à demander l’aide des Almoravides d’Afrique du Nord qui envahissent le sud de l’Espagne. Les juifs échappent de justesse à la conversion forcée, mais endurent, en 1146, la nouvelle invasion des Almohades du Maroc, plus intransigeants. Ils interdisent la pratique du judaïsme et obligent les juifs à se convertir et à devenir des crypto-juifs. D’autres préfèrent l’exil vers les royaumes chrétiens voisins. L’Espagne musulmane se vide de ses juifs à l’exception de Grenade, dernier royaume maure.
L’Espagne chrétienne va mettre sept siècles pour reconquérir son territoire, aux mains du pouvoir arabe. Cette reconquête s’achèvera avec la prise de Grenade, en 1492, qui marquera très fortement les relations judéo-chrétiennes. En même temps que les victoires des royaumes de León, de Navarre, d’Aragon et de Catalogne, les vieilles communautés juives de Catalogne et d’Aragon se développent, ainsi que des petits groupes installés sur le chemin de Saint-Jacques. Les juifs colonisent les territoires reconquis et participent activement au commerce et à l’industrie textile.
En 1085, Alphonse VI reprend Tolède et marque ainsi la limite de la croix et du croissant. Les monarques chrétiens protègent les juifs, très utiles pour administrer les nouveaux territoires, pour lever les impôts et assurer les contacts en langue arabe. Les juifs s’enrichissent : ministres des Finances de Castille et d’Aragon, ils avancent aux rois les impôts.
Au XIIe siècle, toute l’Espagne est chrétienne, à l’exception de Grenade. Un nouvel âge d’or du judaïsme espagnol en terre chrétienne commence, en particulier sous les règnes d’Alphonse X le Sage en Castille, et de Jacques Ier en Aragon. Nouvelle Jérusalem, Tolède devient la capitale de la vie juive. On y trouve savants, talmudistes, grands rabbins et financiers. La Catalogne connaît aussi une période de splendeur, avec Nahmanide à Gérone et Salomon ben Adret à Barcelone. Les juifs ne se mêlent pas à la vie politique et ne mettent pas en danger les relations entre la chrétienté et l’islam. Sur le plan juridique, ils sont la propriété du roi, ce qui les protège tout en les mettant à sa merci.
Avec le succès de la reconquête, le pouvoir de l’Église est de plus en plus important, comme dans le reste de l’Europe. Le IVe concile du Latran (1215) décide des mesures antijuives, qui sont cependant appliquées avec une certaine souplesse en raison des nécessités politiques et de la lutte contre les derniers royaumes maures. En Aragon, les juifs sont écartés des fonctions publiques. En Castille, les Cortes font de nombreuses propositions pour limiter la liberté des juifs.
La peste noire, une certaine littérature polémique antijuive, et la participation des juifs à la guerre civile entre Pierre le Cruel et son frère bâtard, Henri de Trastamare, favorisent le rejet du judaïsme.
À cela, s’ajoutent une baisse de la foi et un relâchement des mœurs et de la pratique religieuse dans les couches les plus favorisées. Le dialogue judéo-chrétien prend un nouveau tournant, le monde chrétien envisage la conversion comme solution à la présence de cette minorité. C’est le temps de la célèbre controverse de Barcelone (1256), où Nahmanide ne triomphe qu’en partie du juif converti Pau Cristiani.
Tous les éléments sont en place pour l’explosion de violence orchestrée par l’archidiacre d’Ecija, Ferran Martinez, qui lance en 1378 une campagne contre les juifs. Ce mouvement s’intensifie lorsqu’il est nommé archevêque en 1390. Profitant de la mort de Jean Ier, le 4 juin 1391, il fomente une émeute qui aboutit à la destruction de la judería de Séville. Un grand nombre de juifs sont obligés de se convertir pour échapper à la mort. Le mouvement gagne, de proche en proche, toutes les juderías d’Andalousie et de Castille ; celles de Tolède et de Cordoue, les plus florissantes, sont très éprouvées. En juillet 1391, la vague atteint Valence, Majorque, Barcelone et Gérone où la vie juive disparaît.
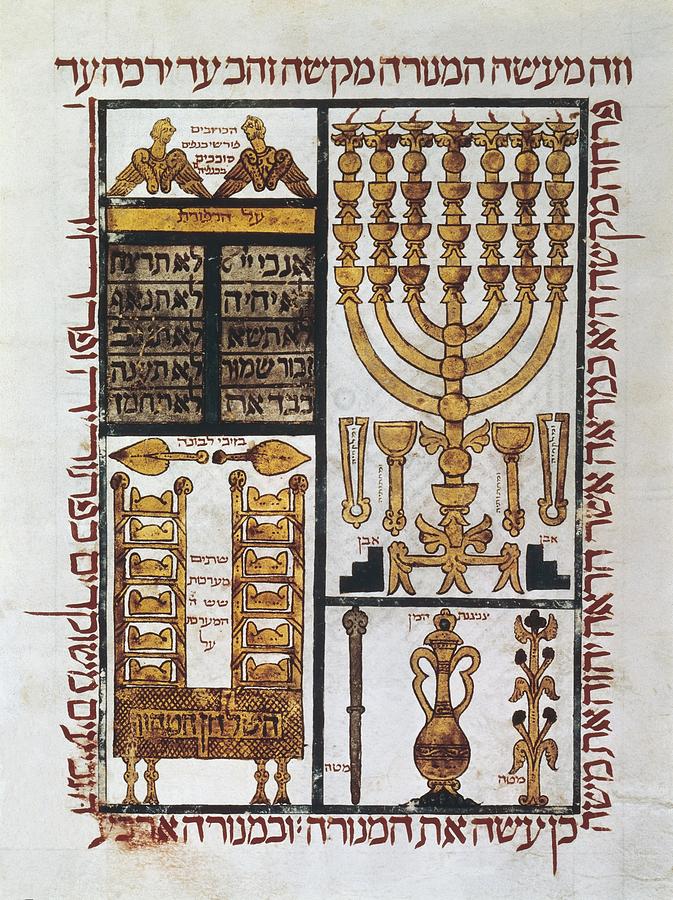
À la suite de ces massacres, la communauté juive offre un nouveau visage avec l’apparition du converso («converti»), dont les motivations et les espoirs sont très divers. D’une part, les conversos de force pratiquent en secret le judaïsme, ce sont les crypto-juifs, ou marranes; d’autre part, une partie des conversos profitent de l’occasion pour s’intégrer pleinement à la société chrétienne et accéder à toutes les charges qui leur étaient interdites. Enfin, certains éprouvent un désir sincère de devenir chrétiens à la suite de leur baptême forcé. La « dispute » de Tortosa, en 1413-1414, au cours de laquelle Zerahia Halevi et Joseph Albo débattent contre le nouveau chrétien, Jeronimo de Santa Fé (José Halorqui), sur les thèmes habituels de la polémique judéo-chrétienne, est peut- être l’une des dernières tentatives de convaincre les juifs par la raison. La société chrétienne s’interroge sur l’attitude à adopter vis-à-vis des juifs et des conversos. Elle décide de séparer les juifs des convertis, afin de faire de ces derniers de bons et sincères chrétiens et de les empêcher de revenir au judaïsme. C’est la mission qui est confiée, en 1480, à l’Inquisition. Thomas Torquemada, nommé inquisiteur général, en fait une institution terriblement efficace, pourchassant sans répit « sympathisants » du judaïsme et convertis, en Espagne comme en Amérique latine, les traînant devant les tribunaux, les punissant par la mort dans les autodafés, ou les condamnant de multiples manières.
Après la conquête de Grenade, Isabelle de Castille et Ferdinand d’Aragon signent le décret d’expulsion du 31 mars 1492, qui doit résoudre l’épineux problème que pose la présence juive, par la conversion ou par l’exil.
Le décret d’expulsion
Attendu que chaque jour il apparaît de façon manifeste et patente que lesdits juifs continuent à nourrir leurs malfaisants et pernicieux desseins là où ils vivent et communiquent avec les chrétiens, et pour qu’à l’avenir toute occasion d’offenser notre sainte foi soit ôtée aux fidèles que Dieu jusqu’ici a voulu préserver de cette faute, comme aussi à ceux qui l’ont commise mais se sont amendés et sont revenus dans le sein de notre sainte mère l’Église; ce qui pourrait aisément advenir en raison de la faiblesse de notre humaine nature, ainsi que de la malignité du pouvoir du démon qui sans cesse nous assaille, à moins qu’on ne fasse disparaître la cause principale de ce péril, autrement dit qu’on bannisse lesdits juifs de nos royaumes […]
Malgré les pressions des ministres des Rois Catholiques, Abraham Senior et Isaac Abravanel, le neuvième jour du mois d’Av, jour anniversaire de la destruction du Temple, les juifs abandonnent leur patrie. Abraham Senior accepte de se convertir. Isaac Abravanel accompagne ses frères dans l’exil qui les conduit en Afrique du Nord, au Portugal, dans l’Empire turc et en Europe (Italie, France, Angleterre, Pays-Bas). Ils y formeront la diaspora séfarade, fidèle à ses coutumes et à ses langues, le castillan et le catalan. Le chiffre des exilés reste difficile à déterminer. Environ 70 000 à 100 000 personnes préfèrent l’exil au baptême, soit entre le tiers et la moitié de la population juive de l’époque.
Au XVIIe siècle, l’Espagne n’a plus de juifs sur son territoire (à l’exception de la minuscule enclave d’Oran sur la côte africaine, où ils sont les interprètes indispensables à la survie de la garnison et dont ils ne seront expulsés qu’en 1669). L’Inquisition surveille les conversos avec la rigueur que l’on sait.
Un Résistant
Certains, comme Isaac (Fernando) Cardoso, parviennent à échapper à l’Inquisition. Né en 1604 au Portugal, il est médecin à la cour de Philippe IV. Intellectuel respecté, il connaît les plus grands de son temps, dont Lope de Vega, qui le tiennent pour l’un des leurs. Descendant de convertis par la force, Cardoso mène une existence ouvertement chrétienne et clandestinement juive. En 1648, au fait de sa gloire, il quitte brusquement l’Espagne et se réfugie en Italie. A Venise et à Vérone, il professe publiquement son judaïsme. Il publie, sous la signature d’Isaac Cardoso, l’un des plus beaux textes de l’apologétique juive : Las Excelencias de los hebreos.
Le souvenir de la présence juive n’a toutefois pas complètement disparu. Le comte Duque Olivares imagine de recréer une communauté juive à Madrid pour aider au développement de l’économie espagnole: il est certainement informé de l’activité lucrative des membres de la communauté d’Amsterdam, qui continuent à utiliser l’espagnol ; il doit cependant renoncer à son projet.
Au XVIIIe siècle, quelques penseurs prennent conscience de la perte causée par le départ des juifs. Il s’agit, selon eux, d’une partie importante du patrimoine culturel espagnol. C’est le cas de Joseph Rodriguez de Castro, qui édite, en 1781, une notice sur les écrivains et rabbins espagnols à partir du XIe siècle. Le roi Charles IV songe aussi à établir des juifs de Hollande en Espagne, et à annuler l’édit d’expulsion. Mais l’Inquisition veille. Il faudra attendre la guerre d’Indépendance et le mouvement libéral des Cortes de Cadiz pour que le Saint-Office soit aboli une première fois en 1813. Rétabli sous la Restauration, il est définitivement abrogé en 1834.

Au XIXe siècle, arrivent dans le nord du pays quelques négociants juifs, d’origine espagnole ou portugaise mais de nationalité française, qui viennent de Bordeaux ou de Bayonne pour le commerce des tissus. Il s’agit de cas isolés, que n’accompagne jamais la création de communautés organisées. Ce siècle est aussi marqué par l’épisode de la guerre d’Afrique et l’occupation de Tétouan, entre 1859 et 1862. En 1858, Ceuta, l’une des enclaves espagnoles au Maroc, est attaquée par des montagnards marocains. L’Espagne demande au sultan une réparation qui tarde à venir. La reine Isabelle envoie alors une expédition commandée par Prim et O’Donnell. Les troupes espagnoles occupent Tétouan, où elles sont accueillies par une population qui parle un espagnol mêlé d’arabe et d’hébreu… Ce sont les descendants des juifs expulsés en 1492 qui se sont maintenus presque miraculeusement dans cette petite ville. Jusqu’en 1862, l’occupation permet à la population juive d’être associée à la gestion de la ville et de s’élever socialement. On peut véritable ment parler de retrouvailles entre l’Espagne et ses juifs, car les journaux et les nombreux récits d’officiers font connaître au grand public l’événement, intéressant à la fois les historiens et les philologues qui retrouvent ainsi une langue telle qu’elle était parlée quatre siècles auparavant.
À Séville, à l’occasion de la visite du souverain Alphonse XIII en 1904, on note l’existence d’une petite communauté juive, originaire pour une grande part d’Afrique du Nord. Ils accueillent le roi dans leur rue (la rue Feria) avec une banderole en hébreu et en espagnol.
À partir de 1860, le docteur Angel Pulido (1852-1932) qui, au cours d’un voyage sur le Danube, a découvert des juifs d’Europe orientale parlant un espagnol un peu archaïque, lance plusieurs campagnes de presse et d’opinion pour faire reconnaître, en Espagne, les communautés de Serbie, Bulgarie, Roumanie et Turquie, toujours proches par leurs coutumes de Sefarad. Il publie deux ouvrages importants pour l’histoire récente des juifs d’Espagne : Los Israelitas españoles y el idioma castellano (1904) et Españoles sin patria, y la raza sefardi (1905). Il obtient l’autorisation de faire ouvrir des synagogues à Madrid (1917) pour 150 familles environ, et à Barcelone (1914) pour 250 personnes. L’action de Pulido se poursuivra par la création d’une association, Hispano Hebrea, en 1910, et par l’invitation faite en 1913 au professeur Abraham Shalom Yehuda pour enseigner l’hébreu à l’université de Madrid.
Par ailleurs, le leader sioniste Max Nordau, obligé d’abandonner la France en 1914 en raison de sa nationalité autrichienne, se réfugie en Espagne. Le roi Alphonse XIII interviendra personnellement auprès du Kaiser pour atténuer les persécutions et les violences faites aux juifs de Palestine. Après la Première Guerre mondiale, le mouvement de rapprochement avec les juifs prend de l’ampleur. Des personnalités politiques de premier ordre, le comte de Romanones, Melquiades Alvarez, Alejandro Lerroux, Juan de la Cierva, Niceto Alcalà Zamora et des généraux de l’armée s’associent publiquement à cet effort de reconnaissance.
En 1923, à la suite du traité de Lausanne, qui met fin au système des capitulations dans l’Empire ottoman et qui provoque un vide juridique pour certains protégés juifs, le gouvernement espagnol, dirigé par le général Primo de Rivera, publie le décret du 20 décembre 1924, qui concède, sous certaines conditions, la nationalité espagnole à des sefardim pour une période de six ans. Ce décret sera peu utilisé pendant sa période de validité, mais sera très utile pendant la Seconde Guerre mondiale.
Sous la IIe République espagnole (1931-1936), dont la constitution garantit la liberté religieuse et le caractère laïque de l’État, l’Espagne suscite un grand intérêt de la part des communautés juives européennes et orientales, qui y voient une forme d’abrogation de l’édit d’expulsion. Le 900e anniversaire du médecin et philosophe Maïmonide, célébré avec faste en 1935 à Cordoue, est la manifestation publique du retour de l’Espagne sur son passé juif.
Pendant la guerre civile, les communautés de Ceuta et de Tétouan au Maroc, et celle de Séville doivent payer de fortes amendes en faveur des troupes nationalistes du général Franco. L’influence des nazis ravive la propagande antisémite. Entre 7 000 et 10 000 juifs d’Europe, d’Amérique et de Palestine viennent combattre dans les brigades internationales, et ils n’hésitent pas à fabriquer et diffuser un petit bulletin en yiddish. À la fin de la guerre civile, la victoire des troupes franquistes entraîne la fermeture des synagogues de Madrid et de Barcelone, l’interdiction des mariages et des circoncisions, la fermeture des cimetières juifs et l’obligation de fréquenter les écoles catholiques pour les enfants.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’Espagne, neutre, devient le seul refuge en Europe du Sud devant l’avancée foudroyante des troupes nazies. Dans un premier temps, il est assez facile d’obtenir un visa de transit. Après l’armistice de 1940, des mesures espagnoles et françaises sont prises pour contrôler le flux des demandes, en particulier à travers le consulat espagnol de Marseille. Après juillet 1942, la sortie des juifs de France étant interdite, les passages deviennent clandestins, avec une certaine bienveillance espagnole. Il y a, cependant, des arrestations, et un camp est créé à Miranda de Ebro, où les prisonniers reçoivent une aide morale et matérielle de la part des organisations juives américaines installées à Madrid. Ces prisonniers seront évacués progressivement, vers Lisbonne et les États-Unis pour la plupart.

L’Espagne se trouve néanmoins confrontée, surtout en Europe orientale (Roumanie, Grèce, Bulgarie et Hongrie) et en France, au problème des juifs d’origine espagnole ou de nationalité espagnole (grâce au décret de 1924). Ces derniers réclament l’aide et la protection de l’Espagne au moment où leur propre gouvernement les abandonne aux nazis.
Grâce à l’action de plusieurs ambassadeurs consuls d’Espagne informés du sort réservé aux déportés, en particulier Sebastian Romero, Julio Palencia, Romero Radigales, Bernardo Rolland et Angel Sanz Briz qui harcèlent sans cesse leur ministère à Madrid, des visas individuels sont accordés, permettant ainsi à plusieurs milliers de personnes de fuir. Dans certains cas, comme en France ou en Grèce, les biens des juifs espagnols furent protégés par les autorités consulaires et restitués après la guerre.
La politique du général Franco et de ses ministres, sans être favorable aux juifs, n’est pas antisémite. Les autorités franquistes voient dans l’existence des juifs séfarades, le témoignage d’une période brillante de l’histoire de leur pays. Toutefois, dans la position de neutralité favorable à l’Axe, il reste primordial d’adopter une politique prudente, tenant compte des rapports de force entre les Alliés et l’Axe.
Paradoxalement, en 1941, l’Espagne décide la création de l’Institut Arias Montano, appelé à devenir, avec sa revue Sefarad, l’un des centres les plus réputés pour l’étude du judaïsme espagnol et de sa diaspora.
En 1949, une petite synagogue s’ouvre discrètement à Madrid, dans un appartement. En 1952, on procède de même à Barcelone. Bien que le catholicisme soit religion d’État, ces petites communautés sont tolérées. En 1967, une synagogue est construite à Madrid, la première depuis 1492. En 1978, la nouvelle constitution adoptée par les Espagnols garantit la liberté de religion et de culte à tous les citoyens. Aujourd’hui, il y a environ 12 000 juifs en Espagne, avec des communautés implantées à Madrid, Barcelone, Valence, Séville, Malaga et dans les enclaves du Maroc, Ceuta et Melilla.
Au musée juif de Budapest, la copie d’une tombe datant du IIIe siècle porte l’inscription d’une menorah. Ce vestige témoigne de presque 1700 ans de présence juive dans le bassin des Carpates, bien antérieure à celle des tribus magyares qui déferlent des confins de l’Oural au IXe siècle.
L’histoire moderne des juifs de Hongrie remonte au XIe siècle, avec l’implantation de juifs de Bohême, de Moravie, et d’Allemagne. Sous l’occupation ottomane (1526-1686), des dizaines de milliers de séfarades espagnols trouvent refuge dans l’Empire. Puis, la reconquête du pays par les Habsbourg (1686) déclenche une vague de pogroms. Considérés comme collaborateurs de l’occupant ottoman, les juifs sont massacrés ou expulsés. Ils ne reviennent qu’à la fin du XVIIIe siècle, incités par la politique de tolérance de Joseph II.

Dès lors, deux communautés différentes coexistent jusqu’au XXe siècle. L’une, venue de Moravie et d’Allemagne, s’implante à l’ouest du pays ainsi qu’à Budapest ; l’autre, composée essentiellement de hassidim, s’installe au Nord-Est. En 1840, les juifs de Hongrie sont les premiers à jouir de la liberté de commerce et d’entreprise dans l’empire des Habsbourg. La Hongrie compte alors quelque 340 000 juifs, qui s’engagent en masse dans l’armée lors de la guerre d’indépendance contre les Autrichiens en 1848-1849.
Les années 1860 voient le développement rapide de la ville de Pest, auquel les juifs prennent une part considérable. Parallèlement, les plus pauvres d’entre eux quittent leur village pour exercer de métiers de tailleurs, ferblantiers, tapissiers. Une sorte de « contrat social » tacite s’établit. La noblesse magyare se cantonne aux métiers de l’administration et de la politique, et laisse volontiers aux juifs la sphère industrielle et financière où ils apportent capitaux et savoir-faire. Avec la loi sur l’émancipation, tous les droits civiques sont donnés aux juifs en 1867. En échange, ils sont appelés à s’assimiler et se « magyariser » -comme la langue définissant alors la nationalité.
Mais, comme le souligne François Fejtö dans son ouvrage Hongrois et Juifs, histoire millénaire d’un couple singulier (Paris, Balland, 1997), « la classe historique magyare avait une autre raison d’accorder aux juifs les droits civiques. C’était le désir de renforcer le poids des magyarophones dans le pays où les Hongrois (…) n’arrivèrent à la faible majorité de 51,4% qu’à la fin du siècle, grâce à l’apport des juifs et Allemands assimilés. Aussi, le choix fait par les juifs prenait une importance particulière ; il faisait pencher la balance démographique côté magyar ». Fait capital, car le royaume magyar est confronté aux poussées nationalistes des minorités vivant sous sa coupe : croates, slovènes, slovaque. En dépit du schisme de 1870 entre juifs progressistes (néologues) et orthodoxes, le tournant du siècle marque l’âge d’or de l’assimilation. En 1900, 72% des juifs sont recensés comme magyars.

En 1910, Budapest compte 203 000 juifs -sans les convertis-, soit 23% des habitants, alors qu’à Vienne et à Prague, ils forment respectivement 8% et 5% de la population. Entre les deux guerres, ils représentent 6% de la population, mais la moitié des commerçants, industriels et banquiers sont juifs. En 1940, ils détiennent 40% de l’immobilier à Budapest. En 1919, le démembrement de l’empire des Habsbourg change radicalement la donne. Mutilée par le traité de Trianon (1920), la Hongrie perd les deux tiers de son territoire. Le très conservateur régent Horthy prend les rênes du pays. Les juifs deviennent la cible d’un antisémitisme croissant, et la Hongrie est la première à introduire les lois-antijuives, notamment le numerus clausus de 1920, qui, il est vrai, n’est pas toujours appliqué.
La politique irrédentiste de Horthy le pousse à s’allier à Hitler. Le début de la guerre lui donne raison, puisque le pays regagne ses provinces perdues. Horthy résiste quelque temps aux pressions de Hitler, mais lorsque les nazis occupent le pays en mars 1944, il nomme un gouvernement pro-nazi, et plusieurs centaines de milliers de juifs sont déportés. « Seule la participation zélée et plénière de l’appareil policier hongrois nous a permis d’achever cette tâche en moins de trois mois », déclare Veesenmayer, plénipotentiaire de Hitler en Hongrie. Spoliés de tous leurs biens, 600 000 juifs hongrois -sur un total de 900 000- sont déportés. La quasi-totalité des juifs de province est anéantie, mais la moitié des budapestois (environ 120 000) survivent à l’holocauste. De nos jours, la communauté juive est estimée à 100 000 personnes qui vivent essentiellement à Budapest. Le réveil de l’identité juive est indéniable. Journaux, écoles et associations, orchestres klezmer témoignent, toutefois, d’une renaissance plus culturelle que religieuse, et ce d’autant plus que, tabou sous le socialisme, un antisémitisme diffus a refait surface au début des années 1990. La société hongroise n’a pas réglé ses compte avec l’histoire, et François Fejtö remarque que « personne n’a exprimé, au nom de la nation, sa condamnation et sa honte à l’égard des hongrois complices et les manuels d’histoire restent étonnamment laconiques à ce sujet ».
We Budapest !
Visitez le patrimoine juif de Budapest et de la Hongrie avec la guide expérimentée Brigitta Ladányiné Zemba et profitez de 10% de réduction avec le code « JGuide Europe » !
Il y a aujourd’hui près de 15 000 juifs suédois. La plupart vivent à Stockholm. Les autres communautés sont principalement situées à Malmo, Goteborg, Lund, Helsingborg, Boras et Uppsala.

Des synagogues sont présentes dans les trois premières villes du pays. Il y a des cimetières juifs à Gotand, Kalmar, Karlkrona, Karlstad, Larbro, Norrkoping et Sundsvall.
Bien que la présence de juifs en Suède soit bien antérieure, notamment à Goteborg et Stockholm, une communauté n’y fut établie que dans les années 1770. Aaron Isaacs, graveur d’origine allemande s’établissant à Stockholm, fut le premier juif à être autorisé à y vivre en tant que tel à cette époque sans être obligé de se convertir au christianisme.

L’île de Marstrand, située à proximité de Goteborg, autorisa la venue de populations d’autres pays ou autres religions. Dans cet élan, la ville de Goteborg autorisa en 1782 l’installation de juifs.
Les autres villes qui autorisèrent leur venue furent Norrkoping et Karlskorna. En cette même année fut accordée la permission de construire des synagogues dans ces villes.
En 1840, on estime à 900 le nombre de juifs suédois. À cette époque, le Roi Charles XIV accorda de nombreux droits civils aux juifs. Une fois cet accès à la citoyenneté et aux droits égaux, les juifs rencontrèrent rarement de l’antisémitisme.

Cette évolution motiva la venue de juifs de pays voisins, plus inquiets pour leur sort, notamment de Russie et de Pologne. Ainsi, la population juive de Suède augmenta pour atteindre le nombre de 6500 en 1920.
Dans la période de l’entre-deux-guerres, des mesures plus restrictives furent mises en œuvre pour limiter l’immigration juive. De 1933 au début de la guerre, seuls 3000 juifs furent autorisés à s’y installer, principalement d’Allemagne, d’Autriche puis de Tchécoslovaquie, les lieux conquis par le régime nazis.
Néanmoins, pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux Suédois s’impliquèrent dans le sauvetage des juifs. En 1942, 900 juifs norvégiens obtinrent la permission de s’installer en Suède. Et bien sûr les deux courageuses opérations de sauvetage.

Tout d’abord celle concernant les 8000 juifs danois qui y trouvèrent asile grâce au courage de la population de leur pays. Puis, les vaillants efforts menés par le diplomate suédois Raoul Wallenberg qui permirent de sauver des milliers de juifs hongrois. Il faut néanmoins mentionner que certaines entreprises suédoises adoptèrent une autre attitude et commercèrent avec l’Allemagne.
La communauté juive se développa après la guerre, notamment grâce à l’arrivée de juifs de pays communistes, principalement de Pologne et de Tchécoslovaquie.

Néanmoins, dès la fin des années 1980, des discours et des attaques néo-nazies et islamistes contre les juifs se propagèrent. Ce qui encouragea les institutions politiques suédoises à mettre en place des projets éducatifs pour combattre les préjugés antisémites et racistes. Notamment grâce à l’université d’Uppsala.
Ce qui n’empêcha pas la montée des attaques antisémites dans tout le pays, en forte hausse dans les années 2010. Qu’il s’agisse de l’attaque aux cocktails Molotov par des islamistes de la synagogue de Stockholm. Un an plus tard, ce fut la maison d’un politicien juif de Lund qui fut brûlée. D’où la décision du Premier ministre Stefan Lofven d’ajouter d’autres programmes éducatifs mais aussi d’augmenter les peines encourues pour antisémitisme.
En 2017, lors d’une manifestation islamiste à Helsingborg, de violents slogans antisémites furent prononcés sous couvert « d’antisionisme ». À Umea, un centre culturel juif fut fermé en 2017 suite au vandalisme subi dans ses locaux et les nombreuses menaces reçues. A Norrkoping, lors des célébrations de Pessah en 2021, des poupées ensanglantées furent accrochées sur la synagogue…
Jusqu’à la fin du Moyen Âge, aucun juif ne fut présent en Norvège, gouvernée par le Danemark jusqu’en 1814. Ce n’est qu’au début du 19e siècle, qu’ils s’installèrent très timidement, notamment des juifs séfarades.

Henrik Wergeland (1808-1845), fils de pasteur et étudiant en théologie, fut connu pour sa poésie et ses engagements politiques en matière de droits de l’Homme, expression qu’il utilisa très régulièrement cent ans avant la Charte des Nations Unies. Parmi ses préoccupations, le sort des juifs, exclus du royaume de Norvège depuis 1814. Il Il s’adressa à quatre reprises au parlement pour qu’il annule cette interdiction. Un combat qu’il mena aussi dans son œuvre poétique, en décrivant les juifs et leur culture. En 1851, six ans après la mort de Wergeland, le parlement vota aux deux-tiers la fin de cette exclusion. En 2003, une grande exposition lui fut consacrée.
Suite à la décision du Parlement norvégien, les juifs s’installèrent timidement dans le pays, la plupart furent originaires d’Allemagne. A la fin du 19e siècle, ce fut le cas des juifs d’Europe de l’Est, fuyant les pogroms, principalement de Russie, Pologne et des États baltes. Les conditions de vie très difficiles à l’époque motivèrent le départ de très nombreux Norvégiens et de réfugiés juifs qui y transitaient vers les États-Unis. On estime à 800 000 le nombre de migrants norvégiens vers l’Amérique entre les années 1880 et 1920, pour un pays qui ne comptait qu’un peu plus de 2 millions d’habitants.

Une grande partie des juifs norvégiens exercèrent le métier de marchand ou d’artisan, accompagnant le développement économique du pays. Suivant l’évolution de leur intégration, les juifs purent diversifier les métiers pratiqués, notamment dans la médecine et la culture, à l’image du violoniste Jacques Maliniak (1883-1943). Ils habitèrent essentiellement à Oslo et Trondheim, ainsi que dans soixante-deux autres municipalités, en nombre très bas dans ces cas-là. Ainsi, il n’y avait que 25 juifs norvégiens en 1866, puis 214 en 1890 et 642 au tournant du siècle.
À la veille de la Seconde Guerre mondiale, les juifs furent totalement intégrés à la société, adoptant le norvégien comme première langue et vivant à l’heure norvégienne. Ils participèrent à tous les secteurs dans les milieux économiques et culturels. Le parti nazi de Quisling, à la solde de l’occupant allemand, entama très rapidement une campagne de dénigrement des juifs et de confiscation de leurs biens. Des fichiers, préparés même avant le déclenchement de la guerre, permirent d’identifier les lieux où vécurent les juifs. Le 6 octobre 1942 débutèrent à Trondheim les premières arrestations en masse des juifs norvégiens. Ceux-ci tentèrent de s’opposer à ces actes, notamment Moritz Rabinowitz, philanthrope et éducateur dans les milieux populaires, qui fut assassiné, ainsi que sa famille. Le courage de Résistants norvégiens permit de sauver de nombreux juifs, les aidant à fuir le pays par la frontière suédoise. Pendant la Shoah, plus d’un tiers des 2 200 juifs norvégiens furent déportés. Seuls 29 d’entre eux y survécurent.

Au lendemain de la guerre, les juifs norvégiens fondèrent une nouvelle communauté. Parmi ces survivants, Kai Feinberg, qui raconta également dans son autobiographie comment cela fut douloureux pour lui, seul survivant de sa famille, de retourner « chez lui » et de constater que les habitations des juifs avaient été redonnées à d’autres familles.
Suite à des articles sur ces spoliations parus en 1995, les autorités norvégiennes étudièrent le sujet et votèrent en 1999 une indemnisation pour les juifs norvégiens, un des premiers pays européens à résoudre cette injustice. Les juifs norvégiens représentent aujourd’hui moins de 2000 personnes dans tout le pays, principalement à Oslo et Trondheim. Depuis 2009, les juifs sont notamment la cible d’une résurgence d’un antisémitisme portant différents masques, comme dans de nombreux autres pays européens.

La communauté peut s’enorgueillir d’avoir donné à Israël un ministre : le grand rabbin Michael Melchior, devenu député en 1999, puis membre du gouvernement Barak, chargé des relations avec la diaspora.
Quoique strictement orthodoxe, le rabbin Melchior, fils de l’ancien grand rabbin du Danemark Bent Melchior, appartient au parti de centre-gauche Meimad.
Sources : Jewish Life and Culture in Norway : Wergeland’s Legacy, Encyclopaedia Judaica, Times of Israel
La communauté juive de Lituanie ne compte plus qu’environ 6 000 personnes. Elle n’est donc plus que l’ombre de ce qui fut, jusqu’à la Shoah, un des cœurs du Yiddishland.

D’une certaine manière, tout est parti d’ici, dès les XVe et XVIe siècles, lorsque le centre de gravité du judaïsme européen se déplaça d’Allemagne et de France vers la Pologne et la Biélorussie. En réaction au courant populaire et piétiste des hassidim au milieu du XVIIIe siècle, émerge le courant intellectualiste et rigoriste des mitnaggedim, personnifié par le Gaon de Vilna (1720-1797).
La Lituanie, tour à tour indépendante et puissance régionale, ensuite soumise à l’influence des chevaliers teutoniques, puis placée sous domination polonaise, fut finalement divisée entre un centre historique autour de la capitale, sous domination russe, et une région autour de Klaipeda (Memel), soumise à la Prusse.

Alors qu’à partir du milieu du XIXe siècle, malgré la politique de russification forcée, la renaissance nationale commence, passant principalement par le renouveau d’une langue qui est la plus ancienne d’Europe, les communautés juives, immergées dans un pays profondément catholique, font fleurir nombre de yeshivot. Celles-ci façonnent le paysage religieux de l’orthodoxie juive, comme celles de Ponevej et de Kovno (Kaunas).
Cependant, la Lituanie n’est pas seulement un centre religieux, c’est aussi le berceau d’une culture juive laïque de langue yiddish : le mouvement ouvrier socialiste Bund est créé à Vilnius en octobre 1897.
Lors du recensement de 1924, on dénombrait 155 000 juifs, soit 7,65 % de la population, auxquels s’ajoutaient encore quelques milliers de karaïtes.
Soumis à un antisémitisme séculaire, le judaïsme lituanien a été totalement anéanti par la Shoah, qui a bénéficié de nombreuses complicités dans la population locale.
La Lituanie a effectué depuis son indépendance un travail considérable concernant la mise en valeur du patrimoine culturel juif. Notamment en restaurant des synagogues, parmi lesquelles celle de Pakruojis, gravement endommagée. De nombreuses anciennes synagogues ont été rénovées et transformées en institutions culturelles. Aujourd’hui, elles sont utilisées par la population locale tout en conservant leur identité.
Le gouvernement lituanien a déclaré 2020 « Année du Gaon de Vilna et de l’histoire des Juifs en Lituanie » en l’honneur du 300e anniversaire de la naissance du grand érudit de la Torah, Rabbi Eliyahu Ben Shlomo Zalman, plus connu sous le nom de Gaon de Vilna.