
En 2010, suite aux célébrations du centenaire de la synagogue de Vincennes – Saint-Mandé a été publié un livre écrit par Dominique Jarrassé, avec la participation d’Elie Zajac, en hommage à cette belle synagogue et à son esprit fraternel.
Laurent Lafont, maire de Vincennes, et Patrick Baudouin, maire de Saint-Mandé, ont écrit d’émouvants textes au début du livre, rappelant à la fois l’âge d’or des synagogues, leur évolution à travers le temps et surtout l’esprit de la République française dont témoigne depuis un siècle la communauté juive locale et les valeurs partagées.

La préface est écrite par Bruno Blum, président de la synagogue ashkénaze et Dov Houri, président de la synagogue sépharade. « Étonnant, non ? », comme pourrait dire Pierre Desproges… Pas tant que ça lorsqu’on connaît l’esprit de la synagogue de Vincennes – Saint-Mandé, celui de réunir depuis des décennies des juifs issus à la fois des anciennes communautés ashkénazes d’Alsace-Lorraine, d’Europe de l’Est et ceux d’Afrique du Nord. De disposer de plusieurs salles de prière, chacune respectant un rite et surtout en partageant une perception ouverte et généreuse du judaïsme.
En 1872, un recensement indique qu’il y a 108 juifs à Vincennes et 84 à Saint-Mandé. Auxquels s’ajoutent une poignée de juifs de Montreuil, le tout formant la première communauté juive de Vincennes – Saint-Mandé. Avant de bénéficier d’une synagogue, ils priaient dans un oratoire créé par le rabbin Maurice Zeitlin et situé au 21 avenue Gambetta à Saint-Mandé.

Arthur Willard, né en 1873 à Ingwiller, est le premier rabbin à être nommé à la tête de la communauté de Saint-Mandé en 1902. Un terrain est acheté pour la construction de la synagogue , avec les dons des fidèles et grâce à l’aide du Consistoire. Sur lequel est bâti la synagogue, grâce au don du grand mécène Daniel Iffla, dit Osiris.
Né à Bordeaux en 1825, Osiris est originaire d’une famille modeste. Il s’installe à Paris afin de travailler dans la finance, où il connaît un grand succès. Dans les années 1860, il décide de se consacrer pleinement à la philanthropie, au mécénat et à l’art. Dans cet élan de générosité et de patriotisme, il participe à la construction de la synagogue Buffault à Paris, mais aussi à la création d’un pavillon opératoire pour les femmes à la Pitié-Salpêtrière, un institut sérothérapique à Nancy, un bateau-soupe à Bordeaux pour nourrir les pauvres… Osiris fera également de l’Institut Pasteur son légataire universel.

Il faudra attendre le 5 septembre 1907 pour que soit inaugurée officiellement la synagogue de Vincennes – Saint-Mandé, œuvre de l’architecte Victor Tondu. Le pavement en mosaïque situé devant la bima comporte d’ailleurs l’inscription « Tishri 5668 » en référence à la nouvelle année juive qui accueille l’inauguration de cette synagogue. Cette année fut également celle du décès d’Osiris, survenu en février 1927. D’ailleurs, le Grand Rabbin Dreyfus, lors de son allocution, rendit un vibrant hommage au mécène. En rappelant son patriotisme, son engagement et sa générosité.
Le rite pratiqué à cette époque à la synagogue est alsacien, en conformité avec une grande partie des Juifs habitants Saint-Mandé et Vincennes, originaires d’Alsace. Dans l’entre-deux-guerres s’installent de nombreuses familles juives originaires d’Europe de l’Est, principalement de Pologne, de Russie, de Roumanie et de Hongrie. Ce qui permet aux communautés de la banlieue Est de Paris de grandir. En particulier celles de Montreuil et de Bagnolet. Ainsi, il est estimé que près de 1000 juifs vivent à Vincennes en 1936. Les juifs russo-polonais forment alors environ un tiers des juifs de Vincennes. Signe de cette évolution démographique, en 1938, Wolf Gordon devient président de la Communauté. Cordonnier en Russie et même bottier du tsar, il était arrivé en France en 1906, suite aux pogroms.
Les troupes allemandes entrent à Vincennes le 14 juin 1940. Sur les 874 déportés de Montreuil, Bagnolet, Vincennes, il n’y aura que 27 survivants à la Shoah. Parmi ces victimes, de nombreux enfants, comme le rappelleront les plaques commémoratives posées bien plus tard.

Au lendemain de la guerre, la communauté juive de Vincennes – Saint-Mandé se reconstruit graduellement. Notamment grâce à l’arrivée de juifs d’Afrique du Nord dans les années 1950. Laquelle s’accélère suite à l’indépendance de l’Algérie. Ainsi, fin 1962, 150 familles sont installées à Vincennes. Les premiers fidèles arrivants sont fédérés en 1959 par les frères Marouani dans un petit local attenant à la synagogue ashkénaze. Ainsi, une quarantaine de personnes participent à l’office, assuré par les frères Alain et Michel Chetboun.
Joseph Guez prend alors la direction de cette communauté. Les Ashkénazes, ainsi que la mairie de Vincennes sont très actifs pour aider ces nouveaux arrivants. À titre d’exemple, en 1967, Jules Schick, informé des soucis financiers de la tentative de Joseph Guez d’organiser une colonie de vacances pour les enfants sépharades arrivés récemment, couvrira sur le champ les frais nécessaires.

Cet esprit très fraternel se concrétise aussi d’une autre manière lorsqu’en 1965 est créée l’association de jeunesse « Hatikvah », unissant Ashkénazes et Sépharades.
Suite à l’accroissement de la présence des fidèles, le local sépharade est agrandi en 1965, à nouveau en 1975, puis encore une fois en 1982. De nombreux projets sont étudiés afin de construire une synagogue sépharade viable juste à côté de la synagogue ashkénaze.

En 2000, l’architecte Jacques Emsallem dépose un permis pour agrandir la synagogue. Lorsque le permis est obtenu, une possibilité d’achat des entrepôts Bardoux, situés en face de la synagogue, se présente. L’achat de ce local s’avère moins cher qu’une profonde modification architecturale de la synagogue et représente un gain de surface. La communauté a donc acheté ce local et effectué des travaux moins conséquents dans la synagogue. Les prières se déroulent dans le local le temps de réaménager la synagogue, le local devenant par la suite un centre communautaire. Les dirigeants Paul Fitoussi et Léo Touitou étaient très impliqués dans ce projet.
Le 7 janvier 2015, les dessinateurs de Charlie Hebdo et les policiers qui les protègent sont victimes d’un attentat terroriste. Le lendemain, une policière est également assassinée par un autre terroriste à Montrouge. Le 9 janvier, ce même terroriste assassine quatre juifs retenus en otage dans le supermarché Hypercacher situé porte de Vincennes.
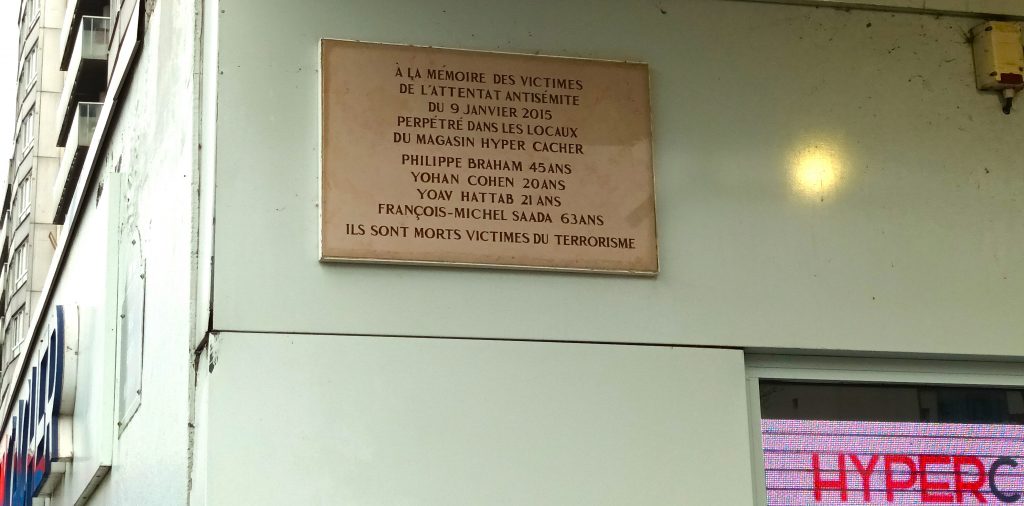
En 2025, les deux rabbins des synagogues ashkénaze et sépharade sont respectivement Joseph Assayag et Hay Krief. Y sont expliqués et partagés les différents minhagim, airs de prières et traditions dans ce même esprit fraternel. Deux communautés très vivantes où sont régulièrement organisés les shabbats, les fêtes et de nombreuses activités cultuelles et culturelles. La synagogue ashkénaze de Vincennes-Saint-Mandé est actuellement la seule de la région parisienne, en dehors de Paris bien entendu, à suivre ce rite aujourd’hui.
Une douzaine d’autres petits lieux de culte existent également aujourd’hui à Vincennes-Saint-Mandé. Et comme le soulignent dans leur livre Dominique Jarrassé et Elie Zajac, ces juifs issus d’Alsace, de Russie, de Pologne, de Turquie, d’Afrique du Nord, se fondent harmonieusement en « tsarfatim », Français de confession juive.
Un texte écrit grâce à l’aide du rabbin Joseph Assayag et d’Élie Lobel.
La synagogue de Boulogne est située sur la partie excentrée de la rue des Abondances, un peu après l’école Maïmonide.

Elle a été construite en 1911, selon les plans de l’architecte Emmanuel Pontremoli. Sa forme géométrique est particulièrement originale, répondant aux goûts de l’époque de sa création.
Les références byzantines de la synagogue sont proches de celles de la synagogue de Chasseloup-Laubat. Le peintre Gustave-Louis Jaulmes en a décoré les motifs. On remarque la forte présence de lumière dans ce cadre apaisant.
Non loin de là, le Musée départemental Albert Kahn . Né grâce à l’ambition du philanthrope juif du même nom, il souhaitait y réunir la végétation des quatre coins du monde. Ces « archives de la planète » ont été rassemblées pendant plus de deux décennies, de 1909 à 1931.

Cela, dans un monde qui vécut une guerre et qui courrait à sa prochaine. Motivations supplémentaires pour Albert Kahn d’y permettre la coexistence exemplaire de la végétation du monde, tandis que l’homme s’acharnait dans sa folie meurtrière.
Parmi ses trésors, les visiteurs sont particulièrement attirés par le jardin japonais. Cerisiers en fleur, pont, cours d’eau et sérénité assurée.
Poursuivez votre promenade pour découvrir les jardins anglais et français, puis les épicéas du Colorado ou les cèdres de l’Atlas. Les jardins Albert Kahn constituent un véritable parc d’attractions naturelles.

Nice est connue comme un des joyaux de la Côte d’Azur, entre sa longue promenade, sa vieille ville, son architecture et ses couleurs, mêlant les beautés italiennes et françaises.
La présence juive niçoise date probablement de l’époque grecque. Les occupations successives, liées principalement aux conflits entre la France et l’Italie, affectèrent le statut des juifs le long des siècles.
Une présence juive est recensée au milieu du 14e siècle. Nice dépendait alors de la Provence et les juifs furent obligés de porter un signe distinctif.
En 1406, la communauté juive dispose d’un statut officiel, alors que la ville appartenait à nouveau à la Savoie. Deux ans plus tard, elle dispose d’un cimetière près du port Lympia. Une synagogue fut érigée une vingtaine d’années plus tard. Le Duc de Savoie, tout en imposant des restrictions d’habitat et de profession, protégea les juifs des conversions imposées.

À partir de 1448, les juifs niçois durent s’établir dans une Giuderia, un quartier séparé dans la ville, en application de la directive du Pape. Néanmoins, on constate une évolution de leur situation sociale et économique.
En 1499, Nice accueillit les juifs expulsés de Rhodes et d’autres lieux du bassin méditerranéen, suite à l’Inquisition. Au XVIe siècle, les juifs furent autorisés à pratiquer des métiers commerciaux et la médecine, motivant notamment la venue de ces juifs.
La communauté juive niçoise se développa avec la venue de juifs marranes d’Italie et des Pays-Bas au milieu du 17e siècle. Le Duc de Savoie encouragea la prospérité de toute la ville et notamment des juifs en décrétant l’établissement d’un port franc à Ville Franche. Des juifs oranais s’installèrent également dans la ville à la fin du siècle.

À partir de 1723, les juifs furent tous obligés par Victor Amédée, roi de Sardaigne, de s’installer dans l’ancien ghetto, la pratique s’étant assouplie auparavant. De rares dérogations sont obtenues.
À la fin du 18e siècle, le Duc Charles Emmanuel III assouplit le statut des juifs, leur permettant de quitter le ghetto, d’acheter des terrains autour du port et de ne plus porter de signe distinctif. Dans cet élan, les juifs obtiennent le droit d’organiser un conseil communautaire en 1761.
Le rattachement de la ville à la France entre 1792 et 1814 eut pour conséquence l’émancipation des juifs comme ce fut le cas pour tous les nationaux depuis les années 1789 (date de la Révolution) et 1791 (décret promulguant l’égalité pour les juifs).

Lors du rattachement de la région à la Sardaigne en 1828, ces droits furent annulés. Ce ne fut qu’en 1848 que l’émancipation fut définitive, avec la suppression du ghetto. Le roi Charles Albert reconnait alors aux juifs l’égalité absolue des droits en tant que citoyens. Une évolution favorisée par le dévouement de Benoit Bunico, conseiller municipal. A sa mort, la rue de la Guidaria est rebaptisée rue Benoit Bunico. L’édit de 1430 est donc définitivement abrogé.
Malgré ces évolutions, le nombre de juifs niçois fut relativement très faible tout au long du 19e siècle. En 1808, ils constituaient seulement 300 âmes. En 1909, soit cent ans plus tard, ce chiffre n’augmenta que de 200 personnes.

De nombreux juifs s’installèrent dans la ville au début du 20e siècle. Parmi eux, l’écrivain Romain Gary : « Ce fut à treize ans, je crois, que j’eus pour la première fois le pressentiment de ma vocation. J’étais alors élève de quatrième au lycée de Nice et ma mère avait, à l’hôtel Negresco, une de ces « vitrines » de couloir où elle exposait les articles que les magasins de luxe lui concédaient… » Au début de La Promesse de l’aube, l’auteur raconte l’arrivée en France de la famille et le dévouement de sa mère à les faire survivre, prétendant ne pas aimer la viande pour que son fils en ait assez. Son seul réconfort étant sa réussite à devenir un Français fier de sa patrie et un grand homme de lettres, éblouie par la lecture de ses poèmes d’enfant : « Tu seras d’Annunzio ! Tu seras Victor Hugo, prix Nobel ! » Romain Gary gardera son attachement à la ville et à l’engagement pour la patrie. Comme il le raconte quelques pages plus tard lors du service militaire. Il reprendra du service d’ailleurs quelques années plus tard en rejoignant De Gaulle.

Lorsque Nice fut dans la libre puis tomba sous le contrôle italien pendant la Seconde Guerre mondiale, des milliers de juifs y trouvèrent refuge. Lorsque les troupes allemandes prirent possession de la ville en 1943, la situation changea brutalement. En cinq mois, 5000 juifs arrêtés et déportés.
L’évolution de cette situation est bien décrite par Joseph Joffo dans son livre Un Sac de billes. La famille Joffo, qui habitait dans la 18e arrondissement de Paris s’était retrouvée à Nice pour échapper aux rafles. Joseph et son frère Maurice, arrêtés par la Gestapo, sont sauvés par le curé de Nice qui témoigne en leur faveur, produisant des certificats de baptême.

A la Libération, des centaines de juifs niçois entreprirent de reconstruire la communauté. L’arrivée des juifs d’Afrique du Nord dans les années 1960 fit augmenta leur nombre à 20 000. On estime aujourd’hui le nombre de juifs niçois à moins de 10 000.
On trouve aujourd’hui une dizaine de synagogues ou salles de prière à Nice. De style néo-byzantin, la La Grande Synagogue , construite par l’architecte Paul Martin, a été inaugurée en 1886.

On y observe une façade de pierres pyramidale avec une rosace centrale. Elle dispose de belles décorations intérieures avec notamment douze vitraux à thèmes bibliques.
La synagogue Ezrat Ahim de Nice suit un rite ashkénaze. Elle a été ouverte en 1930 et possède une architecture intérieure intéressante.
La synagogue Maayane Or du mouvement Massorti de Nice a été ouverte en 1996. Elle dispose également d’un grand espace culturel et communautaire, avec un Talmud Torah, des cours d’hébreu, fêtes religieuses et autres activités.
Le cimetière juif se trouve au sein du cimetière du Château créé en 1783, dans sa partie sud. Un cénotaphe a été installé à l’entrée du cimetière aux victimes niçoises de la Shoah.

Lieu incontournable à visiter à Nice : Le Musée Marc Chagall . Un musée qui est le fruit du souhait du ministre de la Culture André Malraux en 1969 et fut inauguré en 1973. L’artiste participe au développement du projet. Il crée et donne des œuvres pour le musée et participe aux inaugurations d’expositions. Ne limitant pas son soutien à la peinture, Chagall y lance une politique de concerts. À sa mort, en 1985, le musée reçoit 300 œuvres de Marc Chagall. Les héritiers de l’artiste poursuivent ensuite les dons au musée.

En septembre 2024, une plaque à la mémoire des enfants juifs cachés du Monastère Sainte-Claire a été inaugurée, en présence du maire de Nice, Christian Estrosi. Ces enfants ont été sauvés de la déportation grâce au courage des Sœurs Clarisses, dont trois ont été reconnues comme Justes parmi les Nations. Cela, avec l’aide du Réseau Marcel d’Odette Rosenstock et de Moussa Abadi. Au total, le réseau aura réussi à cacher 527 enfants, dont une centaine qui furent cachés au sein du Monastère Sainte-Claire.
Ville importante de la région de Champagne, sa vieille ville est d’ailleurs en forme de bouchon de Champagne. Avec sa gastronomie réputée accompagnant ses breuvages, ses nombreux bâtiments protégés au titre de monuments historiques, sa cathédrale gothique et ses églises et musées tutoyant la Seine. Troyes est également célébrée à l’époque moderne grâce à son industrie textile, en plein essor au 19e siècle, surtout dans le secteur de la bonneterie. Parmi les grandes marques créées à Troyes, on peut citer Lacoste, Petit Bateau et Dim.

La présence juive troyenne date au moins du Xe siècle, c’est du moins ce que permettent de vérifier des archives documentées. Une petite centaine de personnes à partir du XIe-XIIe siècles. La ville demeure tout au long du moyen âge un des centres d’études juives les plus importants. Cela, en particulier, grâce à l’immense Rachi de Troyes, dont la mémoire est honorée par la ville et partagée par les deux lieux qui se font face sur les deux rives de la rue Bunneval, l’Institut universitaire et culturel européen Rachi et la Maison Rachi, faisant le lien entre le passé et le futur.
Rachi de Troyes
En ouvrant les cinq livres de la Torah, le Talmud ou de nombreux autres ouvrages religieux, un mot, plutôt un nom accompagne l’approche de ces textes : Rachi. Si des commentaires de textes partagés depuis des millénaires permettent d’éclairer tel point, telle situation, tel personnage, Rachi fait l’unanimité en tant que référence suprême. De par sa capacité à faire le lien entre les textes bibliques et tous les commentaires qu’il a sélectionnés, confrontant les approches les plus pertinentes aux questions les plus complexes. Il facilite la lecture, en repérant le sens littéral, le pshat.
Fierté nationale, Rabbi Shlomo Itshaqi, plus connu sous le nom de Rachi, est né dans la ville française de Troyes en 1040. Ayant bénéficié d’une excellente formation rabbinique avec les rabbins Jacob b. Yakar, Isaac b. Judah à Mayence et Isaac b. Eleazar Ha-Levi à Worms, il se réinstalle à Troyes et ouvre son centre d’études. Entre l’Est de la France et l’Ouest de l’Allemagne se trouvait en effet une région prospère économiquement et intellectuellement, encourageant les échanges sur les deux plans.
Ses élèves ne payant pas leurs cours à l’époque, les maîtres se voyaient obligés de subvenir à leurs besoins. Ainsi, les textes de Rachi incluant de nombreuses références au travail de la vigne, des suppositions ont commencé à être présentés au sujet de son activité de vigneron.
Rachi représente la jonction de l’excellence traditionnelle et du modernisme. Référence intellectuelle première mais aussi dans son investissement dans la Cité, il met à l’honneur la langue française dans ses interprétations. Le Rabbin Claude Sultan, qui dirigea l’Institut Rachi, nous affirma lors d’une ancienne visite que les linguistes français étudient ses commentaires bibliques pour découvrir des mots de la langue régionale de Champagne. Les commentaires de Rachi ne s’adressaient pas au public international qui les lit depuis le développement de l’impression quelques siècles plus tard. A l’époque, il s’agissait surtout d’éclaircissements destinés aux communautés de Champagne, où l’on parlait la langue d’oïl. Lorsque les gens ne comprenaient pas un mot, Rachi l’écrivait dans la langue champenoise, l’ajoutant dans son texte à côté des termes hébreux. Ce qu’on a appelé les laazim. D’où le grand intérêt manifesté par les linguistes et philologues concernant ces textes.
Les textes religieux chrétiens, comme ceux de Nicolas de Lyre, s’y réfèrent aussi. Les échanges entre penseurs juifs et chrétiens sont d’ailleurs réguliers et chaleureux. A l’époque de Rachi, mais aussi de ses descendants. Des descendants, en commençant par ses trois filles, Miriam, Yokhebed et Rachel qui perpétuèrent son enseignement. Puis, avec la création l’école des Tossafistes. Parmi eux, on compte les rabbins Rashbam, Ribam et Rabenou Tam. Cette école rayonne dans la région à Ramerupt, Dampierre et Sens.
Tous les écrits de Rachi ont été conservés et recopiés par la suite. Au début du 16e siècle, la communauté juive de Venise demanda une impression du Talmud. L’éditeur Daniel Bromberg d’Anvers obtint l’autorisation au pape. Une édition révolutionnaire, plaçant le texte sous forme de colonnes. Au milieu se situe le texte de base. A côté, dans la partie tournée vers la reliure, le texte de Rachi. Et vers l’extérieur, les commentaires des tossaphistes. Elément important, les caractères particuliers de Rachi ont été inventés lors de l’édition de ses textes, lui-même ne les utilisait pas.
Vie juive troyenne
Au Moyen Age, on surnommait le quartier Saint-Frobert , autour de la rue Hennequin, « la Juiverie » ou la « Broce-aux-Juifs ». Broce, signifiant « petite forêt dense ». Il se situait entre le Quai des Comtes de Champagne et la rue Boucherat, au pied de la cathédrale. Il ne s’agissait pas d’un ghetto, les populations juives et chrétiennes habitaient ce quartier en bonne harmonie. L’ancien cimetière juif se trouvait lui entre l’actuelle Médiathèque Jacques Chirac et le Théâtre de Champagne. Les foires de Champagne vont contribuer à l’agrandissement de la ville de Troyes.

La suite de la vie juive troyenne connut une prospérité économique mais aussi des persécutions, d’ordre matériel et physique, particulièrement au XIIIe siècle sous le règne de Louis IX. Le siècle suivant vit des expulsions sous Philippe le Bel et Charles VI et des retours timides de juifs dans la ville. Le cimetière juif ayant été détruit pour agrandir la ville, la tombe de Rachi a disparu. Par contre, on peut trouver une statue de Moïse sans lien avec la présence juive médiévale, sur le coin du bien nommé Hôtel du Moïse, construit en 1553, après l’incendie de Troyes en 1524.
La Médiathèque Jacques Chirac possède d’importants fonds patrimoniaux, surtout du XVIe et XVIIe siècles, dont ceux de la bibliothèque de l’Abbaye de Clairvaux. Ce n’est qu’au XIXe siècle que la communauté juive s’installa de manière pérenne à Troyes. A la veille de la Shoah, quelques 200 juifs vivaient à Troyes.
Renaissance d’une communauté
Isidore Frankforter, est un homme d’affaires d’origine roumaine installé à Troyes. A New York, il rencontre Walter Artzt, un juif ukrainien. Lequel a conçu un tissu spécial qui a la particularité d’être extensible. Frankforter crée l’entreprise FRA-FOR et reçoit de Haas le monopole d’utilisation de son textile en France. C’est ainsi que naît la marque Babygro. Un succès qui permet à Frankforter de devenir le pilier de la reconstruction de la vie juive troyenne.

Au lendemain de la Shoah, il n’y avait plus de lieu de culte juif à Troyes, celui-ci ayant été endommagé pendant la guerre. Dans les années 1960, Isidore Frankforter et le rabbin Abba Samoun achètent la petite maison dans laquelle se situe l’actuelle Maison Rachi au 5 rue Brunneval, afin d’y installer une synagogue. Puis l’étendirent au 7 et 9, bâtiments acquis en 1966.

Souhaitant repeupler cette communauté fortement impactée par la Shoah, Frankforter et Samoun rencontrent des réfugiés d’Afrique du Nord débarquant à Marseille. Ils leur affirment que, « certes, à Troyes il n’y a ni le soleil, ni la montagne, ni la mer… mais il y a du travail, parce que l’industrie textile est florissante à cette époque ». C’est ainsi que 350 familles composent la communauté juive dans les années 1960.
Mémorial
Lorsque la mairie de Troyes a souhaité rendre hommage à Rachi, elle ne pouvait pas le faire dans l’ancien quartier, à cause de toutes les constructions réalisées depuis que les juifs en avaient été expulsés au Moyen âge. Le choix se porta donc sur le lieu envisageable le plus proche : l’esplanade sur lequel est posé le fameux mémorial en face du théâtre de Champagne, site de l’ancien cimetière juif médiéval.

A l’occasion des 950 ans de la naissance de Rachi, en 1990, le Mémorial Rachi , réalisé par le sculpteur Raymond Moretti, a été inauguré devant un public ému. Parmi eux, Robert Galley, l’ancien maire de Troyes et Elie Wiesel. Ce dernier rappela l’importance de Rachi : « Son commentaire est devenu mon compagnon. Rachi était là, me guidait, me disait que tout est simple malgré les apparences. Je me suis mis à l’aimer au point de ne plus pouvoir m’en passer car, dès lors, je trouvais qu’il était différent, rayonnant d’amitié. »

Constitué d’une sphère en métal de près de 3 mètres, l’artiste s’est inspiré de la Cabbale et on y voit l’acronyme de Rachi en hébreu. Il mesure 2m20 de diamètre. Il est posé sur une vasque hexagonale qui reprend le bouclier de David et l’Hexagone représentant la France.
Deux lieux centralisent aujourd’hui l’activité culturelle et religieuse du judaïsme troyen. La Maison Rachi et l’Institut universitaire et culturel européen Rachi, apportant une approche complémentaire à l’appréciation de l’œuvre du grand maître.
L’Institut universitaire et culturel européen Rachi

Construit en 1990, dans le même esprit de célébration des 950 ans de la naissance de Rachi que le Mémorial, l’Institut universitaire et culturel européen Rachi occupe aujourd’hui une place importante dans l’étude juive mais aussi dans le partage interculturel. Par l’étude de la langue hébraïque, des autres langues sémitiques et des civilisations et pensées comparées. En se posant la question de l’approche culturelle et scientifique de la religion. La mairie de Troyes, ainsi que la médiathèque et l’Université de Reims participent activement au partage de l’œuvre et de l’influence de Rachi, à la fois sur les études bibliques, linguistiques et culturelles. De nombreux événements artistiques y sont également organisés.

Rencontre avec Gérard Rabinovitch, vice-président de l’Institut universitaire et culturel Rachi (IUCR).
Jguideeurope : Quand et comment est née l’idée de créer l’Institut ?
Gérard Rabinovitch : Il est indispensable de retenir que l’Institut universitaire et culturel européen Rachi a été fondé il y a plus de trente ans à l’initiative de René Samuel Sirat et de Robert Galley. Chacun, et ensemble, ils imprimèrent, du sceau des engagements de leurs personnalités, l’esprit qui anime l’Institut. Ce sont deux personnalités d’exception.
René Samuel Sirat, était professeur des Universités, chargé de mission de l’Inspection générale de l’Éducation nationale, pour l’enseignement de l’hébreu. Il fut aussi professeur à l’INALCO durant trente ans, où il dirigea la section d’études hébraïques et juives. À côté de ces activités universitaires, il fut grand rabbin de France de 1981 à 1988. Et à l’intersection de ses deux titres, il a fondé la chaire à l’UNESCO « Connaissance réciproque des religions du Livre, et enseignement pour la Paix ». La Nation française l’éleva au titre prestigieux de Grand Officier de l’Ordre national du mérite.
Quant à Robert Galley, ce fut ce qu’on nomme, avec considération et admiration en France, un Résistant de la « première heure », promu au titre de « compagnon de la Libération ». Il était un ingénieur diplômé de l’École centrale de Paris, mais surtout un homme politique, plusieurs fois ministre de 1968 à 1981, député de l’Aube et maire de Troyes. De tradition chrétienne, il a été très engagé dans le mouvement des Amitiés judéo-chrétiennes, dont il reçut le Prix en 1995. Lui aussi fut salué comme une grande figure au service du pays, en étant élevé au titre de Grand officier de la Légion d’honneur.
L’esprit de la Résistance, l’exigence de niveau universitaire, un humanisme biblique, une herméneutique des textes fondamentaux, et le dialogues des cultures, reçu d’eux en héritage, inspirent l’activité de l’Institut Rachi.
C’est donc, depuis l’élan inspiré et initial de ses deux fondateurs et de leurs successeurs – dont nous citerons Nelly Hanson qui en assura la perpétuation d’esprit -, que l’Institut universitaire et culturel européen Rachi se définit comme un établissement dévolu aux Humanités (humanités bibliques et juives, et humanités européennes dans leurs intersections, ensemencements, ou tensions) au sens académique de l’enseignement supérieur et laïc. Il délivre des cours, des séminaires, des groupes de recherches, des conférences, et des colloques. Mais encore des expositions, des soirées et évènements artistiques autour de la musique, de la littérature, de la poésie et du cinéma.
Précisément, avec l’ensemble de ces instruments didactiques, l’Institut Rachi se propose de donner des outils et des repères de pensée et de réflexion sur ce qu’on peut appeler les cultures monothéistes. La transmission de la pensée et des cultures juives dans toutes leurs diversités est un de ses axes, ainsi que la mise en rapport et la mise en dialogue avec les autres cultures monothéistes, sur les grands questionnements éthiques et épistémologiques de nos sociétés contemporaines. Cela me parait, par évidence, imprégnant dans l’indication magistère du nom de Rachi.

Que vous inspire justement le nom de Rachi et la richesse de ses enseignements ?
Le nom de Rachi – acronyme de Rabbi Shlomo Ben Izhak dit encore « HaTzarfati » (Le Français ») -, sa personne, telle qu’on l’a rapportée « simple » et « modeste » ; son existence, celle du fondateur d’une École qui eut des élèves venant de tout le continent de son temps ; son œuvre, si importante qu’elle est venue – sous le nom de Commentaire Rachi – s’adjoindre au corpus talmudique pourtant considéré comme clôt depuis des siècles ; tout ensemble, estampille et jalonne bien des chemins de l’Europe érudite juive, et celle non juive qui s’en inspira.
Pour l’anecdote mais pas anodine, le Commentaire Rachi fut le premier livre imprimé en hébreu en 1475 à Reggio en Italie. À la fois, donc, rabbin, exégète, talmudiste, poète, légiste, et décisionnaire, nous pouvons dire qu’il figure – par sa personne, par sa vie, par son œuvre – une sorte d’idéal-type incarné des trois champs de l’intellectualité récurrente de l’érudition juive : l’étude exégétique, le juridique et la poésie. Ajoutons à ce portrait qu’il emblématise l’intrication des positions d’élève auprès de ses maîtres (ceux de Mayence, puis de Worms) et de maître à son tour auprès d’élèves (à Troyes) telle que la socialité juive la vénère, dans un enchainement continu.
Mais, davantage peut-être encore, pour un établissement d’enseignement tel que l’Institut, il personnifie – à mon sens – ce que peut-être le trait d’une subjectivité d’éducateur, en son noyau d’existence et dans tous les horizons d’une vie justifiée par ses actes. On pourrait, au plus simple, déjà le souligner dans le fait – si rare dans son époque – d’avoir eu le souci d’enseigner ses trois filles (Miriam, Rachel, Yokhebed). Elles se marièrent plus tard avec trois de ses meilleurs élèves de l’École talmudique qu’il avait fondée.
Son trait éducatif est encore activement présent, dans le motif initiateur de son Commentaire. L’élan fécond de ce travail gigantesque se trouvant dans la volonté de rassembler toutes les réponses qu’on peut faire sur le sens des textes à un enfant de cinq ans, en restant le plus concis possible. En chemin de celui-ci, il établit un système cognitif de déduction et de conclusion, fondé sur la mise en relation des dissemblances entre un exemple et un autre.
Ce trait n’est pas moins patent dans ses Responsa qui permettaient à des populations juives confrontées à des situations de vie inédites d’y faire face, en inventant pour elles des recettes, remèdes, réponses qui puissent accueillir l’inédit, sans déroger à la Loi éthico-pratique.
Enfin, nous l’observons même jusque dans l’usage qu’il fait du vocabulaire français de son temps. Emprunt justement, pour expliquer « dans le texte » un terme difficile du Pentateuque et du Talmud. Les mots qu’il a empruntés – au motif didactique – au français vernaculaire de son vivant (dit laazim en hébreu) sont si nombreux et riches (1500 pour accompagner le texte biblique, 3500 pour accompagner le texte talmudique) que le Commentaire Rachi constitue – suivant Claude Hagège et Arsène Darmasteter – le plus précieux document que l’on possède sur l’état du français tel qu’il était parlé dans la seconde moitié du Xième siècle.
Voici quelques exemples de laazim : chêne, portail, bordel (cabane, maison), sommeiller, châtaigner, cannelle, bandeau, chat-huant, pape, fourgon, coudrier, vire, aigrin, contrefait, vautour, assiégeur, aise, huisserie, houblon, fusil, orme… Et aussi le fameux tcholent, de Chaud lent !
Nous avons avec Rachi non seulement une figure magistère de l’érudition juive, mais un personnage sublime de l’idéal européen de culture par l’Éducation.
Et si je peux me permettre, j’ajouterais, concernant Rachi, que lui vont à merveille, certaines des formules d’Heinrich Heine et d’Abraham Heschel qu’ils posèrent sur la présence, l’existence, la condition juive, dans le monde et sa contribution. En les fusionnant et les appliquant à son propos, je les résumerais ainsi : Rachi ne fut pas un constructeur de Pyramides, mais un Bâtisseur du temps. Vous comprenez qu’éducateur dans son essentialité d’être, Rachi est le nom le plus honorant comme indicateur de route pour l’Institut, sa direction, et ses équipes à Troyes.
Quels sont les projets contemporains auxquels participe l’Institut universitaire et culturel européen Rachi ?
Parmi tous ses travaux, et en lien avec ses missions éducatives et culturelles, l’Institut est partenaire du projet GIP Rachi, un groupement d’intérêt public « Rachi-Troyes et Grand Est créé en 2023 par l’Etat (représenté par la Préfecture de l’Aube), la Région Grand Est, le Département de l’Aube et la ville de Troyes, avec le Consistoire de Paris. L’objectif visé par le GIP Rachi, est de porter la candidature de Rachi de Troyes au label « Patrimoine européen » de l’Union Européenne en 2025. Ce qui devrait être d’évidence pour qui prend la mesure de tout ce qu’il symbolise.
Sinon, sous le chapiteau du poème d’Hésiode (« Les travaux et les jours »), l’Institut Rachi participe de projets d’enseignements avec des partenaires éducatifs tels que l’Université de Reims Champagne Ardennes, l’Université de Technologie de Troyes, l’École supérieure de Design, Y Schools, le lycée Marie de Champagne ; et à Paris, avec l’Institut européen Emmanuel Levinas de l’AIU.
Il participe à des activités culturelles avec la Médiathèque Jacques Chirac, les Amis de la Médiathèque de Troyes Champagne Ardennes, la Maison du Boulanger, l’Espace culturel Didier Bienaimé, Aube Musique ancienne, les Passeurs de texte, et la Protection judiciaire de la jeunesse.
Il entretient aussi des liens dans l’Europe académique sous forme d’enseignements et de colloques, et avec plusieurs Centre culturels de représentations étrangères en France, notamment de l’Europe de l’Est. Par exemple, le Centre culturel de Pologne, celui de Lituanie. Et espère bien les développer.
Maison Rachi

En 2017, la Maison Rachi a été créée à intérieur de l’espace synagogal datant des années 1960. Des rénovations ont été réalisées ces dernières années à l’intérieur avec l’installation d’une très belle verrière, alliant les époques. Le lieu propose une exposition permanente riche et variée. Il offre également la possibilité de consulter tous les ouvrages contenant des textes de Rachi dans sa bibliothèque, mais aussi grâce à des recherches numériques.
Ce lieu se nomme la maison Rachi, la synagogue Rachi et non la maison de Rachi ou la synagogue de Rachi, parce que le grand maître résidait probablement dans l’ancien quartier juif. Ce qui surprend les visiteurs arrivant à Troyes, c’est l’absence de trace matérielle. Les muséographies n’étant pas à la mode à l’époque de Rachi, le manque de moyens financiers et la situation difficile des juifs de France à la fin du Moyen Age firent que beaucoup de choses se sont perdues avec le temps. Ce fut donc la volonté principale de la maison Rachi de faire découvrir à un large public l’œuvre et la vie du plus grand exégète et de l’auteur français le plus publié au monde.
A la fin du 20e siècle, des travaux d’entretien du bâtiment conséquents s’imposaient. La Fondation Edmond J. Safra-Genève finança le début de ces travaux. D’autres institutions, ainsi que des particuliers vont participer à ce financement par la suite.

A l’entrée, on est accueilli par les magnifiques vitraux de Flavie Serrière Vincent Petit qui représentent l’arbre généalogique de Rachi. Ils ont été réalisés en 2016, avec l’aide de l’historien du judaïsme Gérard Nahon et de la commissaire d’exposition Delphine Yagüe. Arbre dont les racines sont les noms de ses trois filles, Miriam, Yokhebed et Rachel. Suivent les nombreuses branches et oiseaux posés dessus, permettant à sa pensée de partir au loin vers les cieux et de revenir peupler les commentaires de textes religieux aux quatre coins du monde pour tant de générations…
La paracha de Balak a été choisie pour accompagner la muséographie du bâtiment. Celle qui raconte l’histoire du roi Balak envoyant Bilam pour maudire le peuple d’Israël. Un ange apparaît et l’encourage à faire le contraire. Lorsqu’il arrive devant le campement des temps de Jacob, il va réciter la bénédiction : « Que tes tentes sont belles, Jacob, et tes demeures, Israël ! » Ce texte, sélectionné par la Maison Rachi, est envoyé à l’architecte afin qu’il s’en inspire pour ses travaux.

La particularité de la synagogue de la Maison Rachi est d’être située dans une cour intérieure, sous une verrière. La résille métallique qui jouxte la verrière symbolise les tentes de Jacob. Anecdote amusante, les travaux prenant plus de temps que prévu, la date de l’inauguration fut repoussée et le hasard fit que celle-ci se déroula la semaine de la paracha de Balak.
Tous les textes de Rachi retrouvés sont présentés dans la très belle bibliothèque. 1800 tomes en des langues très différentes, aussi bien en français, allemand, anglais, espagnol et italien.

Le chemin parcouru nous permet d’apprécier une muséographie très particulière pour chaque pièce, avec des objets et textes anciens, ainsi que des écrans de diffusion vidéo et de recherches. Afin de raconter à la fois la vie de Rachi, son époque, mais aussi les fondements du judaïsme. Permettre à un grand public de comprendre et de contextualiser cette histoire. On a été étonné par un film animé où les spectateurs suivent des personnages d’époque, dont Rachi, en train de donner un cours. Avec les voix de Marc-Alain Ouaknine, Rébecca Eppe et Zacharie Yagüe.

Au 2e étage, une pièce est consacrée aux activités de la communauté juive de Troyes après-guerre, notamment les événements organisés par les Eclaireurs Israélites. De nombreuses photos sont exposées sur ces murs, dont celles d’un des Troyens contemporains les plus célèbres, l’humoriste Raphaël Mezrahi. Lequel fait d’ailleurs souvent référence à sa ville natale dans son œuvre.

Dans la salle suivante, on découvre un texte biblique numérisé, facilitant l’accès rapide à chaque paracha. Et cela en français, anglais et hébreu. On découvre dans cette pièce des textes de penseurs chrétiens de la fin du Moyen-Âge qui étudiaient Rachi, dont Nicolas de Lyre. Lequel pointe les apports de Rachi à sa compréhension de la Bible. Luther va se servir de Rachi afin de parfaire sa traduction de la Bible en langue vernaculaire. Dans la salle suivante, on aperçoit des exemples de laazim.
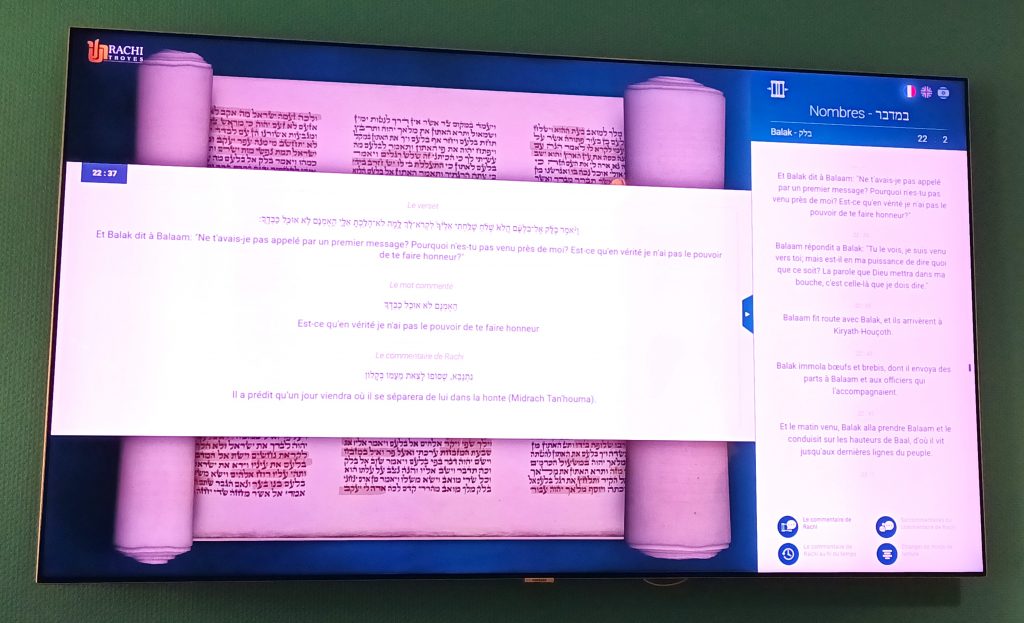
Jean-No, un artiste lorrain, a créé une œuvre avec des lettres en métal avec les caractères de Rachi. Avec le nom en inox et la même base en forme hexagonale, comme celle qui se trouve au mémorial de Rachi, en face du théâtre Champagne. Dans la petite cour intérieure, on contemple la fameuse œuvre du « Buisson ardent ».

Lors des travaux a été envisagée la possibilité d’installer un ascenseur, notamment à l’attention des personnes à mobilité réduite, comme il est coutume dans tous les musées contemporains. Néanmoins, la maison Rachi se situant dans un immeuble classé, une autorisation spéciale fut requise. L’accord prévoyait d’installer un ascenseur à l’extérieur, installé dans la cour et qui permette l’accès aux différents étages. Afin de cacher un petit peu l’ascenseur dans cette cour, une œuvre d’art a été créée par-dessus mesurant neuf mètres de haut sur un mètre cinquante de large. Un travail effectué par Flavie Serrière Vincent-Petit, dont l’œuvre nous accueillit à l’entrée de la Maison avec son arbre généalogique et que l’on suivra tout au long de créations présentées le long du parcours.

Rencontre avec Jean-David Bensaïd, Pôle développement de la Maison Rachi.
Jguideeurope : Quels types de visites proposez-vous ?
Jean-David Bensaïd : Aujourd’hui nous proposons deux types de visites guidées, d’une heure ou de deux heures. Actuellement, nous travaillons à la mise en place de visites libres. Ce parcours intégrerait la synagogue, la bibliothèque et l’oratoire dans une scénographie renouvelée et innovante qui devrait être opérationnelle au printemps prochain.
Quelles autres activités sont organisées à la Maison Rachi ?
Les évènements sont nombreux. Nous venons par exemple d’accueillir Arlette Testyler, rescapée du Vel d’Hiv, qui a permis de réunir par son témoignage 2 000 élèves au théâtre de Champagne. En décembre 2024, nous recevions François Guillaume Lorrain pour son livre dédié aux Justes, qui figurait sur la liste des trois derniers essais retenus pour le prix Renaudot 2024. La Maison Rachi peut même être parfois privatisée à l’occasion de certains évènements comme la réception du séminaire annuel de la Bibliothèque Nationale d’Israël en février prochain.
Et puis la Maison Rachi, c’est également une maison d’édition. Nous éditons régulièrement des livrets, qui permettent de découvrir par un travail de vulgarisation assez fin, de nombreuses thématiques telles que les droits des femmes ou l’antisémitisme. Notez d’ailleurs que nous avons retravaillé toute notre gamme pour davantage de cohérence avec le grand éditeur new-yorkais Prosper Assouline.
Et enfin, et j’allais dire surtout, Maison Rachi c’est avant tout une synagogue très dynamique. Nous avons la chance d’avoir un rabbin, Mickael Amar, qui est très actif et qui, en étroite collaboration avec nos deux co-présidentes et notre vice-présidente de l’association cultuelle, organisent régulièrement des activités communautaires pour les fêtes et pas uniquement. Les chabbath pleins se multiplient, ce qui nous permet d’accueillir dans d’excellentes conditions les visiteurs qui souhaitent passer un moment privilégié dans la ville de Rachi.
Pouvez-vous nous raconter une visite qui a particulièrement ému les gens travaillant à la maison Rachi ?
Philippe Bokobza, l’un des deux cofondateurs avec le Président de la Maison Rachi, René Pitoun, m’a raconté la visite très touchante d’un de nos visiteurs qui, face aux tables numériques devant lesquelles on peut découvrir chaque paracha de l’année, a trouvé celle de sa bar mitzvah. Il s’est retrouvé plongé des décennies en arrière et s’est alors mis à chanter, les larmes aux yeux.
Ces tables, uniques au monde, permettent d’accéder directement au texte sacré et sont très appréciées par nos visiteurs. Adultes comme enfants se retrouvent plongés dans les commentaires de Rachi en français, anglais et en hébreu et provoquent réellement une émotion.
Et pour finir cette présentation et vous souhaiter une agréable visite, quelques aphorismes de Rachi :
Tout plan formulé dans la précipitation est insensé.
Soit certain avant d’interroger ton Maître sur ses raisons et ses sources.
Les Maîtres apprennent des discussions des élèves.
Celui qui étudie les Lois et ne comprend pas leur sens ou ne peut pas expliquer leurs contradictions, n’est qu’un panier plein de livres.
Ne blâme pas ton prochain de manière à lui faire honte en public.
Obéir par amour est mieux qu’obéir sous l’effet de la peur.
Une communauté juive s’installa dans la ville dans les années 1750, avec de nombreux artisans parmi eux. La population juive évolua rapidement au XIXe siècle, passant de 1 559 en 1815 à 2 918 en 1847. L’installation de rails et le développement des industries du bois et des céréales accélérèrent la croissance de la ville.

En 1898, il y avait près de 5 000 artisans juifs en ville. Les professions devinrent plus diverses. On trouvait de nombreux juifs dans l’industrie ferroviaire, l’agriculture, le travail des matières comme le cuir et les tissus. Les mouvements ouvriers du Bund et le Poalei Zion se développèrent, ainsi que des mouvements d’autodéfense face aux pogroms.
À cette époque, les 32 400 juifs représentaient près de la moitié de la population de la ville. D’éminents rabbins étaient issus de ses yeshivot, comme le mitnagged Meir Simhah Hakohen et le hassid Joseph Rozin.
La Première Guerre mondiale provoqua la destruction d’une partie de la ville et la fuite de nombreux habitants. Dans les années 20, il n’y avait plus que 11 000 Juifs. Les mouvements sionistes y rencontrèrent un certain succès, ainsi que les six écoles juives qui accueillirent de nombreux élèves.

L’occupation soviétique en 1940-1 provoqua la fermeture des mouvements, organisations et institutions juives. L’enseignement dans les écoles juives fut autorisé uniquement en se basant sur le curriculum russe.
Lorsque les nazis occupèrent la ville en 1941, un pogrom fut organisé. Les synagogues furent brûlées ou réquisitionnées. 1 150 juifs furent assassinés en une semaine et les 15 000 juifs restants placés dans des ghettos. De nombreux autres massacres s’y déroulèrent pendant la guerre. Ainsi, à Daugavpils, 9 000 juifs furent assassinés pendant la Shoah.
En 1970, une communauté de 2 000 juifs s’y était reconstituée, disposant d’une synagogue en activité. Suite à l’émigration, il ne reste plus aujourd’hui que quelques centaines de juifs à Daugavpils.
La synagogue restante a été construite en 1850. Elle se trouve dans une partie centrale de la ville. Au deuxième étage, elle accueille le musée juif de la ville. Toute visite requiert une demande préalable.
Le grand peintre Mark Rothko, auquel la fondation Vuitton a consacré une exposition fin 2023, est né à Daugavpils en 1903. En 2013, un musée en son honneur est inauguré dans la ville, en présence de sa fille Kate.

La plus ancienne pierre tombale juive trouvée à Wroclaw (Breslau) remonte à 1203, indiquant qu’à cette époque Wroclaw abritait une communauté juive. En 1290, Wroclaw était la deuxième plus grande communauté juive d’Europe centrale et orientale, après Prague. Les juifs de la ville travaillaient principalement comme prêteurs sur gage et commerçants ; une plus petite minorité pratiquait l’artisanat.
Histoire de la communauté juive
Au XIVe siècle, toutefois, les Juifs de Wroclaw sont victimes de violences. Après un pogrom en 1349, environ 5 familles survivent parmi les 70 d’origine. 41 juifs sont jugés et brûlés sur le bûcher en 1453 après avoir été accusés de profanation d’hostie. La même année, la communauté juive est expulsée de la ville. Deux ans plus tard, la ville obtint le statut officiel d’intolérance. Jusqu’en 1744, il était interdit aux juifs de vivre à Wroclaw. Ils ne pouvaient s’y rendre que pendant les foires annuelles.
En 1741, la ville est annexée par la Prusse et, en 1744, Frédéric II autorise les Juifs à y reformer une communauté officielle. La population juive augmente rapidement. En 1747, 532 Juifs vivaient à Wroclaw (1,1% de la population totale). En 1810, ce nombre avait grimpé à 3 255 (5,2%).

Wroclaw devient un centre important pour la Haskalah (les Lumières juives). Les deux communautés – les orthodoxes et les libéraux – étaient actives dans la vie religieuse et culturelle des juifs de la ville et étaient dirigées par d’éminents rabbins et érudits. Le nombre de résidents juifs dans la ville était de 19 743 en 1900 et de 10 300 en 1939.
En novembre 1938, les activités culturelles, sociales et éducatives de la communauté sont interdites et les synagogues et les écoles juives sont détruites pendant les pogroms de la Nuit de cristal.
À partir de septembre 1941, les juifs sont chassés de chez eux et leurs biens et entassés dans les maisons juives (Judenhaus). Ils sont déportés quelques mois plus tard dans des camps de transit avant le convoi vers d’Auschwitz. Entre novembre 1941 et l’été 1944, les juifs de Basse-Silésie, y compris ceux de Wroclaw, sont déportés dans 11 convois. Le premier conduit les juifs à Kaunas, où tout le transport est abattu. Les convois ultérieurs envoient les Juifs dans les camps d’extermination de Sobibor et Belzec, ou à Terezin et Auschwitz. Certains juifs sont envoyés dans des camps de travail temporaires. En 1943, seuls les conjoints de mariages mixtes et certains enfants sont encore à Wroclaw. Les 150 derniers juifs de la ville sont déportés à Gross-Rosen en janvier 1945, où ils sont tous tués.
À partir de mai 1945, Wroclaw devient un centre de transit pour les survivants juifs revenant des camps de concentration de Silésie et de Pologne. Les juifs des anciens territoires polonais annexés à l’Union soviétique pendant la guerre commencent à arriver dans la ville par vagues à partir de 1946, faisant de Wroclaw la plus grande communauté juive de Pologne. Bien que le nombre de Juifs à Wroclaw ait culminé à 17 747 en 1946, après le pogrom de Kielce en juillet de la même année, ce nombre diminue considérablement. Ainsi, au printemps 1947, environ 15 000 Juifs vivaient à Wroclaw.
La communauté juive d’après-guerre reconstruit une communauté religieuse, des écoles, des coopératives juives et un théâtre juif, ainsi que d’autres organisations et partis politiques. La population juive continue de chuter, principalement en raison de l’émigration. En 1960, il restait 3 800 Juifs dans la ville.
La guerre des six jours et l’antisémitisme entraînent une augmentation sensible de l’émigration après 1967. Dans ce sillage, l’école et le théâtre juif ferment leur portes. En 1974, il y avait 3 000 Juifs à Wroclaw.
Une renaissance juive a commencé à la fin des années 1980. En 2000, la ville a rouvert la société socio-culturelle juive et son école juive. La synagogue dite des cigognes blanches, utilisée par les nazis comme atelier de réparation automobile et pour stocker des biens juifs volés, est reconsacrée à nouveau en 2010 après une restauration à grande échelle.
En 2014, la communauté juive de Wroclaw comptait 350 membres inscrits, ce qui en fait la deuxième communauté juive organisée en Pologne après Varsovie.
Les vestiges de ce qui semble être une synagogue du 14e siècle semblent avoir été trouvés à Wroclaw en 2021. Une découverte effectuée lors de travaux de rénovation dans un immeuble à proximité de l’Historical Institute of the University of Wrocław, sur la 49 Szewska Street.
Les sites de patrimoine juif à Wroclaw
Lors de votre visite à Wroclaw, vous passerez sûrement sans le savoir près de ce qui fut la magnifique synagogue de la ville, incendiée pendant la Nuit de cristal. Un petit mémorial rappelant son emplacement se situe à ul. Łąkowa 6.
Seule synagogue à Wrocław à échapper à la Nuit de cristal, fut la synagogue de la cigogne blanche, construite en 1829. Elle tire son nom de l’auberge dont elle avait pris l’emplacement. Construite par le célèbre architecte Karl Ferdinand Langhans, la synagogue est ironiquement considérée comme un exemple remarquable de l’art sacré protestant du XVIIIe siècle. Le bâtiment est discrètement caché dans une cour, c’est dans ce même emplacement que les membres de la communauté juive furent rassemblés pour être déportés. Gravement endommagée, mais non incendiée grâce à sa proximité avec des bâtiments résidentiels, la synagogue fut laissée à l’abandon après la guerre, avant que la communauté juive puisse enfin la récupérer des mains du gouvernement polonais en 1996 et en entreprendre la restauration. Réouverte en mai 2010, la synagogue sert désormais de lieu de culte, de centre culturel et de branche du Centre d’information juif. Elle comprend une nouvelle salle multi-fonctionnelle au sous-sol de la synagogue, de deux espaces d’exposition sur les balcons dont l’un abrite une exposition permanente sur l’Histoire des Juifs à Wrocław et en Basse-Silésie ; la seconde est quant à elle réservée aux expositions temporaires. Un bain rituel a été inauguré en janvier 2019.
Juste à côté de la synagogue, vous trouverez la Fondation Bente Kahan, qui organise des événements mensuels, notamment des expositions, projections de films, ateliers, conférences, concerts, représentations théâtrales, etc. Vous trouverez dans la même rue un second centre culturel juif : après des travaux de rénovation, le centre d’information juif abrite également le café CIŻ : un café casher, une librairie et un centre d’informations touristiques. En plus d’être un nouveau lieu pour des conférences, des ateliers et d’autres événements liés au judaïsme, cette organisation organise également des visites à pied juives de Wrocław. Pendant que vous y êtes, dégustez des collations moyen-orientales et le petit-déjeuner israélien servi toute la journée. Notez que ce centre juif édite également le magazine judéo-polonais Chidusz.

Fondé en 1856, avec plus de 1 200 pierres tombales, l’ancien cimetière juif est peut-être le témoignage le mieux préservé de l’importance de la communauté juive d’avant-guerre de Wroclaw. Fermé en 1942, le cimetière tomba rapidement dans un état de délabrement total. En 1945, il fut transformé en forteresse par les nazis. Des combats acharnés y eurent lieu, comme en témoignent les impacts de balles dans de nombreuses pierres tombales. La rénovation a commencé dans les années 1970 et, en 1991, y a été inauguré un musée de l’art sépulcral juif. En effet, la beauté et la diversité des styles et des symboles classent ce lieu au rang des plus beaux cimetières juifs d’Europe. De nombreux personnages remarquables y sont enterrés, notamment l’historien Heinrich Graetz, ou encore Ferdinand Lassalle. Cependant, malgré ces modestes efforts de rénovation, le cimetière de la rue Ślęna reste un sanctuaire sauvage. Un livret d’accompagnement très instructif.
Situé au nord-ouest du centre-ville, le nouveau cimetière juif a été fondé en 1902 lorsque le cimetière de la rue Ślężna devint trop petit, et est toujours utilisé par la communauté juive de Wrocław. Il n’a cependant pas été épargné par les ravages du temps et son état contraste nettement avec les cimetières catholiques bien entretenus des alentours. Comprenant 11 hectares et environ 8 000 tombes, il s’agit du cinquième plus grand cimetière juif de Pologne. Il a été déclaré monument historique pour la grande diversité des styles esthétiques et architecturaux des pierres tombales. Le tombeau le plus remarquable est dédié aux soldats juifs de l’armée allemande tombés au combat pendant la Première Guerre mondiale ; leurs 432 noms sont gravés au sommet du monument. Le cimetière fait actuellement l’objet de travaux de rénovation et n’est ouvert au public que du 1er mai au 30 octobre, les mercredis (14h – 17h) et les dimanches (09h – 13h), 20 % environ du lieu étant fermé au public. Pour vous y rendre, prenez les tramways 10, 33, 20 ou 3 en direction de Pl. Jana Pawła II et descendez à ‘DH Astra;’ le trajet dure environ un quart d’heure.
À la chute de Carcassonne en 1209, les juifs de Béziers se réfugient en Catalogne et refondent une communauté dans la petite ville d’Olot. On sait en effet que les communautés juives du Languedoc et de Catalogne entretenaient des relations commerciales, culturelles et religieuses. Au XIIIe siècle, la Catalogne a donc absorbé un nombre important de juifs fuyant la guerre qui faisait rage dans le Languedoc.

Olot ayant été détruite dans un tremblement de terre en 1427, il ne reste pas de traces de la présence juive dans cette ville dès 1209. La seule preuve irréfutable de l’établissement de la communauté de Béziers à Olot est la dédicace de la nouvelle synagogue dans une pierre qui fut retrouvée dans les années 1940, dans les ruines de la chapelle du cimetière d’Olot, incendié au début de la guerre civile espagnole. Elle est actuellement exposée au musée-trésor de l’église Sant Estève d’Olot.
Source : Musée-trésor de l’église Sant Estève d’Olot – Carme Grau i Oliveras
Une communauté juive a existé à Thann dès le XIIIe siècle. En 1350, des sources font état d’une rue juive dans la partie nord-est de la ville. Cette communauté thannoise est restée importante : on comptait en effet 630 juifs à Thann en 1885. Avant la Seconde Guerre mondiale, la communauté s’élevait à 160 âmes.

La synagogue de Thann a été construite une première fois en 1817 dans le style néo-byzantin. En 1859, le nombre de fidèles dépasse les capacités du bâtiment. La synagogue est donc détruite puis reconstruite en incorporant le terrain de l’ancienne prison adjacente. La maison du rabbin est construite dans la foulée.
En 1915, l’édifice est en partie détruit par un bombardement et rénové en 1922. Saccagée sous l’Occupation et transformé en winterhilfswerk (service d’aide aux démunis mis en place par les Nazis), la synagogue est à nouveau remise en état en 1948. Elle est de nouveau rénovée en 1975, et depuis 2013 par l’Association des amis de la synagogue de Thann. Cela, afin de préserver le patrimoine culturel juif et sa mémoire. Parmi les travaux effectués par l’association ces dernières années : restauration des coupoles, de la toiture, des vitraux et du mikvé.
En 2014, des fouilles sont entreprises dans la cour de la synagogue. À cette occasion fut retrouvé et dégagé le mikveh datant de 1860.

Jusqu’en 1798, les juifs de la ville étaient enterrés à Jungholtz. Au cimetière juif de Thann, la tombe la plus ancienne remonte à 1799, la plus récente à 1916. Roger Hamon, lors de son travail de déchiffrage des épitaphes, a attiré l’attention sur le fait exceptionnel qu’à Thann de nombreuses stèles s’inspirent du style gothique de la collégiale, comme pour s’efforcer de répondre et d’être en harmonie avec l’église catholique (ce qui lui laissait penser que les sculpteurs étaient vraisemblablement les mêmes que ceux qui entretenaient la Collégiale Saint-Thiébaut de Thann). On remarquera également que, contrairement à l’obligation qui leur est faite après l’annexion de 1870 de n’utiliser que la langue allemande pour leurs inscriptions, les juifs adoptaient toujours l’hébreu et le français.
Le vieux cimetière a fait l’objet d’une opération de restauration, à l’initiative de l’Association des Amis de la Synagogue de Thann, en juillet 2015. Un nouveau cimetière a ensuite été aménagé rue d’Aspach, au lieu-dit Steinacker. Une stèle en pierre gravée porte le nom des juifs thannois déportés.
La synagogue, le mikveh, la maison du rabbin et le cimetière sont inscrits au titre des monuments historiques depuis 2016.
Sources : Association des amis de la synagogue de Thann ; Wikipédia

Peu de juifs habitaient l’Albanie à travers les siècles, mais comme indiqué dans la page de présentation du pays, il s’agit du seul pays européen qui a fortement augmenté sa population juive pendant la Seconde Guerre mondiale grâce au courageux accueil de réfugiés venant des régions environnantes.
Ainsi, en 1939, une centaine de familles juives s’y installèrent, dont les deux tiers à Tirana. Un peu plus tard dans l’année, une centaine de juifs allemands purent s’y réfugier également.
Bien que le pays compta 200 juifs en 1969, la plupart habitant à Tirana, il n’y avait pas de communauté organisée, ni de rabbin. Suite à la chute du mur de Berlin, la plupart des juifs albanais émigrèrent en Israël.
En 1996, 25 juifs étaient recensés à Tirana. Un émissaire de Chabad, installé en Grèce, assura un service minimum à la synagogue Hechal Shlomo de Tirana.
Renaissance juive à Tirana
En 2010, le rabbin Joel Kaplan, qui occupa les fonctions d’émissaire de Chabad à Salonique auparavant, fut nommé en présence du Premier ministre albanais Sali Berisha et du Grand rabbin israélien Shlomo Amar, ainsi que des représentants locaux des cultes musulman et chrétien. Une première depuis 70 ans.
Il y a actuellement une communauté juive à Tirana.
En 2020, un Mémorial a été inauguré honorant les victimes juives de la Shoah et les Justes albanais qui les sauvèrent. L’inauguration s’est déroulée en présence du Premier ministre Edi Rama.
Sur les 50 à 200 juifs recensés en Albanie en 2021, la plupart habitent à Tirana.

La vieille ville de Berat est un site du patrimoine mondial, connu sous le nom de la « ville aux mille fenêtres ». En effet, les maisons blanches de la ville et leurs fenêtres encadrées de bois sombre semblent comme superposées les unes aux autres.
Perpendiculaire à la rue Antipatrea vous trouverez la rue des juifs.
Musée juif de Berat
Mais surtout, vous trouverez à Berat le seul Musée juif d’Albanie. Le Musée Solomoni a été crée en 2018 par Simon Vrusho. Ce passionné collectionne et expose des centaines de documents, photographies et artefacts retraçant 2000 ans d’histoire juive en Albanie. Il raconte également le sauvetage par les Albanais de confessions musulmane et chrétienne des juifs pendant la Shoah. A la mort de Vrusho, l’homme d’affaires franco-albanais Gozmend Toska a financé sa réouverture et son agrandissement dans un autre quartier de la ville.

Lieu d’enterrement de Sabbatai Zevi ?
On notera également que certaines sources affirment que le faux messie Sabbatai Zevi serait inhumé à Berat. ceci explique l’implantation d’une communauté Deunmé à Berat au XVIIe siècle. La ville est restée un lieu de pèlerinage des fidèles de Zevi jusqu’au XXe siècle. Vous pouvez visiter la tombe supposée du mystique dans la Mosquée du Sultan vous la reconnaîtrez grâce à sa calligraphie turque. De l’autre côté de la cour se visite une mosquée de taille plus modeste. Vous remarquerez au-dessus de la porte d’entrée des motifs floraux ressemblant à s’y méprendre à des étoiles de David – indiquant peut-être que ce bâtiment fut autrefois un lieu de culte deunmé.
Il raconte le sauvetage par les Albanais de confessions musulmane et chrétienne des juifs pendant la Shoah. Il a été créé par le professeur Simon Vrusho qui consacra une grande partie de sa vie au partage de ce courage. A sa mort, l’homme d’affaires Gozmend Toska a financé sa réouverture et son agrandissement dans un autre quartier de la ville.
Né à Smyrne (l’actuelle Izmir) en 1626, dans une famille de drapiers originaires du Péloponnèse, kabbaliste exalté, Sabbataï Zevi, convaincu d’être le Messie, entraîna dans la tourmente les communautés juives de l’Empire ottoman. Pour son exégète moderne le plus pénétrant, Gershom Scholem, ce mouvement religieux et insurrectionnel s’est développé sur fond de mysticisme cabalistique, forme dominante de la piété juive de l’époque.
Dès l’expulsion d’Espagne, des penseurs juifs s’étaient interrogés sur la signification d’une telle catastrophe, la rapprochant des destructions du Temple de Jérusalem. « Je pense que ces épreuves, dira un rabbin à Rhodes en 1495, sont les douleurs de l’enfantement du Messie. » Ainsi peut-on comprendre l’enthousiasme et les espérances qui suscita le fulgurants mouvement messianique du smyrniote, en dépit de son excommunication par les rabbins de Jérusalem. En 1665, Sabbataï Zevi décide de partir à Istanbul. Arrêté par les autorités ottomanes, contraint de choisir entre le martyre et la conversion à l’islam, le prétendu Messie choisit de se plier.
Certains de ses partisans considèrent cette apostasie comme une étape indispensable à la réalisation de sa mission et se convertissent eux aussi à l’islam, tout en conservant leur foi juive et en pratiquant les rites en secret. Cette communauté des deunmés (« ceux qui se sont tournés ») se replia vers la Turquie, à la fin de l’Empire. Certaines grandes familles deunmées jouent, aujourd’hui encore, un rôle important dans l’édition ou l’industrie. Longtemps cachés, restés discrets durant les soixante-dix premières années de la République laïque fondée par Mustapha Kemal, les deunmés turcs commencent à revendiquer ouvertement leur identité et leur histoire.
La grande ville de Vlore fut le centre de la vie juive albanaise à l’époque moderne, même s’il en reste peu de vestiges aujourd’hui.

À proximité du Musée historique de la ville se trouve la rue des juifs. Une plaque sur l’un des bâtiments rend hommage aux habitants juifs de Vlore. Une plaque attenante indique que la rue des juifs est « protégée par l’État ».
Hommage aux sauveteurs albanais
La rue des Juifs a été ainsi nommée après une cérémonie où fut dévoilée une plaque honorant le sauvetage des juifs de la région par les habitants catholiques et musulmans pendant la guerre. Parmi eux, Anna Kohen, qui avec sa famille fut cachée et se réfugia ensuite aux États-Unis, et fut à la source de cette reconnaissance.
Dirigez-vous ensuite vers la mosquée Muradi . Adjacent à l’édifice, vous remarquerez une belle bâtisse de trois étages. Ce bâtiment construit en 1928 fut successivement l’une des trois synagogues de la ville, une bibliothèque, puis une école privée. Il est toujours propriété de la communauté juive.

Sarande, charmante station balnéaire au sud de l’Albanie, est située sur une baie bordée de plages et d’une promenade.
Au centre se trouvent les vestiges archéologiques d’une synagogue du Ve siècle, mais aussi ceux plus récents d’une basilique des débuts du christianisme. Des sols en mosaïque complexes demeurent. Le château Lëkurësi du XVIe siècle est perché au sommet d’une colline au-dessus de la ville.
Merveilles archéologiques de Sarande
Découverte dans les années 1980, puis excavée et restaurée au début des années 2000, la synagogue de Sarande date du Ve siècle et appartenait à une communauté prospère et bien en vue, comme sa localisation au cœur de la vieille ville l’indique. Les visiteurs peuvent aujourd’hui admirer les mosaïques, dont une ménorah et ce qui ressemble à l’Arche sainte. Au VIe siècle, la synagogue est transformée en basilique – puis détruite, probablement pendant les attaques avaro-slaves des années 580-585. Vous trouverez les informations et photographies plus détaillées au Musée archéologique de la ville .

Une communauté juive a vécu de manière irrégulière à Utrecht à partir du XIVe siècle. Au XVe siècle, les juifs vivaient dans le centre-ville, dans une rue qui s’appelle encore aujourd’hui Jodenrijtje (soit quartier juif), située dans une cour derrière la Bakkerstraat. En 1546, les juifs furent bannis d’Utrecht et de ses environs par le roi Charles V. Ainsi, ce n’est qu’au XVIIIe siècle qu’un juif obtiendra pour la première fois le droit de citoyenneté dans la ville.

Au XVIIIe siècle, les juifs se rendant à Utrecht pour participer à sa foire annuelle se rassemblaient pour prier à De Hollandse Tuyn, une maison située dans la rue Boterstraat. Les services religieux étaient organisés par le Reis Chewre, une société d’aide aux voyageurs religieux. Au cours des dernières décennies du XVIIIe siècle, la population juive d’Utrecht s’était tellement développée qu’en 1792 une ancienne église située rue Jufferstraat est louée pour être utilisée comme synagogue. Auparavant, les Juifs résidant à Utrecht priaient dans une maison de Korte Nieuwstraat. L’ancienne église est achetée par la communauté d’Utrecht en 1796. La synagogue est restée en service jusqu’en 1981. Le bâtiment a été restauré à quatre reprises au cours des deux siècles où il a servi de maison de prière à la communauté.
Au cours de la période de domination napoléonienne aux Pays-Bas, Utrecht fut choisie comme siège du rabbinat en chef de la province. Après le redécoupage des communautés juives sous le règne du roi Willem Ier, la résidence du grand rabbin fut transférée à Amersfoort. Dans les années 1830, la communauté d’Utrecht était divisée par une série de conflits sur l’interdiction du yiddish comme langue de prière dans la synagogue.
Jusqu’en 1807, les Juifs d’Utrecht enterraient leurs morts dans un cimetière juif situé près de la ville voisine de Maarssen. En 1808, la communauté achète un terrain pour un nouveau cimetière sur le quai Zandpad, adjacent à la rivière Vecht.
En 1821, une école destinée aux enfants juifs pauvres est construite. Le nombre d’enfants scolarisés augmente tout au long du XIXe siècle, malgré l’intégration continue des enfants juifs dans l’enseignement public à la suite de l’adoption d’une réforme nationale de l’éducation en 1857.
Preuve du dynamisme de la communauté, des branches locales de la Société pour le bien-être des Israélites aux Pays-Bas, de l’Alliance israélienne universelle et de la Société pour la pratique des sciences juives voient le jour. L’orphelinat central israélite ouvre ses portes à Utrecht en 1871.

La population juive d’Utrecht augmente rapidement au cours des premières décennies du XXe siècle. En conséquence, le siège rabbinat régional revient à Utrecht en 1917. Au cours de la même période, de nouvelles organisations juives apparurent à Utrecht, notamment des sociétés sionistes, un mouvement de jeunesse et un club sportif. À l’époque, la majorité des juifs d’Utrecht travaillaient comme commerçants et colporteurs. D’autres juifs de la ville travaillaient comme marchands en gros, fonctionnaires, enseignants, professeurs d’université et avocats.
Durant les premières années de l’occupation allemande des Pays-Bas pendant la Seconde Guerre mondiale, les juifs allemands chassés des zones côtières de leur pays viennent nombreux à Utrecht, formant ainsi une communauté de réfugiés dans la ville. Tous les juifs d’Utrecht sont touchés par les mesures anti-juives mises en place par les Allemands et leurs collaborateurs. En novembre 1940, les juifs sont licenciés de la fonction publique. Le maire d’Utrecht sera démis de ses fonctions en raison de sa réticence à appliquer les mesures anti-juives. Les enfants juifs sont expulsés des écoles publiques d’Utrecht en septembre 1941. En octobre 1941, un représentant du Conseil juif sous contrôle allemand est nommé à Utrecht.
La déportation des juifs d’Utrecht commence en septembre 1942. Cependant, même pendant la période des déportations, la vie juive à Utrecht reste active, à la fois sur le plan culturel et religieux. Le dernier juif, selon les autorités locales, à être resté à Utrecht est déporté dans le camp de détention de Vught en avril 1943. Plusieurs centaines d’autres juifs sont restés cachés, aidés en partie par des groupes de résistance à Utrecht, notamment le Kindercomité. D’autres ont trouvé à se cacher dans les villes et villages voisins de Zeist, Maartensdijk et Loosdrecht.
La synagogue fut mise à feu en 1941, mais l’incendie ne prit pas. La synagogue fut fermée à la suite de l’expulsion du dernier Juif appréhendé dans la ville. Le bâtiment est resté intact pendant la guerre et a rouvert ses portes le 10 mai 1945, juste après la libération d’Utrecht. Des manuscrits de la Torah et des objets cérémoniels de la synagogue avaient été cachés et furent récupérés.
La vie juive a continué à Utrecht pendant la période d’après-guerre. Un monument dédié aux plus de 1000 Juifs d’Utrecht assassinés pendant la guerre a été érigé au cimetière juif en 1948. Un second mémorial se trouve en face du Musée du rail.
En 1981, la synagogue du Springweg, devenue trop grande pour la communauté d’Utrecht en déclin, fut vendue. Depuis lors, les offices religieux hebdomadaires sont organisés dans un local plus petit, doté de l’arche sainte de l’ancienne synagogue ashkénaze de Maarssen (fondée en 1776). La communauté juive d’Utrecht a célébré son 200e anniversaire en 1989.

Le cimetière juif a été restauré en 1990. En 2004, des volontaires de la Fondation pour la pénitence et la réconciliation (Stichting Boete en Verzoening) ont participé à la restauration de 200 pierres tombales au cimetière.
Une communauté juive libérale s’est établie à Utrecht en 1993. Les bureaux et la synagogue de la communauté libérale sont situés dans le bâtiment de l’ancien orphelinat central israélite rue Nieuwegracht. En 1994, le maire d’Utrecht a dévoilé dans l’immeuble une plaque commémorant l’ancien orphelinat. La ville compte également une communauté orthodoxe et un beit habad Lubavitch.
Tous les ans au printemps se tiennent les journées du patrimoine juif d’Utrecht où vous pourrez visiter avec un guide les maisons où ont vécu les membres le plus éminents de la communauté.
Sources : Musée d’Histoire juive d’Amsterdam

En 1610, les fondateurs de Rotterdam autorisent un petit nombre de marchands juifs portugais à commercer dans la ville. Les permis garantissaient leur liberté de culte, et le droit de construire une synagogue et d’établir un cimetière. En 1612, ces dispositions sont contestées par l’église locale. Des familles juives quitte alors Rotterdam pour Amsterdam. Les Juifs restés à Rotterdam prient dans le grenier d’une maison privée et enterrent leurs morts dans le cimetière de Rubroek, situé dans ce qui deviendra plus tard la rue Jan van Loonlaan. Un deuxième groupe de Juifs portugais arrive à Rotterdam en 1647. Parmi eux figurait un ancêtre de la famille De Pinto.
En 1647, le conseil municipal de Rotterdam octroie aux juifs les droits dont jouissaient leurs coreligionnaires à Amsterdam. La communauté juive de Rotterdam s’agrandit rapidement et ouvre une synagogue dans une maison au coin des rues Wijnhaven et Bierstraat. La communauté fonde également une école talmudique, la Jesiba de los Pintos (la yeshiva des Pintos). L’école déménage à Amsterdam en 1669. Au cours de la seconde moitié du XVIIe siècle, la plupart des grandes familles juives portugaises de Rotterdam pratiquent le commerce international.

Au cours des dernières décennies du 17ème siècle, la synagogue de la communauté fut déplacée de Wijnhaven vers de nouveaux quartiers sur Scheepmakershaven, puis sur De Boompjes. Le cimetière juif atteint sa pleine capacité en 1693. Peu après, la communauté en inaugure deux nouveaux l’un après l’autre dans le quartier de Crooswijk. Le plus récent des deux, situé sur Oostzeedijk, a été transféré au 17ème siècle à la communauté ashkénaze de Rotterdam.

L’appartenance à la communauté judéo-portugaise diminue au cours des premières décennies du 17ème siècle. En 1736, la communauté disparaît. Par la suite, les quelques Juifs portugais restés à Rotterdam se revendiquent de la communauté ashkénaze.
Les juifs ashkénazes arrivent en effet à Rotterdam en provenance d’Allemagne et de Pologne au milieu du dix-septième siècle. Leur nombre était suffisamment important dans les années 1660 pour qu’ils s’organisent en communauté. Dans les années 1670, les ashkénazes de Rotterdam avaient leur propre rabbin, synagogue et cimetière. La synagogue, située sur Glashaven, a été consacrée en 1674.
À la fin du dix-septième siècle, tandis que la communauté portugaise diminue, la communauté ashkénaze dépasse la capacité de sa synagogue et, en 1702, la remplace par une nouvelle à proximité. Cette maison de prière fut bientôt fermée au profit de la synagogue de la rue De Boompjes, consacrée en 1725.

Le sous-sol de la synagogue de De Boompjes abritait une salle des fêtes, et la boucherie casher de la communauté ashkénaze se trouvait derrière la synagogue. En 1784, une synagogue annexe est construite à l’arrière de la synagogue. À cette époque, la majorité des Juifs de Rotterdam résidait dans les environs immédiats de la synagogue De Boompjes, centre de la communauté.
La communauté ashkénaze de Rotterdam fonde son école juive en 1737. La même année, elle ouvre un nouveau cimetière rue Dijkstraat. Le cimetière de Kralingen a été agrandi à plusieurs reprises et est resté en service jusqu’à l’ouverture en 1895 d’un nouveau cimetière situé rue Toepad. Ce cimetière reste en usage jusqu’à aujourd’hui. Un autre cimetière juif existait également dans le quartier de Delfshaven.

À la fin du XVIIIe siècle, 2500 juifs vivaient à Rotterdam, la plus grande population juive des Pays-Bas à l’exception d’Amsterdam. À l’époque, la majorité des juifs de Rotterdam travaillait comme petits commerçants. Les pratiques d’exclusion des guildes locales maintenaient les juifs de la ville dans une situation de précarité. L’octroi des droits civiques aux juifs en 1796 change progressivement cette situation. À partir de 1814, sous le règne du roi Willem Ier des Pays-Bas, la communauté juive de Rotterdam confirme son importance régionale en étant nommée siège du rabbinat de la province.
La population juive de Rotterdam quadruple au XIXe siècle grâce au développement économique de Rotterdam qui attirait de nombreux membres de la communauté. Parmi eux, beaucoup de juifs d’Europe de l’Est qui avaient décidé d’émigrer en Amérique via le port de Rotterdam et qui choisissent de rester dans la ville plutôt que de continuer leur route.
La pauvreté persistait toutefois au sein de la population juive de la ville. Diverses organisations humanitaires furent fondées pour remédier à cette situation. Les organisations bénévoles et sociales juives s’épanouissent parallèlement à l’expansion de la population juive de la ville. La priorité est donnée à l’éducation juive des enfants pauvres de la communauté. Les juifs de Rotterdam maintenaient des sociétés funéraires, d’aide aux malades, d’aide aux voyageurs et aux orphelins et personnes âgées. Les organisations religieuses se multiplient et, sur un autre front, les juifs laïcs de Rotterdam animaient une grande variété d’organisations sociales et politiques, ainsi que des clubs de sport et de loisirs.

Le XIXe siècle est également témoin de l’intégration des juifs de Rotterdam dans la société civile. La communauté commence à participer aux affaires municipales et devient également active dans la presse, les affaires juridiques, l’éducation et la médecine.
Alors que la population juive de Rotterdam quitte les quartiers juifs traditionnels et commence à résider dans toute la ville, de nouvelles synagogues sont fondées. Une communauté juive portugaise distincte a vu le jour à Rotterdam au milieu du XIXe siècle, mais ne s’est maintenue que vingt ans. Au cours de sa brève renaissance, la communauté portugaise avait sa propre synagogue et son propre cimetière sur Crooswijk. En 1891, la communauté juive de Rotterdam ouvrit une nouvelle synagogue centrale située sur la Botersloot. Le bâtiment central de la synagogue a été restauré en 1939 et, la même année, il abrite les archives de la communauté.
À la fin du XIXe siècle, des tensions se sont fait jour entre les factions conservatrices et les factions réformistes de la communauté. Les journaux juifs de cette époque reflètent ces divisions. Après sa fondation en 1908, le Nederlandse Zionistenbond (Union des sionistes néerlandais) exerça une forte influence sur une partie de la communauté de Rotterdam.
Au cours des premières décennies du XXe siècle, la population juive de Rotterdam atteint le plus grand nombre jamais enregistré. Des synagogues continuent à être construites, notamment la synagogue Lev Jam située sur Joost van Geelstraat, inaugurée en 1928. L’arrivée d’un grand nombre de réfugiés juifs allemands à Rotterdam dans les années 1930 entraîne un regain de la communauté. Une partie des réfugiés nouvellement arrivés était envoyée par le gouvernement néerlandais dans un camp situé à Hoek van Holland (à l’ouest de Rotterdam).

Le bombardement allemand de Rotterdam le 14 mai 1940 détruit le centre-ville ainsi que les synagogues de De Boompjes et Botersloot. Pendant l’occupation allemande des Pays-Bas, les Juifs de Rotterdam sont soumis aux mêmes mesures que les juifs dans le reste du pays.
La déportation des juifs de Rotterdam commence fin juillet 1942 et s’achève fin juin 1943. Presque tous les juifs de Rotterdam furent forcés de se rassembler pour être déportés dans le port de la ville, à Loods 24 (Shed 24). 13 % des juifs de Rotterdam ont survécu à la guerre.
Après la guerre, la vie juive à Rotterdam renaît avec pour centre la synagogue Lev Jam. En 1954, une nouvelle synagogue est consacrée, la A.B.N. Davidsplein. Une communauté juive libérale voit le jour en 1968. Celle-ci partage un cimetière à Rijswijk avec la communauté juive libérale de La Haye.
Un monument aux juifs de Rotterdam assassinés pendant la Seconde Guerre mondiale a été dévoilé en 1981 dans le jardin de la mairie de Rotterdam. Un monument aux déportés a été dévoilé sur le site de Loods 24 en 1999, ainsi qu’un nouveau en 2013. L’entrée de l’ancien hôpital juif de la Schietbaanlaan a été restaurée en 2001 et abrite aujourd’hui également un mémorial.
Source : Musée d’Histoire juive d’Amsterdam
Plusieurs familles juives s’installent dans la petite ville de Veghel au 18ème siècle (vers 1731) malgré l’opposition des autorités locales. La plupart des Juifs venaient des villes alentours de Nistelrode et Dinther. Au cours du deuxième quart du XIXe siècle, une communauté juive organisée existe à Veghel.

La communauté de Veghel ouvre sa synagogue sur Achterdijk, l’actuelle Deken van Miertstraat, en 1832. La synagogue est restaurée en 1866 grâce à une subvention du conseil municipal. La synagogue est de nouveau rénovée en 1930 et en 1938.
En 1886, alors que la population juive de Veghel atteint le plus haut nombre jamais enregistré, une école juive est construite sur la Bolkenplein. Cette même rue abritait un marché de viande casher. À l’époque, la communauté est régie par un conseil composé de trois membres. Le conseil supervisait notamment l’éducation religieuse et la collecte et le versement des fonds à la communauté juive de Palestine. On comptait à Veghel des organisations bénévoles comme une société funéraire et une société chargée de l’entretien de la synagogue. L’organisation de secours juive internationale Alliance Israélite Universelle tenait une succursale à Veghel. La communauté juive de Veghel, ainsi que celles de Sint Oedenrode et Uden, enterraient ses morts au cimetière juif voisin de Schijndel.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, près de la moitié des Juifs de Veghel est déportée et assassinée. Le reste s’était échappé à l’étranger ou survit à la guerre en se cachant. Une organisation locale a permis à environ 20 enfants juifs de se cacher dans les environs et d’échapper à la déportation et à la mort. Certains rouleaux de la Torah et objets cérémoniels de la synagogue de Veghel ont été transportés à Amsterdam et cachés ; le reste a été volé par les Allemands. Quelques objets d’argent enfouis dans le jardin de la synagogue ont également été retrouvés après la guerre.
Sur les 13 familles juives vivant à Veghel avant la guerre, seules trois sont revenues. La communauté juive de Veghel a été dissoute administrativement en 1947 et la localité a été placée sous la juridiction de la communauté juive d’Oss.
La restauration de l’ancienne synagogue sur la Deken van Miertstraat a été achevée en 2002. En 2003, une plaque citant un passage biblique (Esaïe 56: 5) à la mémoire des Juifs assassinés de Veghel a été apposée sur le mur du bâtiment. Une pierre commémorative au cimetière juif de Schijndel porte les noms des Juifs des environs assassinés pendant la guerre. L’ancienne synagogue abrite aujourd’hui une salle de réception.
Source : Musée d’Histoire juive d’Amsterdam
Les archéologues ont découvert une lampe à huile datant du IVe siècle. On y trouve dessus une menorah. Des preuves de la présence de juifs à Augsbourg sont plus fréquentes à partir de 1212. Des archives de la seconde moitié du XIIIe siècle décrivent une communauté bien organisée et mentionnent un Judenhaus (1259), une synagogue et un cimetière (1276), un mikveh et une salle de mariage (1290).

Développement et persécutions
Les Juifs étaient principalement vignerons et prêteurs sur gage. Jusqu’en 1436, les procès entre chrétiens et juifs étaient jugés par un tribunal mixte composé de 12 chrétiens et de 12 juifs. En 1298 et 1336, les Juifs d’Augsbourg sont sauvés de pogroms grâce à l’intervention de la municipalité. Pendant la peste noire (1348–1349), beaucoup sont massacrés et les autres sont expulsés de la ville. L’empereur donna la permission à l’évêque et aux bourgeois de réadmettre la communauté en 1350 et 1355.De 1434 à 1436, les Juifs d’Augsbourg sont contraints de porter un signe distinctif jaune. La communauté, qui comptait alors environ 300 familles, s’est dissoute en quelques années ; en 1340, les derniers Juifs avaient quitté Augsbourg. Par la suite, les Juifs n’étaient autorisés à se rendre à Augsbourg que pendant leurs journées de travail. Ils obtiennent également le droit d’asile en temps de guerre.

À la fin du Moyen Âge, la yeshiva d’Augsbourg apporta une contribution importante au développement de la méthode d’étude et d’analyse du pilpul du Talmud. La variante de la méthode pilpul mise au point à Augsbourg est appelée « Augsburg hillukim ». Le talmudiste Jacob Weil a vécu à Augsbourg entre 1412 et 1438. Des pamphlets en hébreu étaient déjà imprimés à Augsbourg dès 1514, et une imprimerie en hébreu a été créée en 1532.
Organisation communautaire
Une communauté juive organisée s’établit de nouveau à Augsbourg en 1803. Des banquiers juifs s’installent en accord avec la municipalité afin de redresser le déficit fiscal de la ville. En pratique, les restrictions anti-juives à Augsbourg ont été supprimées en 1806 avec l’abrogation du statut spécial de la ville et son incorporation à la Bavière.

Cependant, le nouveau statut civique juif ne fut officiellement reconnu qu’en 1861. En 1871, Augsbourg fut le lieu de rassemblement d’une assemblée rabbinique chargée de la réforme liturgique. La population juive passe de 56 en 1801 à 1156 en 1900. Elle était au nombre de 1 030 en 1933. En 1938, la magnifique synagogue, inaugurée en 1917, est incendiée par les nazis.
À la fin de 1941, après l’émigration et la fuite vers d’autres villes allemandes, les 170 derniers Juifs furent rassemblés dans un ghetto. 129 d’entre eux furent envoyés à Piaski en Pologne en avril 1942 et le reste principalement dans le ghetto de Riga et à Theresienstadt. Dans l’immédiat après-guerre, un camp fut établi à Augsbourg pour héberger des Juifs déplacés. Quelques semaines après la libération, les survivants de la Shoah et les soldats juifs de l’armée américaine réinvestissent dans la synagogue très endommagée. La communauté a finalement été rétablie. La synagogue a été restaurée et rendue à la communauté en 1985. À la suite de l’immigration de Juifs d’ex-Union soviétique, le nombre de membres de la communauté est passé de 199 en 1989 à 1 619 en 2003.

La synagogue
La communauté reçoit en 1861 l’autorisation du gouvernement de construire une synagogue. Dans le même bâtiment est prévu aussi un foyer socio-éducatif juif ainsi que les appartements du rabbin et des professeurs. La construction débute en mars 1864 et l’inauguration officielle a lieu le . À peine quelques années plus tard, la synagogue s’avère trop petite et la décision de la construction de la nouvelle synagogue est prise définitivement en 1900. La construction débute en 1914, mais le déclenchement de la Première Guerre mondiale retarde considérablement les travaux qui ne se termineront qu’en 1917, en raison du manque de personnel et de matériaux.
Dessinée par les architectes Fritz Landauer et D. Heinrich Lömpel, la synagogue est construite avec magnificence dans le style Jugendstil (Art nouveau) tardif tout en s’insérant parfaitement dans le style baroque de la ville. Au-dessus du toit, de part et d’autre de la coupole, sont assis deux lions, symbole de la tribu de Juda. La forme des fenêtres avec leur motif en filigrane de pierre et la forme de la coupole mettent en valeur son inspiration orientale. Presque 800 places sont disponibles pour les hommes et les femmes qui sont séparés.
Sur la clé de voûte de la porte de la salle des colonnes, le sculpteur Walter Sebastian Resch a gravé la date 1298 avec une étoile de David et les armes de la ville pour commémorer les relations plusieurs fois centenaires de la ville avec la communauté juive.

Dans la cour, un bassin d’ornement en marbre supporté par des corps d’animaux est alimenté par une source. Une sentence en hébreu sur le socle mentionne : « Que tous ceux qui sont assoiffés viennent, ici coule la source. »
Les habitations du rabbin et du chantre, les locaux administratifs et l’école ainsi qu’une petite salle de prière pour les jours ouvrables sont situés dans les deux bâtiments donnant sur la rue.
Après l’inauguration de la nouvelle synagogue, la vieille synagogue dans la Wintergasse est fermée. Le bâtiment est reconstruit et utilisé comme chapellerie. Il sera complètement détruit lors de la Seconde Guerre mondiale.
Lors de la nuit de Cristal, la synagogue est pillée et mise à feu. Heureusement, les habitants voisins, de peur que le feu ne se propage à leurs maisons et à des réservoirs de kérosène dans une station-service voisine, appellent les pompiers qui éteignent l’incendie. La structure de la synagogue n’a donc pas souffert. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la synagogue est utilisée pour stocker les décors du théâtre municipal, tandis que le bâtiment de l’école juive est occupé par l’état-major de l’armée de l’air. La coupole de la synagogue sert de poste d’observation pour l’artillerie de défense antiaérienne.

Après 1945, les bâtiments sont restitués à la communauté juive. Les bâtiments administratifs sont utilisés depuis 1958 comme centre culturel avec un jardin d’enfants, un espace de classes et une salle de fête. En 1964, la petite synagogue est de nouveau inaugurée et des offices sont tenus par la communauté juive. Dès 1965, la rénovation complète de la synagogue est entreprise. Les travaux ne commencent qu’en 1975 pour se terminer en 1985. Le , la synagogue est de nouveau inaugurée par un office en présence de plus de 120 membres de l’ancienne communauté d’Augsbourg venus du monde entier. Simultanément, le musée culturel juif ouvre ses portes dans une partie du bâtiment. Ce dernier a été amplement rénové en 2005-2006.
Le musée juif
À la même adresse, le Musée juif a été fondé en 1985. Il documente la riche culture et l’histoire des Juifs d’Augsbourg et de la région de Souabe du Moyen Âge à nos jours. La nouvelle exposition permanente, installée en novembre 2006, présente cette histoire de la migration et se concentre sur la relation entre la minorité juive et la majorité chrétienne. Il décrit également les changements intervenus dans la pratique religieuse au cours du temps, montrant l’histoire juive comme partie intégrante de l’histoire d’Augsbourg et de Souabe. Vous trouverez un café casher dans le musée.
Le cimetière juif
Le cimetière a été ouvert en 1867 et est toujours utilisé. Notez cependant qu’en raison de vandalisme répété, le cimetière est fermé sauf pour les enterrements ou si vous annoncez votre visite à l’avance. Le cimetière compte environ 1500 tombes.
Sources: Encyclopaedia Judaica; Wikipédia ; Musée juif d’Augsbourg
Une communauté juive est mentionnée à Leipzig à la fin du XIIe siècle. Dans le second quart du XIIIe siècle, la communauté est organisée et compte une synagogue et une école.

La position centrale de la ville attirait les marchands juifs qui voyageaient de toute l’Europe pour se rendre à la foire de Leipzig. D’ailleurs, en 1268, les règles de la foire garantissent la protection de tous les marchands et le jour de marché est déplacé du samedi au vendredi par considération pour les commerçants juifs.
Une implantation juive permanente est fondée à Leipzig en 1710. Le nombre de ménages juifs « privilégiés » autorisés à résider dans la ville est estimé à 7 au milieu du XVIIIe siècle.
Développement tardif
Cependant, la communauté juive en tant qu’organisation officiellement reconnue par l’État n’a été créée qu’en 1847 et ce n’est qu’à cette date-là qu’elle a été autorisée à s’établir à Leipzig sans aucune restriction. Après 1869, avec l’abolition de toutes les restrictions anti-juives, le nombre de Juifs augmente considérablement grâce à l’immigration de Galicie et de Pologne.
Bien que la plupart des Juifs étaient des marchands ambulants, moins de cent ans après sa fondation, la communauté juive de Leipzig comptait 11 564 membres, ce qui en faisait la sixième communauté juive d’Allemagne et la plus grande de Saxe. Le maire de la ville de 1930 à 1937, Carl Friedrich Goerdeler, bien que national-conservateur, était un adversaire reconnu du régime nazi en Allemagne. Il a démissionné en 1937 lorsque, en son absence, son député nazi a ordonné la destruction de la statue de Felix Mendelssohn.
Pendant la Nuit de cristal, en 1938, 553 hommes juifs furent arrêtés, des centres communautaires détruits, ainsi que l’un des bâtiments les plus importants de la ville sur le plan architectural : la synagogue mauresque datant de 1855. Les déportations débutent le 21 janvier 1942 et durent jusqu’au 13 février 1945, date à laquelle les 220 derniers Juifs sont déportés à Theresienstadt. En 1945, il ne restait que 15 Juifs dans la ville. Deux cents personnes sont revenues de Theresienstadt pour reformer une communauté. En 1989, la ville comptait 30 juifs. Cependant, l’immigration en provenance de l’ancienne Union soviétique l’a aidée à se développer. En 2012, la communauté juive comptait 1300 membres à Leipzig.

La synagogue Brody
La petite synagogue construite en 1897 est agrandie en un bâtiment de deux étages en 1933 ; la salle de prière se trouvait au premier étage et le deuxième étage abritait une bibliothèque et des salles de travail. Lors de la nuit de cristal, en novembre 1938, les fenêtres de la synagogue sont brisées et l’intérieur saccagé. Dans un souci de sécurité des habitations voisines, la synagogue n’est cependant pas incendiée.
Au début de 1939, les nazis, voulant convaincre le monde de leur tolérance, obligent la communauté à rénover la synagogue à temps pour la foire de Leipzig. Peu de temps après, ils en reprennent possession et transforment le bâtiment en fabrique de savon. Le bâtiment a été rendu à la communauté juive en 1945, après quoi il a de nouveau été utilisé comme synagogue. En 1993, l’intérieur et l’extérieur de la synagogue ont été restaurés. Aujourd’hui, Leipzig abrite la communauté juive la plus active de l’Allemagne centrale. De fait, la synagogue Brody détient le seul quotidien de minyan dans la région.
Les cimetières
À Leipzig, il y a deux cimetières juifs. Le nouveau cimetière est utilisé depuis 1927. En avril 1972, les travaux de rénovation du hall des célébrations ont commencé, ainsi que la rénovation de l’espace rituel. L’ancien cimetière est situé rue Berliner Straße.
Le mémorial de la Shoah
Sur le site de la synagogue mauresque, se trouve aujourd’hui le mémorial de la Shoah. Cette installation émouvante est composée de 140 chaises vides en bronze, représentant les 14 000 Juifs qui priaient à cet endroit, et reprend le plan du sol de la synagogue.

La communauté aujourd’hui
Le centre communautaire organise des conférences et des activités. En 2006, un mikveh a été ouvert à la même adresse.
En 2010, deux rabbins ont été ordonnés à Leipzig lors d’une cérémonie qui se déroula dans une petite synagogue de la ville. Elle marque l’accroissement de la communauté juive, notamment grâce à l’arrivée de juifs d’Europe de l’Est depuis la réunification. Une communauté qui avait avant-guerre 12 000 membres, 30 seulement à la chute du mur de Berlin en 1989 et près de 1300 en 2010.
L’histoire de la communauté juive de Cologne est documentée depuis 321, et est donc quasiment aussi ancienne que l’histoire de la ville elle-même. Tout au long de son histoire, la communauté de la ville a souffert de persécutions, d’expulsions, de massacres, et de destructions.
Avant sa dispersion et son extermination par les nazis, la communauté comptait autour de 19 500 membres. Elle s’est reconstituée depuis et compte aujourd’hui environ 4 500 membres. Grâce à sa continuité historique, la synagogue de Cologne s’enorgueillit d’être la congrégation juive la plus ancienne du nord des Alpes.

2000 ans d’histoire juive
Cologne fut fondée au Ier siècle après Jésus-Christ, et l’on estime que les juifs ont commencé à s’y installer dès le IIe siècle. À l’époque romaine, le judaïsme est reconnu comme religio licita. En 321, un décret de l’Empereur Constantin mentionne la communauté juive et constitue -pour le moment- la première preuve écrite de leur présence dans cette ville. Un autre décret de Constantin, datant de 341, mentionne une synagogue à Cologne. Notez que ces documents furent, pendant des siècles, la seule et unique preuve de l’existence d’une communauté juive à Cologne dès l’époque romaine.

Au Moyen-Âge, Cologne était sur le chemin de l’une des routes de commerce les plus importantes entre l’ouest et l’est de l’Europe.
En 1426, un document mentionne une synagogue en train d’être convertie en église. Quelques lignes plus loin, l’écrit précise que la synagogue est ancienne de 414 ans. Durant le dernier quart du XIe siècle, la population juive de Cologne compte environ 600 membres. La position commerciale stratégique de la ville attirait en effet beaucoup de juifs -et notamment des juifs italiens.
Persécution et pogroms
Toujours à cette période, les juifs sont installés dans la Judengasse, près du Rathaus. On recense des pogroms en 1096, pendant la première Croisade. Comme dans la ville de Mayence, les juifs sont forcés au baptême. Si, quelques années plus tard, l’Empereur Henri IV tente d’autoriser les convertis à revenir à leur foi d’origine, ce décret ne sera pas autorisé par l’antipape Clément III. Durant la seconde Croisade, si l’on note des violences et des pogroms dans le reste de la région, il semblerait que la communauté de Cologne ait été relativement épargnée.

Après la défaite de la bataille de Worringen, le 8 juin 1288, les juifs de Cologne et des environs sont victimes de graves violences et de pogroms. En 1300, un mur est construit autour du quartier juif, certainement payé par la communauté elle-même pour se prémunir des attaques.
La persécution de la communauté est la plus critique au moment de la Peste noire, et culmine avec la Saint-Barthélemy. Avant sa fuite, une famille enterra ses biens.
Ce trésor fut retrouvé en 1954 et est aujourd’hui exposé au Kölnisches Stadtmuseum. Les juifs ne reviennent à Cologne qu’en 1369, et une petite communauté est mentionnée dès 1372.
Les juifs obtiennent un protection temporaire et un droit de résidence dans la ville jusqu’en 1424. Après cette date, ils sont bannis de la ville « pour l’éternité ».
Les juifs émigrent en majorité vers la Pologne et la Lituanie. Leurs descendants ne reviendront à Cologne qu’au XIXe siècle et s’installeront dans le quartier de Thiebodsgasse.

Développement spirituel et intellectuel
Après la destruction de la communauté pendant la Seconde Guerre mondiale, les fondations médiévales du quartier juif furent excavées, dont la synagogue et l’impressionnant mikveh. Ces recherches furent conduites par l’archéologue Otto Dopperlfeld entre 1953 et 1956. Aujourd’hui, le quartier juif médiéval fait partie de la zone archéologique de Cologne.
L’une des plus vastes bibliothèques juives du Moyen Âge se trouvait à Cologne. En effet, après le massacre des juifs de York, en Angleterre, en 1190, un grand nombre de livres en hébreu furent acheminés et vendus à Cologne. Ces remarquables manuscrits sont aujourd’hui conservés dans des musées et des bibliothèques à travers le monde.
Cologne était également un centre d’apprentissage respecté. La mention « sage de Cologne » est fréquemment retrouvée dans la littérature religieuse. Les érudits du Talmud étaient réputés à Cologne pour leur ouverture d’esprit. Beaucoup de poèmes liturgiques du rite ashkénaze ont été écrits par des poètes de la ville.
Le cimetière juif de Cologne est mentionné dès 1096 et prenait environ 30 000 m2. La plus ancienne tombe retrouvée à ce jour date de 1152.

Rive droite du Rhin : le quartier juif de Deutz
Après l’expulsion, les rares juifs restés à Cologne s’établissent sur la rive droite du Rhin, à Deutz – aujourd’hui un quartier rattaché à la ville.
En 1633, on comptait 17 juifs à Deutz, et ce nombre reste stable jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. La communauté occupait un petit quartier de Deutz, entre Minderer et Hallenstrasse. Une synagogue, déjà mentionnée en 1426, fut endommagée pendant la dérive de glace du Rhin en 1784. On pense que le mikveh associé à la synagogue existe toujours sous les quais du pont Deutzer.
Entre 1786 et 1914, la synagogue fut ensuite remplacée par une autre, de taille plus modeste, à l’emplacement de ce qui est aujourd’hui la rue Deutzer Freiheit. Pendant les travaux de construction du pont suspendu de Deutz en 1913, la synagogue fut abandonnée puis détruite.

La même année, pendant des travaux, un mikveh fut excavé. Les bains étaient directement reliés au Rhin.
Toujours sur la rive droite du Rhin, on a recensé des cimetières à Mülheim, à Zündorf, et à Deutz.
Le cimetière juif de Deutz fut loué à la communauté à partir de 1695, et les premiers enterrements eurent lieu en 1699.
Quand, en 1798, les juifs furent autorisés à s’installer de nouveau à Cologne, la communauté continua tout de même d’utiliser son ancien cimetière jusqu’en 1918.
Les grandes synagogues de Cologne
Au XIXe siècle, en conséquence de l’expansion de la communauté, la famille Oppenheim fait don d’un bâtiment pour y construire une synagogue au 7 Glockengasse.
On compte à cette époque environ 1000 juifs à Cologne. Si, à l’époque médiévale, le quartier juif était construit à proximité de la synagogue, les juifs sont, au XIXe siècle, mélangés au reste de la population, et vivent le plus souvent dans des quartiers périphériques. À la suite de la synagogue de Glockengasse, la synagogue orthodoxe d’Apernstrasse ouvre en 1884, et la synagogue libérale de Roonstrasse en 1899.

La synagogue de Glockengasse fut construite, grâce au financement de la famille Oppenheimer, en 1857 par Ernst Friedrich Zwirner, également l’architecte de la cathédrale de Cologne. Elle fut détruite lors de la nuit de Cristal. L’opéra moderne de Cologne fut construit à son emplacement, vous y trouverez une plaque commémorative.
Construite entre 1895 et 1899, la synagogue de la Roonstrasse a connu le même destin. Elle a été reconstruite en 1959 en s’inspirant du style néo-roman originel. On y trouve aujourd’hui un centre communautaire, un restaurant casher et une exposition sur les juifs de Cologne.
L’épreuve de la modernité
L’organisation sioniste allemande avait son siège à Cologne, à Richmodstrasse. Le bureau était dirigé par l’avocat Max Bodenheimer et David Wolffsohn. Ce que l’on appelle la « Thèse de Cologne » fut adoptée -avec quelques ajustements- lors du Premier Congrès sioniste, sous le nom « Programme de Bâle« .
Environ 40% des juifs de Cologne avaient émigrés en 1939. En mai 1941, la Gestapo parque les juifs de la ville dans le camp de concentration de Müngersdorf. Le 21 octobre 1941, le premier convoi part pour Lodz, le dernier pour Theresienstadt le 1ᵉʳ octobre 1944. Plus de 11 000 juifs de Cologne furent assassinés pendant la Shoah. Quand les troupes américaines libèrent la ville le 6 mars 1945, une trentaine d’hommes juifs qui avaient survécu en se cachant sont retrouvés.
Une petite synagogue fut construite en 1949. La communauté juive connut une petite renaissance et voyant ses fidèles augmenter, une synagogue fut construite dix ans plus tard sur la Roonstrasse, sur le lieu où la grande synagogue fut brulée pendant la Shoah. Un projet notamment soutenu par le chancelier allemand de l’époque, Konrad Adenauer, lui-même ancien maire de Cologne démis de ses fonctions par les nazis. Des représentants des autorités politiques, cultuelles et culturelles participèrent à son inauguration.
Sur le lieu de la zone archéologique de Cologne, un musée juif est en cours de construction depuis 2010. Le site, situé sous le Rathausplatz, mesurera environ 7000 m2 et retracera 2000 ans de présence juive à Cologne.
En 2020, un tramway de la ville a été décoré de textes et de symboles annonçant les célébrations de 2021 qui marquèrent les 1700 ans de la présence juive allemande. Avec en grand marqué « Schalomschen Koln ! » sur le véhicule.
En 2025, la communauté juive de Cologne est constituée de 5 000 personnes.

Grande ville sur les rives de la mer Noire et importante station balnéaire, Batoumi compte encore quelques sites juifs. Depuis Tbilissi, le plus simple et le plus agréable est de s’y rendre en train (environ 5h de trajet). Bel édifice de couleur blanche, la synagogue de Batoumi se trouve au numéro 33 de la rue Vazha-Pshavela, dans la vieille ville, que vous atteindrez depuis la gare en longeant le front de mer.

Elle fut construite entre 1900 et 1904 sur autorisation personnelle du tsar Nicolas II et selon les plans de l’architecte Simon Volkovich, qui s’inspira des synagogues d’Amsterdam et de la Haye.
La synagogue de Batoumi fut utilisée par les Juifs ashkénazes de la ville jusqu’en 1923. Elle fit ensuite office de salle de sport durant la période soviétique, avant d’être rétrocédée à la communauté en 1993 et réouverte en 1998.

A une dizaine de minutes à pied en remontant, vers le front de mer, la rue Vakhtang Gorgasali, vous trouverez au numéro 10 de cette dernière le Beit Habad de Batoumi, particulièrement actif en été durant l’afflux de touristes israéliens. A cette même adresse, vous pourrez manger casher chez Mendy’s, qui propose des plats géorgiens et israéliens, dans une ambiance très sympathique.
La Géorgie, et notamment la ville de Batoumi, représente depuis le pogrom du 7-Octobre, un lieu accueillant pour les juifs, à contre-courant de l’évolution de la situation dans de nombreuses villes européennes. En témoigne le développement de la vie juive locale. Batoumi compte quatre synagogues et plusieurs restaurants casher.

Vous pourrez également aller à la rencontre du judaïsme géorgien en vous rendant dans le village d’Akhaltsikhé. Situé sur la route de Batoumi, la deuxième ville du pays, Akhaltsikhé est accessible depuis Tbilissi soit en minibus, soit en taxi, comptez environ trois heures de route.
Vous pouvez également prendre le train jusqu’à la gare de Moliti, puis vous rendre en taxi à Akhaltsikhé. C’est dans le vieux quartier de Rabati, située au centre-ville sous la forteresse, que se trouve la plus vieille synagogue de Géorgie encore en service – de manière partielle.

Construite en 1863, cette synagogue de rite géorgien a fait l’objet d’une importante rénovation en 2012 et présente aujourd’hui un ravissant intérieur de bois peint.
Faisant partiellement office de musée où sont notamment exposées les portrait des générations de rabbins y ayant officié, elle est ouverte en été, pour les touristes, essentiellement israéliens, qui viennent visiter la région.
Dans la même rue, environ vingt mètres en contrebas, vous trouverez l’autre synagogue d’Akhaltsikhé, construite au début du vingtième siècle, qui est aujourd’hui laissée à l’abandon, après avoir servi de salle de sport à partir du début des années 1970.

L’édifice est toutefois demeuré en relatif bon état de conservation. Situé sur une colline surplombant l’ancien quartier juif, l’imposant cimetière juif d’Akhaltsikhé abrite des tombes dont certaines remontent au dix-septième siècle.
Les inscriptions en ladino que vous pourrez remarquer sur quelques-unes d’entre elles confirment qu’au moins une partie des Juifs de la ville y étaient arrivés depuis l’Empire ottoman.
Ils provenaient originellement de la péninsule ibérique, ce qui semble cohérent au vu de la proximité de la Turquie, distante de quelques kilomètres seulement. Vous pourrez terminer votre visite par le musée de la forteresse d’Akhaltsikhé, où sont exposés plusieurs tableaux représentant la vie de la communauté juive d’Akhaltsikhé au dix-neuvième siècle.
Deuxième plus grande ville du pays, Kutaissi est située à un peu plus de 200 kilomètres au nord-ouest de Tbilissi. Le moyen le plus économique de s’y rendre depuis la capitale est le minibus (environ 4 heures de route), et le plus agréable, le train (environ 5 h 30 de trajet).

La communauté juive de Kutaissi était l’une des plus importantes de Géorgie. Elle était établie dans un quartier situé de part et d’autre de la rue Boris Gaponov.
Ce dernier était le traducteur du géorgien vers l’hébreu du Chevalier à la peau de panthère, poème épique et élément central de la littérature géorgienne écrit au douzième siècle par Shota Rustaveli. C’est dans cette rue que se trouvent les trois synagogues de Kutaissi. La plus grande d’entre elles, au numéro 57-59, a été construite dans les années 1880.

Ornée d’impressionnantes fresques intérieures récemment restaurées, la grande synagogue de Kutaissi fonctionne encore pour le shabbat et les fêtes. Les deux autres synagogues, au numéro 8 et au numéro 10, construites dans les années 1860, de tailles plus modestes, sont désormais fermées : vous pourrez toutefois les visiter, surtout si vous venez en été.
Au nord du pays, la ville d’Oni, à environ 200 kilomètres de Tbilissi, abrite une merveilleuse synagogue, en excellent état de conservation, se trouvant rue Baazovi. Construit dans les années 1890 selon les plans d’un architecte venu des shtetl de Pologne et par des ouvriers juifs de Salonique, ce bel édifice de style mauresque accueillait au début du vingtième siècle la troisième communauté la plus importante du pays après celles de Tbilissi et de Kutaissi.

Selon une légende ancienne du judaïsme géorgien, l’une des pierres du deuxième Temple de Jérusalem, celles-ci auraient été dispersées dans les airs après sa destruction en 70, aurait atterri dans les montagnes du Caucase, à Oni. C’est à l’endroit où elle se serait écrasée que la synagogue aurait été construite. Au début du vingtième siècle, le rabbin d’Oni n’était autre que le célèbre David Baazov. C’est là que son fils Hertzel Baazov y naquit. Écrivain, il fut exécuté pour dissidence en 1938.
Fortement endommagée lors du tremblement de terre de 1991, la synagogue d’Oni a depuis fait l’objet d’une importante restauration. On soulignera qu’alors que la plupart des églises d’Oni avaient été détruites durant la période soviétique, la synagogue, grâce notamment à une forte mobilisation des habitants d’Oni et des Juifs de Tbilissi fut totalement épargnée. Elle n’est plus utilisée actuellement dans ses fonctions religieuses, mais peut encore être visitée : si vous vous trouvez dans la région, n’hésitez pas à vous y rendre, le détour vaut vraiment le coup. Si elle est fermée lors de votre passage, renseignez-vous auprès du musée d’Oni, situé à proximité, au 26 rue Rustaveli.
Oni compte également un cimetière juif aujourd’hui peu entretenu, qui se trouve à environ 500 mètres au nord de la synagogue, un peu plus haut sur la rue Baazovi.
Non loin de Tbilissi également, à environ 90 kilomètres, la ville de Gori, lieu de naissance de Joseph Staline auquel est d’ailleurs consacré un musée.

La marshroutka constitue le moyen le plus économique : départ toutes les 20 minutes environ depuis la gare routière de Didube à Tbilissi pour environ un euro (3 GEL) et une heure et demie de trajet. Vous pourrez sinon y aller en taxi, pour une vingtaine d’euros. Au 25 de la rue Kasteli, au premier étage de la cour d’une maison, vous pourrez voir la petite et chaleureuse synagogue de Gori, construite dans les années 1940 : à cette adresse se trouve également un mikveh et un four traditionnel à matsot. Lors de notre passage, la communauté juive de Gori, réduite aujourd’hui à une petite vingtaine de personnes après que plus de 200 fidèles ont quitté la ville à la suite du conflit russo-géorgien de 2008, se réunissait encore dans la synagogue pour shabbat. Le cimetière de Gori, qui compte un carré juif, se trouve à l’orée de la ville, à environ une vingtaine de minutes à pied du centre. Vous pourrez y accéder en remontant, depuis le musée Staline, la rue Sameba.

L’essentiel des sites juifs qu’abrite la belle Tbilissi sont concentrés dans la vieille ville, dans les quartiers se trouvant le long de la rive gauche de la rivière Koura.
En partant de la place Vakhtang Gogasali (place Meidan), située à proximité des traditionnels bains persans, prenez l’artère principale de la vieille ville, la rue Kote Afkhazi, que vous remonterez sur une petite centaine de mètres pour voir sur votre gauche la grande synagogue de Tbilissi .

Construite au début du vingtième siècle dans le quartier de l’ancien bazar arménien par des fidèles venus d’Akhaltsikhe, au sud de la Géorgie, d’où le nom de synagogue d’Akhaltsikhe parfois utilisé pour la désigner, la grande synagogue de Tbilissi est un imposant édifice en briques d’inspiration mauresque, aux façades intérieures décorées de belles fresques or et bleu récemment rénovées.
Si vous vous trouvez à Tbilissi pendant Shabbat ou durant une fête juive, ne manquez pas d’assister aux offices de la grande synagogue, menés selon le rite juif géorgien et accueillant généralement un nombre assez important de fidèles. Profitez de votre passage à la synagogue pour aller faire un tour au restaurant David, attenant à cette dernière et dans lequel vous pourrez déguster, dans les règles les plus strictes de la casheroute, de succulents plats géorgiens comme les khinkali, sorte de gros raviolis fourrés, ou encore les katachpuri, grands pains farcis.
Toujours dans ce registre gastronomique, vous trouverez à proximité de la grande synagogue, au 2/5 de la rue Ierusalem un autre restaurant kasher, le restaurant Jerusalem ouvert par des Juifs géorgiens revenus d’Israël dans les années 2000.

En reprenant la rue Kote Afhazi qui se prolonge en rue Leselidze, vous verrez au numéro 28 de cette dernière la petite synagogue de Tbilissi dite synagogue ashkénaze, située dans une cour formée d’un ensemble de maisons traditionnelles, et signalée par un panneau en hébreu depuis la rue. Initialement construite au début du vingtième siècle pour la communauté juive ashkénaze de Géorgie, cette synagogue, également nommée Beit Rachel, a été reconstruite en 2009, l’édifice original ayant été fortement endommagé à la suite du tremblement de terre de 1991. Les services de Shabbat et des fêtes sont régulièrement organisés dans cette synagogue par le mouvement Habad. Si vous vous trouvez à Tbilissi pendant Shabbat, vous pourrez également passer le dîner au sein de cette communauté : c’est une expérience toujours très chaleureuse. La petite synagogue de Tbilissi dispose également d’un Beit Habad.
Remontez la rue Kote Afkhazi jusqu’au croisement avec la rue Anton Katalikosi, que vous emprunterez jusqu’au numéro 3 où se trouve le musée juif de Tbilissi . Nommé en l’honneur de David Baazov, rabbin géorgien qui joua un rôle conséquent dans le développement du mouvement sioniste local, le musée juif de Tbilissi a été inauguré en 1932, puis fermé en 1951, dans un contexte marqué par une montée d’antisémitisme au sein des autorités soviétiques : c’est effectivement l’époque de la lutte contre le « cosmopolitisme » et du soi-disant « complot des blouses blanches ».
Ses portes ont été réouvertes en 1992, après l’indépendance, et il est aujourd’hui situé dans un bel immeuble de briques construit au début du vingtième siècle et faisant précédemment office de synagogue. De taille modeste, le musée juif de Tbilissi abrite un certain nombre d’objets de la vie quotidienne et religieuse des Juifs géorgiens et offre ainsi un précieux panorama sur cette communauté à l’histoire souvent méconnue. Vous pourrez également y admirer les tableaux de Shalom Koboshvili (1876-1941) et de David Gvelesiani (1890-1949), deux célèbres peintres géorgiens de confession juive. En outre, le musée David Baazov accueille régulièrement des expositions temporaires, généralement dédiées à l’histoire des communautés juives d’Europe.

Le musée national de Géorgie , situé non loin de la place de la Liberté sur l’avenue Shota Rustaveli, dispose également d’un fond juif conséquent, qui a fait ces dernières années l’objet d’un admirable travail de valorisation.
Enfin, vous pourrez également admirer à l’Institut des manuscrits de Géorgie situé un peu plus au nord de la ville à proximité de la station de métro Technical University, une splendide Torah datant du 10ième siècle, découverte dans les années 1940 en Svanétie, dans le village de Lailashi.

Vous pourrez terminer votre promenade dans Tbilissi la juive par une visite des cimetières juifs situés en périphérie de la ville. On en compte trois. Celui traditionnellement réservé à la communauté ashkénaze se trouve dans le village de Navtlugi. Le village d’Ortchala abrite un autre cimetière juif. Ces deux cimetières ne sont plus en activité, mais demeurent entretenus par la communauté, qui continue d’enterrer ses fidèles au cimetière de Dampalo dans le village de Varketili. Dans la mesure où ces trois cimetières se trouvent en périphérie de Tbilissi, le taxi est encore le moyen le plus simple de s’y rendre.
Depuis quelques années, et tout particulièrement depuis le pogrom du 7-Octobre, des villes géorgiennes, parmi lesquelles Tbilissi, connaissent un développement de la vie juive locale, loin des nombreuses manifestations et actes d’antisémitisme présents dans de nombreuses villes européennes.

La présence juive dans la ville moldave de Buhuşi (Bohush en yiddish) date de 1823. En 1831, on comptait 32 juifs dans la ville ; 537 en 1858, pour atteindre 1732 en 1899, soit 48% de la population totale de la ville. Le nombre diminue ensuite jusqu’à la Première Guerre mondiale à cause de l’émigration (892 en 1910), puis remonte progressivement : 1419 en 1915, 1972 en 1930, 1878 en 1941.
La plupart des juifs travaillait dans l’industrie du textile. On comptait également des artisans et des commerçants. Une école communautaire ouvre ses portes en 1892. À la fin du XIXe siècle, la ville accueille quatre synagogues, et le mouvement sioniste est de plus en plus actif.
Notons que Buhuşi était le centre hassidique le plus important du royaume de Roumanie avant la Première Guerre mondiale. Le tsadik Yitshak ben Shalom Yosef Friedman (1834-1896), de la dynastie Ruzhin-Sadagora, établit son tribunal rabbinique à Buhuşi en 1860. La dynastie continue avec Yisra’el Shalom Friedman (1856-1923), président de la communauté juive roumaine en Palestine.
Buhusher khusid, une mélodie moldave
La très célèbre mélodie klezmer « Buhusher khusid » fait référence aux traditions des hassids de Buhuşi -d’où son titre. Elle fut composée en 1916 par Joseph Moskowitz. Vous pouvez en écoutez une version en cliquant sur ce lien.
En 1908, une yeshiva est fondée par celui qui sera le dernier rabbin de la ville, Menahem Mendel Friedman. Il fut également membre du conseil municipal en 1922, ce qui en dit long sur l’importance de la communauté dans la ville. La yeshiva fonctionnera jusqu’à sa fermeture par les autorités en 1940.
Les juifs sont victimes de persécutions déjà dans la période de l’entre-deux-guerres. En 1929, des tracts antisémites sont distribués dans la ville. En 1937, les juifs sont agressés et découragés de participer aux élections.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, la plupart des bâtiments appartenant à la communauté sont confisqués. La synagogue et la maison du rabbin sont occupées par l’armée roumaine, et réduites à l’état de ruines. En 1941, les juifs des villages adjacents (Rediu, Roznov, Tazlău, Cândeşti, et Borleşti) sont déportés à Buhuşi. Les juifs de la ville devaient les abriter chez eux. Le rabbin Menahem Mendel Friedman, malade et devant subir une opération à Bucharest, est empêché de quitter la ville par les autorités. Il y meurt en 1943.
Pendant la guerre, les juifs sont réquisitionnés pour les travaux forcés. Après 1944, ceux qui avaient été forcés de s’installer à Buhuşi finissent par s’y établir. En 1947, la population juive s’élève à 2000 personnes. Ce nombre va en s’amenuisant, au vue de l’émigration massive vers Israël. Yitshak ben Shalom Yosef Friedman, le dernier neveu du rabbin, s’établit à Bucharest et prend le nom de Bohush Rebbe. Il immigre en Israël en 1951, et transfère le tribunal rabbinique à Bnei Brak. Les hassids visitent toujours aujourd’hui la synagogue de Buhuşi, et les tombes des rabbins de la dynastie dans le cimetière juif. La visite de ce cimetière est vivement recommandée, on peut en effet y observer des exemples magnifiques de décorations de pierres tombales. La synagogue est également ornée de fresques admirables, restaurées en 2012. En 2005, 5 juifs vivaient à Buhuşi.
La ville de Baia Mare se situe au nord de la Roumanie, sur les bords du fleuve Sāsar, et au pied des montagnes Gutai. La présence d’une communauté juive dans cette ville minière est notée dès le XVIIe siècle. Après la prise de pouvoir autrichienne sur la région -entre 1693 et 1700-, l’accès des juifs aux villes minières est interdit. Les restrictions se poursuivent jusqu’en 1850. En 1855, on note la présence du rabbin Tsevi Yehudah Horovitz dans la ville, ce qui indique que l’interdit est levé.

La communauté est officiellement rétablie en 1860. En 1861, les juifs peuvent enterrer leurs morts dans la ville. La synagogue est consacrée en 1887. Conséquemment, le nombre de juifs augmente. De 202 en 1869, on en recense 701 en 1890 (7 % de la population locale), 963 en 1900 (823 en 1941 (16,9 %). La communauté était dans sa majorité orthodoxe à tendance hassidique.
La synagogue Beith Avraham voit le jour en 1903, et un nombre important de salles de prière ouvre entre 1904 et 1911. En plus de la yeshiva ouverte par le rabbin Levi Samuel Weinberg (rabbin de la ville entre 1896 et 1906), un Talmud Torah est inauguré en 1911. Il compte dès son ouverture 4 enseignants et 120 étudiants. L’école communale juive fonctionne jusqu’en 1922. Entre les deux guerres mondiales, une organisation sioniste a pignon sur rue et jouit d’un succès considérable dans la ville.

En 1930, 4 des plus grandes usines de la ville sont tenues par des familles juives (industrie chimique, verre, teinturerie, savon). On recense à cette époque 5 grands industriels, plus de 160 commerçants, 100 artisans, 30 employés, 12 avocats, 6 pharmaciens, 4 ingénieurs, 2 journalistes, et 2 artistes issus de la communauté juive. Des associations professionnelles et philanthropiques étaient également installés dans la ville.
Après 1940, Baia Mare est inclue dans la section de la Transylvanie du nord, et donc sous contrôle de la Hongrie. Entre 1942 et 1944, un centre de recrutement pour les détachements de travaux forcés est installé dans la ville. Le commandant du centre, le colonel Imre Reviczky, en bonne intelligence avec le rabbin de la ville, Moses Aron Krausz, sauve les juifs de la ville. Il fut reconnu Juste entre les Nations en 1965. En avril 1944, la communauté compte 3340 membres et était présidée par l’avocat Farkas Sarudi.
En mai 1944, après l’occupation de la Hongrie par les troupes nazies, débute le processus de déportation des juifs vers, d’abord les ghettos, puis Auschwitz. L’un des 13 ghettos de la Transylvanie du nord est établi à Baia Mare. Les 5917 juifs enfermés entre ses murs furent déportés les 31 mai et 5 juin 1944. Les rares survivants reconstituent la communauté sous l’impulsion de Hayim Alter Panet (rabbin de la ville entre 1945 et 1951). En 1947, on compte environ 950 juifs à Baia Mare, cependant elle émigra en masse dans les années qui suivirent. Dans les années 1960, on dénombre environ 160 juifs dans la ville et, dans les années 2000, à peu près 80.
Il est à noter qu’une grande partie des objets de culte et de la vie quotidienne des famille juives, datant d’entre les années 1850 et la Shoah, ont été donné par la communauté juive de Baia Mare au Musée de l’Holocauste de Washington DC. Vous pouvez découvrir quelques photographies de la collection en cliquant sur ce lien.
La synagogue, construite en 1885, est classée monument historique. Elle a été rénovée par la municipalité en 2013 et abrite aujourd’hui un centre culturel.
Héros de guerre et Juste parmi les Nations : Imre Reviczky
Issu de l’une des plus prestigieuses et des plus anciennes familles aristocratiques de son pays, Imre Reviczky était un lieutenant colonel de l’armée hongroise. En 1943, il est nommé commandant du bataillon 10 en Transylvanie, au poste de recrutement de la main d’oeuvre militaire juive et roumaine de la région. À son arrivée à Baia Mare, Reviczky met fin aux abus et maltraitances dont sont victimes ces minorités, et fait en sorte qu’ils soient traités sur un pied d’égalité avec les soldats hongrois. Reviczky insiste pour recevoir directement les plaintes, au lieu de les laisser traiter par ses subalternes, supervisant ainsi l’entièreté de ses troupes. Après l’invasion allemande en Hongrie, le quartier général de Reviczky devient un lieu de refuge qui permet à un certain nombre de juifs d’échapper à la déportation à Auschwitz. Il envoya même aux juifs du ghetto, de tout âge et condition physique, de fausses convocations à rejoindre l’armée, pour les sauver d’une mort certaine.
Au péril de sa vie, il fit tout son possible pour empêcher que les juifs soient déportés ou envoyés sur le front russe, parfois en désobéissant aux ordres directs. Il refuse également de transférer ses soldats et ses munitions aux troupes allemandes quand ordre lui en est donné. Quand les Croix fléchées prennent le pouvoir en octobre 1944, il envoie ses soldats couper des arbres dans la forêt, pour leur permettre de s’enfuir. Avec ce qu’il reste de son bataillon, qui inclut beaucoup de juifs, Reviczky atteint la ville de Szalonna, près de la frontière slovaque. Il apprend à son arrivée que les Croix fléchées et les nazis prévoient d’exécuter tous les juifs dès le lendemain. Il réussit à faire transmettre cette information au plus grand nombre de juifs – civils et soldats- leur permettant de s’enfuir à temps, et leur fournissant même de la nourriture et des vêtements.
Grâce à cette action, un certain nombre de juifs parvient à rejoindre les partisans slovaques. Reviczky est arrêté par les Croix fléchées, et n’est sauvé de l’exécution que grâce à l’avancée rapide de l’Armée rouge. Après la guerre, Reviczky est nommé Général. Cependant, à la fin de la période démocratique en Hongrie à la fin des années 1950, il est destitué et sa maigre pension de guerre confisquée. Jusqu’à sa mort en 1957, il gagne péniblement sa vie dans un hangar à charbon.
Il fut reconnu comme Juste parmi les Nations en 1965, et une rue de la ville de Safed, en Israël, porte son nom. Fin 2018, une statue a été élevée en sa mémoire au cimetière de Fiume à Budapest.
La ville de Trancoso est une ancienne cité au carrefour de nombreuses guerres, transformée à ce titre en forteresse. La présence juive date probablement du 12e siècle. Elle ne tarda pas à voir sa population augmenter suite à l’inquisition espagnole par l’arrivée principalement de juifs d’Aragon et de Castille. Conséquemment, la communauté demanda au roi Jean II le droit d’agrandir la synagogue.

La ville médiévale de Trancoso est très fortement marquée par son passé juif. En effet, tout au long du Moyen Âge, la communauté de cette ville du nord du Portugal a connu une expansion économique et sociale quasiment unique en Europe. Trancoso, grâce à son importante foire, était une ville de passage et d’échanges.
Au XVe siècle, la population juive s’élève à plus de 500 personnes, ce qui oblige la communauté à s’établir en dehors des frontières de la judaria. Aujourd’hui encore, on trouve de nombreuses traces de ce passé dans les rues de Trancoso. Suite à l’instauration de l’Inquisition au Portugal, de nombreux juifs de Trancoso furent victimes de persécutions.
En vous promenant dans la ville, vous découvrirez des inscriptions en hébreu, des étoiles de David, et autres symboles sur les chambranles de portes. Partez de la Porte El Rei et rendez-vous vers les rues Corredoura et São João. Dans la rue Estrela, vous trouverez également des inscriptions. Dans la rue Banderra, un chandelier gravé dans la pierre. À Largo Luís de Albuquerque, admirez la maison juive la plus célèbre de la ville : Casa de Gato Preto , la Maison du chat noir.
Un lion de Judah et les murailles de Jérusalem sont gravées autour de la porte. Il est probable que cette maison ait appartenu au rabbin de la communauté, voire même que le bâtiment abritait la synagogue. Continuez votre chemin vers les rues Algria et Mercadores, et enfin vers la rue Cavaleiros où se trouve une étoile de David gravée. Sur la place Dinis, où, dans les années 1980, on a découvert dans une maison un rouleau contenant le Shema Israël dans un mur.
Finissez votre visite par le Centre culturel d’interprétation juive Isaac Cardoso. Fondé en 2012, cet espace, conçu par l’architecte Gonçalo Byrne, accueille, en plus du centre, la synagogue Beit Mayim, un jardin, deux salles d’expositions temporaires, une salle de conférence, et une cour où l’on a retrouvé un puit et des inscriptions hébraïques. Dans le centre, vous pourrez accéder à des archives sur l’histoire des 700 juifs de Trancoso persécutés pendant l’Inquisition. Le centre catalogue également toutes les inscriptions retrouvées dans la ville, à ce jour au nombre de 300.
Un grand érudit de Trancoso : Isaac Cardoso
Isaac (Fernando) Cardoso était un physicien, philosophe, et écrivain juif. Il est né de parents marranes en 1603 ou 1604 à Trancoso, et décède à Vérone en 1683. Il était le frère d’Abraham (Miguel) Cardoso.
Après avoir étudié la médecine, la philosophie, et les sciences naturelles à Salamanque, il s’installe à Valladolid en 1632, puis à Madrid. Parmi les ouvrages qu’il publie en Espagne, on compte un traité sur le Vésuve, la couleur verte, ou encore l’eau froide.
Né Fernando, il quitte l’Espagne, probablement pour échapper à l’Inquisition, et s’exile avec son frère Miguel à Venise. Les deux frères ré-adoptent le judaïsme et modifient leur prénoms pour Isaac et Abraham. Il meurt à Vérone, reconnu et estimé des communautés juives et chrétiennes.
Cardoso publie à Venise en 1673 le traité Philosophia Libera in Septem Libros Distributa, dans lequel il s’affirme comme un ennemi déclaré de la Kabbalah et du faux-prophète Sabbataï Zevi -son frère en était un partisan.
Enfin, l’œuvre la plus importante de cet « érudit craignant-Dieu », comme l’a décrit Moses Hagiz, reste Las Excelencias y Calunias de la Hebreos, imprimée en 1679 à Amsterdam. Dans cet ouvrage, il défend « l’excellence » de ses coreligionnaires : leur sélection par Dieu, leur séparation des autres peuples grâce aux lois spéciales, leur compassion, philanthropie… Il réfute ensuite les « calomnies » qui leur sont faites : meurtres rituels, fausses idoles, blasphème des images sacrées… Ce traité fit grand bruit à sa parution, et fut célébré par les plus grands rabbins et érudits d’Europe.
Sources : Encyclopaedia Judaica, Rede de Judiarias

La terrifiante guerre menée contre l’Ukraine change, bien entendu, la fonction de ces pages consacrées au patrimoine culturel juif de ce pays. Une grande partie des lieux mentionnés ont été rasés par les bombes. Si ces pages ukrainiennes n’ont pas actuellement de vocation touristique, elles pourront peut-être servir à des chercheurs et étudiants comme références historiques. Références à tant d’histoires douloureuses lors des pogroms et de la Shoah, mais aussi heureuses du judaïsme ukrainien, dans ses dimensions culturelle, cultuelle et sioniste. En souhaitant au peuple ukrainien une fin rapide à ces atrocités dont il est victime.
Située en Podolie, à équidistance de Kiev et d’Odessa, Vinnytsa est une ville aux rues pavées, aux élégantes avenues et aux nombreux jardins, encore très marquée par son passé polonais. Sa fondation remonte au XIVe siècle, au moment où la Podolie rentre dans le grand-duché de Lituanie.

Intégrée à la république de Pologne-Lituanie à la fin du XVIe siècle, elle est alors la capitale de la province de Braslav – fondamentale dans l’histoire du hassidisme européen – et un centre commercial, artistique et culturel majeur. En 1793, à la suite du deuxième partage de la république de Pologne, Vinnitsa est intégrée à l’Empire russe et devient la capitale administrative de la région de Podolie, alors frontalière de la Pologne. Cette proximité explique l’ambiance très MittelEuropa que vous ressentirez dans la ville, alors même que Vinnytsia restera sous l’autorité des tsars puis des Soviets jusqu’en 1991. Pour vous rendre à Vinnytsia depuis Kiev ou Odessa si vous n’êtes pas déjà en Podolie, le plus simple et le plus confortable est le train : comptez environ 4 heures et une dizaine d’euros, plusieurs départs par jour.
Développement de la culture juive
Les premières traces de présence juive à Vinnytsa remontent au XVIe siècle. La population juive de la ville, massacrée une première fois en 1698 lors de la prise de Vinnytsa par Bogdan Khmelnistky, puis en 1750 lors du soulèvement des Haidamaks, croît rapidement après cette vague de pogrom. Elle représente 12 000 personnes (soit environ 36 % de la population) à la fin du XIXe siècle, alors que la ville compte une vingtaine de synagogues. Si la vie religieuse rentre en suspend avec le début de la période soviétique à partir des années 1920 – alors que près de la moitié de la population de la ville est juive – la vie culturelle se poursuit autour de la Yevseksia et de plusieurs publications en yiddish jusqu’au début des années 1930.

La majorité des Juifs de Vinnytsa, occupée dès juin 1941 par les forces nazies, sera exécutée, comme en témoigne la tristement célèbre photographie intitulée Le dernier Juif de Vynnitsa, prise par un SS lors de l’ultime massacre de masse des Juifs de la ville en avril 1942. Ce document sera ensuite utilisé au cours des procès de Nuremberg comme élément à charge. Une petite communauté juive, s’élevant à environ 1000 personnes, subsiste à Vinnytsia aujourd’hui.
Promenade dans les lieux marquants
Votre promenade dans Vinnytsa la juive commence dès votre arrivée, puisqu’en face de la gare, à l’angle de la rue Batozka et Kotsybunsko’ho se trouve un grand édifice d’une belle couleur rouge datant de la fin du XIXe siècle. Il abritait auparavant la manufacture de Baruch Moisevich Lvovich, l’un des plus richesentrepreneurs de la ville. Sa villa, de style néo-classique et en excellent état de conservation, se trouve un peu plus loin dans le centre-ville, au 15 de la rue Petlioura (anciennement rue Chkalova).
Après avoir été saisie par le gouvernement Petlioura lorsque Vinnytsa fut brièvement capitale de l’Ukraine indépendante, elle fut transformée par les Soviets en maison de la radio, en 1932. Pour vous diriger vers le centre-ville, empruntez la rue Kotsybunsko’ho jusqu’au fleuve Bug que vous traverserez pour vous retrouver au début de la principale artère de la ville, la rue Soborna. Au numéro 62, vous verrez la principale synagogue de la ville, encore en activité.
Belle bâtisse de trois étages, cette synagogue fut construite à la fin du XIX siècle grâce au financement de l’entrepreneur Livchitz, qui lui a donné son nom. Fermée par les autorités soviétiques en 1929 et transformée en club artistique, elle sert de théâtre pour l’occupant nazi durant la seconde guerre mondiale, puis de salle philharmonique pendant la période soviétique. Elle est rendue à la communauté juive en 1992, et fait désormais office de principal lieu d’activité religieuse juive de la ville.
Visite du mythique Hôtel Savoy
Attenant à la synagogue, vous verrez l’immeuble Brosky, du nom de son propriétaire initial. Cet édifice constitue l’une des singularités architecturales les plus marquées de la ville. En face de la synagogue, au numéro 69 de la rue Soborna, admirez la façade du très bel hôtel Savoy, dont la construction, commandée en 1912 par Berich Markovich Lekhtman, fut confiée au plus célèbre architecte de la ville, Grigori Grigorievitch Artinov. Encore en activité et idéalement situé, l’hôtel Savoy pourra vous servir de logement si vous décidez de passer la nuit à Vinnytsia ou en Podolie.

Vous arriverez juste après l’hôtel Savoy au croisement des rues Soborna et Artinova, que vous emprunterez pour rentrer dans Ierusalimka, le quartier historique juif de Vinnytsia. Ce quartier, bien conservé, a notamment servi de décor au Bonheur juif, film réalisé en 1925 par Alexei Granovski, avec un scénario d’Isaac Babel.
Prenez sur votre gauche la rue Hrytcheskovo, où au numéro 8 se trouve l’autre synagogue en activité de Vinnytsia, qui fait également office de siège officiel de la communauté de la ville ainsi que de Beit Habad. C’est ici qu’en alternance avec la synagogue de la rue Soborna sont organisées les fêtes juives.
Synagogues classées monuments historiques
Continuez la rue Hrytcheskovo, passez la rue Simon Petlioura (où se trouve la demeure de B.M. Lvovich) jusqu’à la rue Chervonokhrestivs’ka, où vous verrez au numéro 11 l’édifice de la synagogue Raikher. Financée par le docteur Raikher et conçue par le principal architecte de Vinnytsia, Artinov, cette synagogue en brique de style néo-gothique fut transformée en salle de sport à la fin des années 1920, quoiqu’un service religieux y subsista jusqu’au début de la Seconde Guerre mondiale. Le bâtiment est désormais classé aux monuments historiques. Descendez la rue jusqu’à vous retrouver de nouveau rue Soborna.
À proximité, rue Alexandra Solovieva, vous pourrez vous arrêter pour déguster un café ou un chocolat chaud dans l’ancienne boutique de thé, de café et d’épices ayant appartenu au début du vingtième siècle à la famille Fliegentyb. Alors que son entreprise de torréfaction fleurissait et qu’il ouvrit bientôt des succursales à Kiev, Moscou et Saint-Pétersbourg, Moishe Fliegentyb dut changer de nom et adopter un patronyme moins marqué, Matvee Zavarkine, pour avoir accès à la cour impériale. Cette boutique, toujours ouverte aujourd’hui, est partiellement transformée en musée, dans lequel il est très plaisant de boire un verre.
Mémorial en l’honneur des victimes de la Shoah
Vous arriverez dans la rue Monastirska, où se trouve la maison dans laquelle naquit le peintre soviétique d’avant-garde Nathan Altman. L’artiste quitta Vinnytsia pour l’école des beaux-arts d’Odessa en 1902, avant de s’installer à Paris puis de retourner dans les années 1930 en Union soviétique. Le peintre immortalisa les ruelles de Ierusalimka dans plusieurs de ses tableaux, parmi lesquels Les funérailles juives, représentation de la mort de son grand-père, ou encore dans un recueil de dessins, Vinnytsia en caricatures. Au bas de la rue Kropivnitskovo, à l’angle avec la rue Kniaziv Koriatovychiv se trouve un monument en l’honneur du poète Efim Aptekman, l’un des fondateurs du mouvement « marxiste futuriste ».
Ce monument fait également office de mémorial en l’honneur des victimes juives de la Shoah à Vinnytsia, le ghetto instauré pendant la Seconde Guerre mondiale se trouvant dans ce quartier. Le principal monument en l’honneur des victimes de la Shoah de Vinnytsia se trouve à l’endroit où furent exterminés, en septembre 1941, plusieurs milliers de Juifs de Vinnytsia. Le mémorial, composé de deux monuments, l’un pour les adultes, l’autre pour les enfants, se trouve en bordure de la ville, au niveau de la rue Maksimovicha. Pour vous y rendre, privilégiez le taxi, le lieu se trouvant en bordure de la ville.
Vous pourrez terminer votre journée à Vinnytsia par un dîner au restaurant Lvovskaya Cukernaya, très agréablement situé à l’orée du parc et proposant, dans une ambiance délicieusement surannée, un large choix de plats et de pâtisseries polonaises et ukrainiennes.

La terrifiante guerre menée contre l’Ukraine change, bien entendu, la fonction de ces pages consacrées au patrimoine culturel juif de ce pays. Une grande partie des lieux mentionnés ont été rasés par les bombes. Si ces pages ukrainiennes n’ont pas actuellement de vocation touristique, elles pourront peut-être servir à des chercheurs et étudiants comme références historiques. Références à tant d’histoires douloureuses lors des pogroms et de la Shoah, mais aussi heureuses du judaïsme ukrainien, dans ses dimensions culturelle, cultuelle et sioniste. En souhaitant au peuple ukrainien une fin rapide à ces atrocités dont il est victime.
Située sur les confluents de l’Ingul et du Boug, la ville de Nikolaïev occupe une place dans l’imaginaire juif européen bien moins importante que celle de la mythique Odessa, voisine d’à peine 200 kilomètres. Nikolaïev peut toutefois s’enorgueillir d’une riche histoire juive : c’est notamment dans ses faubourgs qu’au début du vingtième siècle, le grand rabbin loubavitch Menachem Mendel Schneerson y naquit et que le non moins célèbre écrivain Isaac Babel y passa quelques années.

Pour vous rendre à Nikolaïev, le plus simple et le moins onéreux est de privilégier la marshroutka depuis la gare routière de Privoz à Odessa : en journée, un départ toutes les 15 minutes environ. Une fois arrivé à Nikolaïev, demandez à descendre à l’arrêt de la rue Tsentralnaya (anciennement rue Sovietskaya), qui se trouve être la seule rue piétonne de la ville, non loin d’ailleurs des synagogues. Depuis Odessa, vous pouvez également gagner Nikolaïev en taxi, pour une soixantaine d’euros.
Une communauté composée de juifs galiciens
Les premières traces de présence juive à Nikolaïev remontent à la fondation de la ville en 1789 : la communauté est alors essentiellement composée de Juifs de Galicie venus pour participer à la construction de ce nouveau port de l’Empire russe. Ils forment rapidement une population suffisamment nombreuse pour qu’en 1819 soit débutée la construction de la première synagogue de la ville, désormais nommée la vieille synagogue, dont vous pourrez admirer l’édifice.
En 1829, arguant de la présence de bases militaires, les autorités impériales russes émettent un décret interdisant aux Juifs de résider à Nikolaïev. Conscientes du rôle majeur que jouent les Juifs dans l’expansion économique de Nikolaïev, notamment pour ce qui concerne le développement du commerce de grains, les autorités de la ville s’opposent à cet oukase, qui fut néanmoins appliqué à partir de 1834. C’est finalement sous le règne d’Alexandre II (1855-1881) que Nikolaïev est intégré à la Zone de résidence et que les Juifs y acquièrent pleinement droit de cité.
Lieu de naissance du rabbi Schneerson
Selon le recensement de 1897, la communauté juive de Nikolaïev représente environ 22000 personnes, soit 20% du total de la population, et la ville comptait deux synagogues, 15 lieux de prières et 15 écoles. C’est à cette époque (1902) qu’y naquit le septième et dernier rabbin de la dynastie loubavitch, Menachem Mendel Schneerson, figure majeure du mouvement Habad qui s’éteindra en 1994 dans les faubourgs de Brooklyn. C’est également à cette époque que grandit dans les rues de Nikolaïev le jeune Isaac Babel avant de revenir à Odessa.
Vous pourrez commencer votre promenade en partant de la rue Tsentralnaya, autour de laquelle se trouvent l’essentiel des sites juifs de la ville. Remontez Tsentralnaya jusqu’à la rue Mala Morskaya, que vous emprunterez jusqu’à la rue Velika Morskaya. En tournant à droite, au numéro 71 se trouve l’immeuble, encore de très belle apparence ayant accueilli à partir des années 1870 la pharmacie Landau, l’une des plus grandes de la ville.
En remontant la rue dans l’autre sens, vous croiserez la rue Schneerson (anciennement rue Karl Liebknecht) : au numéro 15, se trouve la seule synagogue de la ville encore en activité, animée par le courant Habad, ainsi qu’un imposant mikveh.
Quartier juif de la ville
C’est là que se retrouve la communauté juive de la ville, forte d’environ 2 000 personnes. A proximité immédiate, au numéro 13, vous pourrez admirer l’édifice de la première synagogue de Nikolaïev, dont la construction fut achevée en 1822, et qui était alors parfois nommée synagogue des cordonniers, les artisans juifs étant les principaux fournisseurs de chaussures pour les marins de la ville. En dépit de son aspect délaissé, ce bâtiment reste en relativement bon état, alors qu’il ne remplit plus de fonction religieuse depuis… 1935.

À cette époque, les autorités soviétiques ordonnèrent effectivement la fermeture de la synagogue, dont les locaux furent transmis à diverses organisations syndicales ou culturelles. Ce changement imposé de fonction explique le curieux syncrétisme que vous pourrez constater en regardant la façade de la synagogue, partiellement ornée de fresques soviétiques.
Les études d’Isaac Babel
Continuez la rue Velika Morskaya jusqu’au croisement avec la rue Artilleriskaya, où vous tomberez au numéro 19 sur le bâtiment de l’ancienne école de commerce de Nikolaev. C’est dans cette école, majoritairement financée par des commerçants juifs de la ville et de ce fait non soumise aux quotas d’entrées concernant les Juifs dans les établissements d’enseignement secondaire de la Russie tsariste, qu’Isaac Babel passa quelques années, comme en témoigne la plaque en son honneur apposée sur la façade de ce bâtiment.
La rue Spasskaya, parallèle à la rue Velika Morska, compte plusieurs opulentes demeures ayant appappartenu des membres de la haute bourgeoisie juive de Nikolaev et encore en parfait état. Parmi celles-ci, vous pourrez notamment admirer, au numéro 18, la demeure de la famille Meshyres ayant fait fortune dans le commerce de grains, et juste à côté, au numéro 20, la maison d’une autre grande famille de la bourgeoisie juive de Nikolaev, la famille Erlikh. Une statue de Mercure, dieu des commerçants, surplombe cette belle demeure aux teints ocres et pastels. Allez jusqu’au numéro 33 de cette même rue, où se trouve l’imposante demeure à la façade bleue et blanche et décorée de colonnes de la famille Forshteter.
Monument en l’honneur du rabbi loubavitch
Revenez ensuite sur vos pas vers la rue Tsentralnaya et engagez-vous dans la rue Moskovskaya. Au croisement avec la rue Potemkinskaya, au numéro 67 de cette dernière, se trouve l’édifice qui accueillait avant la révolution de 1917 l’un des heder de Nikolaev.
Construit dans les années 1820 dans un style mauresque, le bâtiment servait initialement de pharmacie avant d’être transformé en institution religieuse. Il a conservé toute sa façade. En retournant dans la rue Moskovskaya, vous pourrez, au numéro 69 voir le monument en l’honneur du rabbi Schneerson, érigé en 2011 là où se trouvait la maison dans laquelle le rabbin Loubavitch naquit en 1902.
Nombreuses victimes de la Shoah
Vous pourrez terminer votre journée dans Nikolaïev la juive en vous rendant en bordure de la ville, au bout de la rue Tsentralnaia. A proximité du rond-point formé par la rue Tsentralnaia et la route de Kherson se trouve le monument à la mémoire des victimes de la Shoah : environ 10 000 Juifs de Nikolaev furent assassinés pendant la guerre, dont la moitié en août 1941, lors de la prise de la ville par les troupes nazies, qui ne l’évacueront qu’en 1944.
La région de Nikolaev occupe une place centrale dans l’histoire de la Shoah par balles, puisque c’est essentiellement au nord de cette ville que les principaux ghettos de ce que les forces d’occupations roumaines avaient alors nommée Transnistrie se trouvaient. Ces lieux de massacres se trouvant en pleine campagne ukrainienne sont souvent signalisés par un mémorial, et des membres de la communauté juive de Nikolaev pourront éventuellement vous aider à les localiser. En remontant depuis ce mémorial la route de Kherson sur environ deux cents mètres, vous trouverez sur votre gauche une porte grillagée marquant l’entrée du cimetière juif de la ville, encore en activité mais peu entretenu.

La terrifiante guerre menée contre l’Ukraine change, bien entendu, la fonction de ces pages consacrées au patrimoine culturel juif de ce pays. Une grande partie des lieux mentionnés ont été rasés par les bombes. Si ces pages ukrainiennes n’ont pas actuellement de vocation touristique, elles pourront peut-être servir à des chercheurs et étudiants comme références historiques. Références à tant d’histoires douloureuses lors des pogroms et de la Shoah, mais aussi heureuses du judaïsme ukrainien, dans ses dimensions culturelle, cultuelle et sioniste. En souhaitant au peuple ukrainien une fin rapide à ces atrocités dont il est victime.
Belgorod-Dniestrosvki, littéralement la « ville blanche sur le Dniestr », est une ville paisible à l’humeur méridionale, située à une petite centaine de kilomètres au sud d’Odessa.
Ville forteresse
Fondée au sixième siècle avant Jésus-Christ par des colons grecs venus de Milet, Belgorod est l’une des plus vieilles villes habitées au monde. Son emplacement stratégique sur le delta du fleuve Dniestr en a longtemps fait une place forte pour les différents royaumes et empires qui l’ont contrôlée, en témoigne son impressionnante forteresse, dont la construction fut entamée par les Génois au 12ᵉ siècle, poursuivie par les Ottomans puis achevée par les Moldaves au 15ᵉ siècle.
Plus récemment, durant la période soviétique, Belgorod abritait une importante garnison, ce qui explique la forte diversité ethnique qui y existe encore aujourd’hui. Ukrainiens, Russes et Moldaves bien sûr, mais aussi Arméniens, Grecs, Géorgiens, Coréens, c’est presque tous les peuples de l’ancienne Union soviétique qui sont rassemblés dans cette paisible ville du sud de l’Ukraine. Presque tous ? Et quid de la présence juive alors ? Si actuellement, la communauté juive de Belgorod ne compte plus que quelques dizaines de personnes, la ville est marquée par un important passé juif dont vous pourrez découvrir les traces, au hasard des rues pavées bordées d’acacias et de lilas.
Accueil des communautés karaïtes
Parfois nommée dans les sources juives Weissenburg ou Ir Lavan (ville blanche) -Akkerman, ancien nom de Belgorod, a accueilli des communautés karaïtes dès le 16ᵉ siècle. C’est toutefois surtout à partir du 19ᵉ siècle que la présence juive s’y développe, comme dans le reste de la Bessarabie : selon le recensement de 1897, la ville comptait alors quelques 5 600 Juifs, soit environ 20 % de la population. Comme l’ensemble de la Bessarabie, Akkerman intègre la Grande Roumanie en 1918 et est alors renommée Cetatea Alba.

Durant l’entre-deux-guerres, la communauté juive de la ville continue de se développer, pour atteindre 8000 personnes à la fin des années 1930. Elle dispose d’une douzaine de bâtiments, dont 5 synagogues. Avec le déclenchement de l’opération Barbarossa, la majorité des Juifs de Belgorod fuit la ville, avant l’arrivée des troupes roumaines. Ceux qui restent, essentiellement des personnes âgées et des invalides, seront assassinés par balles et par noyades. Après la fin de la guerre, une partie de la communauté juive retourne dans la ville, qui reçoit son nom actuel de Belgorod-Dniestrovski. Avec la chute de l’URSS, l’essentiel des Juifs de Belgorod émigrent en Israël, aux Etats-Unis et en Allemagne.
Développement de la vie juive
Depuis Odessa, l’elektrichka, sorte de train de banlieue, est le moyen le plus simple de se rendre dans la ville blanche, comptez environ deux heures et demie. Les plus aventureux d’entre vous pourront également s’y rendre en marshroutka, sorte de minibus partant également de la gare d’Odessa. Enfin, il est toujours possible d’y aller en taxi, moyennant une trentaine d’euros. Notez bien que si vous souhaitez disposer d’un guide pour une visite des lieux juifs de Belgorod, vous pouvez vous adresser au centre culturel juif Migdal d’Odessa, situé au 46 rue Mala Arnautskaya, non loin de la gare, et qui pourra vous organiser une visite avec un guide parlant anglais, russe ou ukrainien.
Pour commencer votre promenade dans Belgorod la juive, rendez-vous depuis la gare au cimetière juif, situé à une quinzaine de minutes à pied, au 35 rue Portova (ancienne rue Lazo). S’étendant sur plusieurs hectares à l’orée de la ville, le cimetière juif de Belgorod, l’un des plus vieux d’Ukraine, abrite des milliers de tombes, dont certaines datent de plusieurs siècles. Quelques tombes sont ornées de branches d’arbres stylisées : elles ont été érigées en l’honneur des victimes du pogrom de 1905. Un monument à la mémoire des 600 Juifs de Belgorod massacrés à l’été 1941 est également présent.
Vous pourrez ensuite vous diriger vers le centre-ville à pied. Revenez sur vos pas puis traversez le parc de la Paix. En descendant la rue Nikolaevskaya, vous arriverez au marché central de Belgorod.
La belle synagogue en briques rouges
Sortez du marché par la rue Ismailskaya. Au numéro 32 se trouve l’une des deux synagogues encore en état de Belgorod. Rétrocédée à la communauté en 2001 après avoir servi de dépôts de munitions puis de salle de sport durant la période soviétique, cette synagogue faisait depuis essentiellement office de centre culturel juif, mais est désormais fermée la plupart du temps.
Longez ensuite la rue Ismailskaya jusqu’au croisement avec la rue Evreiskaya, la rue juive, dans laquelle, au numéro 29, se trouve l’autre synagogue de la ville. Ce bel édifice de brique rouge, sur la façade de laquelle on distingue encore l’étoile de David et des rouleaux de Torah stylisés, a été construit à la fin du dix-neuvième siècle.
Chef-d’œuvre architectural
On raconte que le roi Carol II de Roumanie, en visite à Cetatea Alba en 1938, n’avait eu qu’une seule exigence vis-à-vis de la communauté juive de la ville : qu’une couronne, rappelant que la Roumanie est un royaume et que les Juifs y font aussi allégeance, soit installée à proximité de l’étoile de David ornant la façade de la synagogue. Faisant office de salle de sport durant la période soviétique, elle a également été rétrocédée à la communauté en 2001. Encore en activité il y a quelques années, la synagogue de la rue Evreskaya est en général fermée, sauf à certaines occasions.
Poursuivez la rue Evreiskaya jusqu’au croisement avec la rue Pushkinskaya. Au numéro 13, dans une maison bourgeoise datant de la période tsariste et ayant appartenu à la famille d’armateurs grecs Femilidi se trouve le musée historique de la ville. De grande qualité, le musée de Belgorod dispose de plusieurs vitrines consacrées à l’histoire juive de la ville. En particulier, le musée possède les anciens rouleaux de la Torah auparavant disposés dans la synagogue de la rue Evreiskaya. A proximité immédiate du musée, au 26 de la rue Pushkinskaya, vous pourrez également contempler un chef d’œuvre architectural construit à la fin du 19ᵉ siècle, la maison d’Andrei Yarashevich, ancien notable de Belgorod.
Non loin du musée, au numéro 35 de la rue Nezalejnosti, est située la maternité de Belgorod, localisée dans les murs de l’ancien hôpital juif . En 1938, lors de son déplacement à Cetatea Alba, le roi Carol II aurait assisté en personne à l’inauguration de cet hôpital, en partie financé par le ténor et collectionneur d’art Maxim Karolik.
Né en 1893 à Akkerman dans une famille hassidique, Maxim Karolik, après avoir été chanteur au théâtre Marinskii de Petrograd, émigra aux États-Unis en 1922 ou, parallèlement à sa carrière de ténor, il devint, avec sa femme Martha Codman, un grand collectionneur d’art. Au hasard de votre promenade, vous pourrez découvrir d’autres bâtiments ayant appartenu à la communauté juive. L’immeuble situé au 13 de la rue Moskovskaya abritait auparavant une banque juive Au numéro 11 de la rue Souvorov se trouvait l’ancien asile pour personnes âgées .
Enfin, il serait dommage d’être allé jusqu’à Belgorod sans visiter sa plus grande fierté, la forteresse.